Sous l’Ancien régime, le travail des artisans et des commerçants était contrôlé par un système ultra-réglementaire connu sous le nom de corps de métiers ou corporations. Il existait cependant quelques enclos de liberté, des sortes de zones franches, où le système corporatif ne s’appliquait pas, et où quiconque pouvait travailler selon son bon vouloir, sans payer aucun droit, et en suivant les volontés de sa clientèle plutôt que les obscurités des règlements. Le plus célèbre et le plus important îlot de liberté était le faubourg Saint-Antoine (entre les actuels 11e et 12e arrondissements de Paris). De 1657 à 1776, le faubourg Saint-Antoine constitue en effet le principal lieu de travail « privilégié », c’est-à-dire libre. Les artisans ne sont pas astreints aux formalités tracassières et coûteuses des corporations et peuvent travailler sans lettres de maîtrise et sans subir les exactions des inspecteurs du travail de l’époque, les « jurés » parisiens. Sans surprise, les habitants du faubourg connurent une prospérité exceptionnelle et s’attirèrent les foudres des maîtres des corporations parisiennes.
Une expérience de la liberté du travail sous l’Ancien régime :
le faubourg Saint-Antoine (1657-1791)
par Benoît Malbranque
Étude tirée de la revue Laissons Faire
Introduction. — I. Les corporations et la réglementation du travail au XVIIIe siècle.
II. Le faubourg Saint-Antoine, un paradis de la liberté du travail.
III. Ce qu’il en coûte d’être libre.
IV. Le succès de la libre entreprise.
V. Un modèle contre le système réglementaire. — Conclusion
Introduction
Pour l’observateur du passé, il est peu de faits économiques plus décisifs que cette pratique, dont l’histoire donne tant d’exemples, de « voter avec ses pieds ». Elle tranche sans compromis possible les débats d’idées complexes, en rendant caducs les schémas intellectuels les plus élaborés et les idéologies les plus séduisantes.
Les défenseurs de la liberté économique, qui, dans ce domaine, n’ont que l’embarras du choix, ont souvent cité comme exemple les États-Unis du XIXe siècle, ou Taïwan au XXe. Plus récemment, Gabriel Openshaw montrait dans un article au Mises Institute qu’à l’intérieur même des États-Unis, on avait comptabilisé, de 2006 à 2010, un afflux net de 700 000 personnes provenant des vingt-cinq États les moins libres économiquement, vers les vingt-cinq États les plus libres. [1] De manière tout à fait similaire, en Europe, un grand nombre d’Allemands ont récemment émigré vers la Suisse (alémanique) et des Français ont fait de même, en direction de l’Angleterre. La raison en est bien connue : c’est que, derrière la scène du théâtre politique quotidien, les forces économiques ne cessent jamais d’opérer, aussi imperturbables que celles de la gravitation.
Si l’histoire de la liberté mérite d’être écrite, elle doit comprendre l’étude de ces choix collectifs, qui sont autant d’illustrations pratiques de la préférence qu’ont toujours accordée les populations du monde entier aux formes économiques plus libres, quand la porte du choix leur était ouverte ou entrouverte. Pour chaque manifestation de l’interventionnisme étatique, du système économique de la contrainte, des règlements et des prohibitions, il faut chercher comment ont agi les populations qui se trouvaient dans des occasions de choisir entre ce premier système, et un système plus libre ou entièrement libre.
Le présent article entend étudier et documenter l’un de ces cas. Le sujet, la liberté du travail, ne s’impose pas uniquement en raison de l’actualité, mais de son caractère fondamental : puisque l’homme est condamné à gagner son pain à la sueur de son front, le travail lui est une ressource essentielle, vitale. Dans son célèbre édit de 1776, apportant la liberté du travail, Turgot le dit bien. « Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » Avant que ce même édit ne vienne (provisoirement) changer la donne, le travail des artisans et des commerçants était fortement réglementé et compris dans un système policier connu sous le nom de corps de métiers ou corporations. Il existait, cependant, des enclos de liberté, des sortes de zones franches, où le système corporatif ne s’appliquait pas, et où quiconque pouvait travailler selon son bon vouloir, sans payer aucun droit, et en suivant les volontés de sa clientèle plutôt que les obscurités des règlements. Le plus célèbre et le plus important îlot de liberté était le faubourg Saint-Antoine (entre les actuels 11e et 12e arrondissements de Paris).
De 1657 à 1776, le faubourg Saint-Antoine constitue en effet le principal lieu de travail « privilégié », c’est-à-dire libre. Les artisans ne sont pas astreints aux formalités tracassières et coûteuses des corporations et peuvent travailler sans lettres de maîtrise et sans subir les exactions des inspecteurs du travail de l’époque, les « jurés » parisiens.
Son développement économique et démographique, la typologie de ses productions, la réputation de ses ouvriers, tous ces éléments nous seront utiles, la comparaison entre le faubourg Saint-Antoine, zone de liberté, et le reste de Paris, zone de réglementation draconienne, devant nous fournir un élément de réponse important pour trancher la question de savoir ce qui vaut mieux, dans ce domaine, de la réglementation ou de la liberté.
I. Les corporations et la réglementation du travail au XVIIIe siècle
Avant d’étudier les succès de cet enclos de liberté qu’a représenté le faubourg Saint-Antoine, nous fournirons ici quelques éléments permettant de comprendre le système réglementaire français auquel il fournissait une alternative frappante et visiblement séduisante. [2]
À partir du XIIIe siècle et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le travail des artisans et des commerçants a été régi par le système des corporations. Personne ne pouvait exercer son métier sans avoir acquis auparavant des lettres de maîtrise. Chaque métier, chaque sous-métier, avait sa corporation : celle-ci se donnait des statuts, qui définissaient les conditions d’accès au statut de maître et le cadre de l’exercice de la profession.
Pour obtenir le titre de maître dans la profession de son choix, il fallait :
1/ Effectuer un « apprentissage », d’une durée variable selon les métiers, auprès d’un maître, qu’on payait. La durée moyenne, de cinq ans, était parfois plus courte, parfois plus longue, mais elle se définissait toujours comme un minimum, à partir duquel on pouvait commencer à prétendre à l’étape suivante. Les frais impliqués par cette formation excluaient les jeunes sans fortune, dont l’horizon se limitait ainsi à travailler dans les champs ou à servir un maître. Les durées excessives, pour apprendre des métiers souvent assez basiques, en révoltaient plus d’un. « Il faut plus de temps pour devenir tireur d’or, que pour se faire recevoir docteur en Sorbonne » disait Vincent de Gournay au milieu du XVIIIe siècle. [3] En 1768, l’abbé Coyer met le même langage dans la bouche de son personnage Chinki : « Dix ans pour être Maître dans l’Art des bonnets ! Celui qui a fait le règlement du bonnet n’avait point de tête. Naru ! Tu ne feras pas des bonnets. — Eh bien ! Qu’il fasse des tonneaux, répondit le Bonnetier, il en sera quitte pour sept ans d’apprentissage, sans compagnonnage. — Il n’en faudrait pas tant, répliqua Chinki, pour apprendre à construire un Vaisseau. » [4]
2/ Effectuer un « compagnonnage ». Au XVIIIe siècle, l’usage de poursuivre la formation d’apprenti avec plusieurs années de compagnonnage s’est répandu et presque tous les corps de métiers de Paris l’ont rendu obligatoire. Le temps moyen est de deux à trois ans, qui s’ajoutent donc aux cinq années moyennes de l’apprentissage.
3/ Réaliser un « chef-d’œuvre ». Ses années d’apprentissage et de compagnonnage achevées, l’ « aspirant à la maîtrise » doit, pour obtenir le titre de maître, subir un examen devant les maîtres du métier. Officiellement, l’objectif est de vérifier les compétences du candidat, mais en réalité, il s’agit pour les membres d’une profession de contrôler le nombre des concurrents. Les maîtres n’hésitent d’ailleurs pas à rançonner les aspirants à grand coup de banquets et de présents, qui, formellement interdits, sont largement répandus. D’habitude très sobre, le Dictionnaire de Trévoux (1743) dit que l’essentiel dans ces examens n’est pas la qualité du travail : « le principal point est de bien arroser le chef-d’œuvre, c’est-à-dire, de faire bien boire les Jurés. » [5]
Alors enfin on est maître et on a la liberté d’ouvrir sa boutique, d’être artisan ou commerçant, selon la corporation dans laquelle on s’est formé et on a obtenu le titre de maîtrise. Cette liberté est bien mince, d’autant que les statuts, auxquels le présent maître doit se conformer, lui définissent de manière très stricte le cadre de son travail. Le temps du travail est fixé : interdiction de travailler la nuit, le dimanche ou lors des nombreuses fêtes. Les matières premières, les méthodes de travail, les produits, tout est scrupuleusement défini dans les statuts ou les règlements. Gare à ceux qui osent passer outre ces impératifs, car des jurés veillent au contrôle de leur bonne application, avec d’autant plus d’application et de sévérité qu’ils se partagent ensuite — avec le Roi, qui touche aussi sa part — le produit des amendes.
_______________________
[1] Gabriel Openshaw, “Vote with Your Feet: Free States Are Happier and Richer”, Mises Daily, 17.09.2015
[2] Sur les corporations, voir Émile Coornaert, Les corporations en France avant 1789, 2ème édition, Les éditions ouvrières, 1968 ; F. Olivier-Martin, L’Organisation corporative de la France d’Ancien Régime, Paris, 1938 ; et Étienne Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu’à leur suppression en 1791, 3e édition, Paris, 1922.
[3] Traités de commerce de Josiah Child, suivis des Remarques de Jacques Vincent de Gournay, L’Harmattan, 2008, p.177
[4] Gabriel-François Coyer, Chinki : histoire cochinchinoise applicable à d’autres pays (1768), réédition Institut Coppet, 2013, p.33
[5] Dictionnaire universel françois et latin, nouvelle édition, tome 2, Paris, 1743, p.6
II. Le faubourg Saint-Antoine, un paradis de la liberté du travail
Par son importance économique et peut-être encore plus idéologique, le faubourg Saint-Antoine a marqué l’histoire économique de la France d’Ancien Régime. Sa propre histoire nous est désormais également bien connue, après les travaux de Raymonde Monnier, Steven L. Kaplan et Alain Thillay. [1]
Les origines du faubourg Saint-Antoine ne peuvent être retracées beaucoup plus loin que 1630, année vers laquelle les premières constructions y sont attestées. En 1643, le faubourg se dote d’un marché. L’évènement majeur intervient quelques années plus tard. En février 1657, le jeune Louis XIV signe des lettres patentes accordant un privilège au faubourg Saint-Antoine. Son intention est avant tout sociale, presque humanitaire. La Fronde, les guerres étrangères, les maladies, les catastrophes naturelles ont causé beaucoup de récents malheurs et provoquent l’augmentation inquiétante du nombre des pauvres, des vagabonds et des mendiants. En avril 1656, le pouvoir avait déjà établi l’Hôpital Général de Paris pour y accueillir des malheureux. Face à l’insuffisance de ce premier moyen, la liberté du travail est envisagée comme un remède. Par le privilège qui leur est octroyé, les artisans et commerçants du faubourg Saint-Antoine sont affranchis de toutes les formalités liées aux corporations. Aucun apprentissage ni compagnonnage requis, aucun chef-d’œuvre, aucun banquet, aucuns frais de réception ; est ouvrier qui veut. Les habitants du faubourg sont également à l’abri des visites des jurés parisiens, les inspecteurs du travail de l’Ancien régime.
Dans ce climat de liberté du travail, l’activité économique ne va pas tarder à fournir au faubourg un remarquable dynamisme. Des logements remplissent peu à peu les artères principales et s’étendent dans les rues adjacentes. De nouveaux édifices religieux et des bâtiments publics s’élèvent en l’espace de quelques dizaines d’années. En termes de démographie, le développement est également impressionnant. Dès 1725, le faubourg dépasse les 40 000 habitants, soit près de 10% de la population parisienne. [2] Ce chiffre fournit même une estimation basse, puisque les registres, notamment paroissiaux, ne mentionnent pas les habitants de confession protestante, qui durent cependant être nombreux dans le faubourg Saint-Antoine, puisque leur foi leur bloquait l’accès aux corporations dans tout le reste de la France.
Spontanément, cet élan démographique semble provenir d’un afflux de pauvres ouvriers, pour lesquels le « circuit » corporatif était inaccessible. Nous verrons plus loin que la réalité est plus complexe, le faubourg s’étant aussi progressivement peuplé de vrais maîtres parisiens, désireux de fabriquer des produits innovants ou interdits par les règlements. Après avoir étudié en détail les baux de location, les inventaires après décès, les contrats de mariage et les minutes des commissaires de police, Alain Thillay conclut aussi au caractère très hétérogène de la population du faubourg Saint-Antoine. [3] Si beaucoup d’individus sont venus profiter du climat de liberté économique, à l’abri du privilège du faubourg, tous n’avaient pas les mêmes raisons ni les mêmes motivations.
Passé les premières décennies de l’essor spontané et considérable, la population du faubourg se fige dans une configuration qui sera la sienne jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Toutes les rues sont occupées, la réputation des artisans qui les habitent est faite, en bref l’éco-système du faubourg Saint-Antoine est en place et fonctionne devant les yeux, méfiants ou admirateurs, des habitants du reste de la capitale.
Un sentiment d’opposition est cependant dans l’air. Dès le début du XVIIIe siècle, la progression rapide du bâti et du chiffre de la population du faubourg surprend les maîtres des corporations parisiennes et les tient dans l’inquiétude d’une concurrence « déloyale » qui deviendrait croissante. Commence une période de luttes, de procès et de révoltes, qui devait décider du sort à réserver au privilège du faubourg.
Par principe, le privilège du faubourg Saint-Antoine est condamné par les corporations parisiennes dès sa création en 1657. Il est l’objet de plaintes, vives mais discrètes, au cours de la décennie 1670, au moment où la royauté tente de consolider le pouvoir de police des corporations et du Châtelet, leur autorité centrale. Les premières dénonciations sont d’ampleur limitée, partie en raison de l’habitude des corporations de concentrer leurs forces dans la lutte contre les corporations concurrentes, plutôt que contre le « monde libre » du travail sous l’Ancien régime, partie en raison du fait que le péril leur apparaît, en l’espèce, comme mineur : le Faubourg semble être d’abord un lieu périphérique et peu peuplé. Les choses, cependant, changeront vite. Dès lors les requêtes se multiplient pour demander la cessation de cette situation de concurrence déloyale, sans jamais que le pouvoir ne lâche du leste sur le privilège du faubourg Saint-Antoine. En 1721, ses artisans obtiennent la poursuite du privilège, lequel sera maintenu jusqu’à la fin. Cette fin, c’est d’abord l’édit de Turgot en 1776, détruisant tous les corps de métiers : mais le ministre réformateur est immédiatement renvoyé et les corporations rétablies, ce qui provoque une secousse à peine perçue dans le faubourg. En 1791, cependant, le décret d’Allarde, les 2 et 17 mars, retire au faubourg Saint-Antoine sa raison d’être : puisque tout devient également libre, le privilège disparaît, ou plutôt il devient sans substance, sans effet.
C’était la fin d’un privilège, d’une exception libérale, qui avait, comme on va le voir, provoqué un enrichissement considérable et le développement d’un artisanat estimé et recherché dans toute la capitale et au-delà. Cette liberté s’était cependant accompagnée, pendant toute la durée du privilège mais surtout au cours du XVIIIe siècle, d’un ensemble d’interventions parasitaires des corporations ou des pouvoirs publics, désireux de rabaisser le faubourg, d’entraver son développement et de détruire les aspirations de ses habitants et de ses partisans à le voir se généraliser.
_______________________
[1] Raymonde Monnier, Le faubourg Saint-Antoine, 1789-1815, Bibliothèque d’
[2] Thillay, op. cit., p.25
[3] Thillay, op. cit., p.124
III. Ce qu’il en coûte d’être libre
Selon les activités ou les professions, le privilège du faubourg Saint-Antoine est plus ou moins attaqué et remis en cause, ses artisans et commerçants plus ou moins sujets aux critiques et aux interventions malveillantes des corporations parisiennes. Dans l’ensemble, cependant, le faubourg s’attire de façon croissante la haine du milieu corporatif, laquelle s’illustre de multiples façons.
Grâce au privilège offert par le roi, l’habitant du faubourg Saint-Antoine ne partage pas avec les autres ouvriers sans maîtrise les dangers de l’illégalité. Dans le reste de Paris, ceux qu’on appelle dédaigneusement les « faux ouvriers » — comme on pouvait dire aussi le « faux-bourg », avec ses « faux artisans » — vivent et travaillent cachés, à l’abri des regards de la police corporative. Ils logent dans des chambres (d’où leur autre nom de « chambrelans »), avec la complicité voire le concours actif du propriétaire. À cet égard, il est curieux d’apprendre que nombreux sont les « ouvriers sans qualité » qui logeaient chez des maîtres — exerçant le même métier qu’eux ou un autre tout différent —, preuve d’un double langage que l’on retrouvera souvent à l’œuvre dans le cas du faubourg Saint-Antoine.
Établi légalement, l’artisan du faubourg n’en subit pas moins des critiques, des violences, des pressions, que nous allons détailler ici.
L’ouvrier libre ne peut être qu’un mauvais ouvrier
Plus douce, en apparence, que la violence physique et les exactions des jurés parisiens, la critique faite par les maîtres des ouvriers du faubourg, accusés d’être de mauvais ouvriers, corrompus, dépravés, violents et dangereux, n’en a pas moins une importance centrale. Son poids fut immense dans le débat sur les avantages respectifs de la réglementation du travail et de la liberté, où la discussion s’étendit facilement hors des critères purement économiques : conserver le système des corporations, affirmait ses défenseurs, c’était se garantir contre le progrès de l’immortalité, des cabales, des manœuvres et des fraudes. Quoique dénuée de fondement, cette critique des ouvriers sans maîtrise a été subtilement (mais pas vraiment innocemment) réaffirmée par l’historien Steven L. Kaplan. Dans sa charge contre l’esprit économique du siècle des Lumières, qui détruisit une organisation stricte du travail pour lui substituer la liberté pleine et entière, Kaplan vise naturellement, par ricochet, les efforts des fils et petit-fils de Turgot pour libéraliser le marché du travail au XXIe siècle. Dans ce procès discret, la pièce de condamnation morale de l’ouvrier libre du faubourg Saint-Antoine est présentée sans surprise. Dans un long passage de son livre La fin des corporations, Kaplan reprend à son compte les critiques des pro-corporations :
« Une des menaces les plus sérieuses pesant sur le contrôle que la corporation exerçait sur son capital social et économique venait de ces milliers d’individus infiltrés un peu partout que les dirigeants fustigeaient sous les noms d’ « usurpateurs », d’ « ouvriers sans qualité » et de « faux ouvriers ». […] Ils créaient, hors des communautés de métiers, un univers parallèle perçu comme socialement illicite, politiquement séditieux, moralement corrompu et techniquement incapable. Les faux ouvriers étaient des imposteurs et des faussaires dont le travail menaçait la société en général autant que l’ordre des corporations, parce qu’il était « frauduleux » et « mensonger ». À en croire leurs adversaires, les faux ouvriers mettaient en péril le bien-être de la société au même titre que celui des maîtres, parce qu’ils trichaient et fraudaient, ou commettaient des fautes involontaires, mais non moins dangereuses. Ils manquaient tantôt de formation de base, tantôt d’encadrement nécessaire, quand ce n’était pas des deux à la fois. Au mieux, ils avaient bénéficié d’apprentissages tronqués, et au pis « ce ne sont que valets de chambre, portiers, cochers… tous gens sans expérience comme ils sont sans droits », déclaraient avec mépris les maîtres fabricants de bas au métier. Les éventaillistes s’élevaient contre « les ouvrages défectueux » avec lesquels « ils trompent le public » ; les doreurs s’indignaient de ce qu’ils « mêlaient le fin avec le faux » ; les plombiers se plaignaient de leurs « méchantes matières » et « mauvaise fabrication » ; et les maçons déploraient leurs déficiences de structures ».
Toujours en mêlant les accusations des corporations à sa propre explication, cherchant ainsi à donner du volume et de la crédibilité à la première en l’incorporant dans l’impartialité du discours d’un historien parfaitement détaché des controverse de l’époque, Kaplan continue :
« Pour comprendre les dommages causés par les faux ouvriers, il faut étudier leur caractère moral tout autant que leur compétence technique. Dans certains cas, les faux ouvriers quittaient ou évitaient le monde des communautés, parce qu’ils étaient déjà corrompus : ils avaient « la corruption dans le cœur », ou bien ils avaient été « renvoyés par les maîtres en raison de leur incorrigible mauvaise conduite ». Dans d’autres cas, ils partaient sans avoir été particulièrement mal notés, mais représentaient un terrible risque s’ils continuaient de vivre hors des corporations. Étant donné leur nature faible et mauvaise, avançaient les responsables, ces compagnons ne pouvaient que mal vivre et mal se comporter. Il n’était pas de bonne vie hors des règles et de la surveillance des communautés. C’était parce qu’ils vivaient sans la tutelle des maîtres et parce qu’ils ne respectaient pas les « statuts de la profession » que ces ouvriers vivaient « en libertins », soutenait la communauté des orfèvres. Que faisaient des hommes sans statut reconnu en ces « lieux cachés » ? « Ils viv[ai]ent sans ordre et sans discipline », bien sûr. Les maîtresses lingères comparaient le prestige et la pureté de leur boutique, toute en transparence, avec l’ignominie de la chambre obscure. Leur soif de « liberté absolue » menait les faux ouvriers à la « licence » et à la « dissolution ». Il n’était pas étonnant qu’on les trouvait communément à la taverne et dans les tripots, en fort mauvaise compagnie. Non seulement ils vendaient des produits défectueux ou corrompus à des acheteurs de bonne foi, mais ils avaient en outre bien souvent « libre accès » aux maisons bourgeoises. Car il n’est pas de sûreté dans un monde de travail sauvage.
S’il n’y avait pas de sûreté pour le consommateur, il y en avait encore moins pour le maître. Les faux ouvriers mettaient en péril les intérêts les plus fondamentaux des corporations. Indifférents aux valeurs et à l’orgueil de la communauté, tout à fait dénués de scrupules dans leur appétit de profit, ils transformaient, de l’avis des maîtres, leur non-appartenance en un avantage précieux. D’abord, ils se lançaient dans des activités qui leur étaient strictement interdites, puis, tout en amplifiant mortellement la concurrence, ils la faussaient. En détournant le travail qui devait théoriquement revenir aux maîtres et en provoquant une baisse des prix, les ouvriers sans qualité « ruinaient » les membres respectables des communautés — surtout les plus faibles qui étaient aussi les plus nombreux — et nuisaient donc sérieusement à la santé financière de ces institutions, car les maîtres touchés ne pouvaient plus payer leurs impositions. Vendant bon marché, grâce à leurs moindres frais et à leurs fraudes sur la matière première et la fabrication, les chambrelans ravissaient aux maîtres leurs pratiques. […]
En s’arrogeant les tâches économiques des communautés de métier, les faux ouvriers mettaient en question la légitimité du monopole moral et juridique des corporations sur le travail, ainsi que leur droit à le diviser, le hiérarchiser, le réglementer. Cette provocation était la plus insidieuse, car ce n’était nullement une attaque frontale, mais plutôt une guérilla, une guerre d’usure. » [1]
Quoique manifestement excessive, au point d’en devenir par endroit grotesque (« en amplifiant mortellement la concurrence, ils la faussaient », « ils vendaient des produits défectueux ou corrompus à des acheteurs de bonne foi »), ce long passage reprend la presque totalité des critiques adressées au cours de l’histoire par les maîtres des corporations à l’endroit des ouvriers sans maîtrise, qu’ils soient illégaux ou habitants du faubourg Saint-Antoine.
Comme l’illustre la déclamation de Kaplan, cette critique portait sur plusieurs niveaux. Au niveau économique, on accusait les artisans du faubourg de produire de la mauvaise qualité, en utilisant des matières premières défectueuses et en fabricant suivant des méthodes incorrectes, soit du fait d’un manque d’instruction, soit par ce simple désir de nuire qu’on disait provenir d’un cœur naturellement corrompu. « C’est dans le faubourg Saint-Antoine que se vend tout ce qui est mal fabriqué, disent les maîtres blondiniers-boutonniers dans un mémoire daté de 1776. C’est là que l’ouvrier ne consultant que le besoin de vivre, travaille toute la semaine pour aller le samedi de nuit trouver des acheteurs à qui il donne à bon marché ce qu’il a fait à la hâte et sans précaution. » [2] Au niveau moral, ils étaient présentés comme des débauchés, achevant leur ouvrage à la hâte pour se précipiter dans les auberges, quand ce n’était pas pour recourir aux services de prostituées. Au niveau social, on les accuse de comportements séditieux, de porter la révolte dans leur âme — déshabitués qu’ils doivent être du contrôle de la police. Au niveau politique, enfin, ils rompent l’ordre pluri-centenaire des corporations de métiers, scellé par un pouvoir monarchique dont ils ébranlent les fondements comme par ricochet.
Les interventions des jurés
Lors de la création du privilège du faubourg Saint-Antoine en février 1657, les dispositions mentionnent clairement que les habitants y pourront travailler librement, sans titres de maîtrise, et sans qu’ils puissent être gênés par les jurés parisiens. Le texte prévoit même une amende de 500 livres pour les jurés qui outrepasseraient la limite géographique de leur périmètre d’intervention. [3]
Cependant, les corporations n’ont jamais abdiqué leur droit prétendu de réglementer le travail. D’abord épisodique, à l’époque de la constitution du faubourg, cette immixtion, en menaces ou en actes (parfois violents), s’intensifie lors du développement de ce lieu privilégié. Tout acquis à la défense des corporations, Kaplan mentionne ce fait sans s’en scandaliser le moins du monde. « L’État s’étant révélé incapable de réintégrer pleinement le faubourg Saint-Antoine au nouveau régime corporatif, écrit-il, plusieurs communautés, dont chacune comptait des membres ainsi que des rivaux farouchement indépendants dans cette enclave encore « libre », continuèrent de surveiller la frontière et d’entreprendre des raids punitifs plus ou moins licites dans le faubourg. » [4]
Dans un mémoire de 1717, les ouvriers et artisans du faubourg Saint-Antoine se plaignent de ces visites illégales et violentes des jurés parisiens. « De ce que les jurez de Paris feroient s’ils estoient une fois autorisez à venir en visite dans le fauxbourg, disent-ils, il faut en juger par ce qu’ils ont fait par le passé lorsqu’ils y sont venus sans titre, sans autorité, contre les deffenses expresses portées par les lettres patentes du Roy votre bisayeul. Ils n’y sont jamais venus pour examiner et réformer les ouvrages, mais pour les saisir et pour enlever quelques choses à de pauvres ouvriers. Ils ont toujours affecté de saisir chez les meilleurs ouvriers du fauxbourg leurs ouvrages les meilleurs et les mieux faits, exprès pour les fatiguer. Et si un pauvre ouvrier se récriait contre leur injustice, aussi-tôt procès verbal de rébellion, assignation à la police et tout ce qui s’ensuit. » [5]
Ces actions, en vérité parfaitement illégales, soulevaient beaucoup plus l’émotion populaire que les descentes chez les chambrelans parisiens, d’abord parce que les habitants du faubourg Saint-Antoine avaient le droit, le droit royal pour eux, et ensuite en raison des préjugés favorables : les saisies au faubourg Saint-Antoine apparaissaient comme la lutte immorale de corporations monopolistiques contre de pauvres ouvriers.
Habitués à la liberté et à la souveraineté du consommateur, les habitants du faubourg Saint-Antoine condamnaient l’intervention des jurés comme essentiellement nuisible. Pour s’enrichir, pour se faire une réputation, il était plus important de satisfaire la clientèle que les dispositions, obscures et baisées, des règlements corporatifs. Aux yeux des habitants du faubourg, l’inspection du travail était une spoliation, une persécution. « Les jurés, disaient-ils, n’ont nulle envie par leurs visites d’instruire les ouvriers du faubourg des règles de leur art et métier, ils n’ont d’autre but que de les vexer et tourmenter par des procès, et à faire des vexations de les faire quitter le faubourg et se disperser ». [6]
Procès et recours à l’autorité publique
Visiblement attachés à leur privilège, les habitants du faubourg Saint-Antoine sont forcés de le défendre devant l’autorité publique, face aux procès incessants intentés par les corporations. Ces efforts, dont l’intensité ira croissant avec le développement économique du faubourg, paraissent atteindre leur objectif vers 1707, quand les corporations engagent une campagne massive pour étendre aux lieux de travail privilégié le périmètre d’intervention des jurés parisiens. Cependant un arrêt de 1710 les déboute de leurs prétentions et solidifie le privilège du faubourg. Ne s’avouant pas vaincues, les corporations continuent d’engager des procès et de soumettre des requêtes aux pouvoirs publics. Leurs démarches atteignent un pic lors des débats engagés par le pouvoir royal en vue du renouvellement du privilège. Une fois encore, cependant, les autorités décident de confirmer la liberté du faubourg Saint-Antoine et le privilège est renouvelé en 1721.
Lors de ces menées judiciaires, nombreuses sont les corporations qui livrent bataille contre le privilège du faubourg, quitte à s’endetter lourdement pour engager et conduire les procès. Les selliers carrossiers initient le mouvement en 1665, suivis par les doreurs sur cuivre en 1689, les brasseurs en 1697, les bouchers en 1699, les menuisiers en 1710 et les chapeliers en 1712. Ces efforts, qui gagnent en fréquence à partir de 1720, s’avèrent heureusement stériles pour la liberté du faubourg Saint-Antoine, les corporations, pseudo-représentants de la solidarité du monde du travail, prouvant continuellement leur incapacité à mener un front commun.
_______________________
[1] Steven L. Kaplan, La fin des corporations, Fayard, 2001, p.326-327
[2] B.N., Coll. Joly de fleury, 462, fol. 108-111
[3] Alain Thillay, Le faubourg Saint-Antoine et ses « faux-ouvriers ». La liberté du travail aux XVIIe et XVIIIe siècles, Champ Vallon, 2002, p.74
[4] Kaplan, op. cit., p.346
[5] A.N., F12 781c, 10e dossier, Mémoire des ouvriers et artisans du faubourg Saint-Antoine, vers 1717
[6] Cité par Kaplan, op. cit., p.343
IV. Le succès de la libre entreprise
Si face aux prétentions des corporations et de leurs jurés, les habitants du faubourg Saint-Antoine font valoir leurs droits, face aux critiques et aux accusations, ils ont recours à la défense de leur travail et de leur réputation. Lors des débats sur la poursuite ou la fin du privilège, deux avocats, Busnel et Chalopin, portent leurs récriminations. La liberté du travail a été la cause de l’enrichissement du faubourg, expliquent-ils. Les clients qui s’y pressent, venus souvent du reste de la capitale, illustrent en outre la satisfaction qu’ils tirent de leurs achats dans le faubourg, ce qui ruine les allégations des maîtres parisiens sur la mauvaise qualité et même la dangerosité des productions qui y sont réalisées. Si ces critiques étaient valides, disent les habitants du faubourg Saint-Antoine, « il y a longtemps que les supplians s’étant décriez eux-mêmes, auraient perdu la confiance du public, et que se trouvans sans pratiques et sans débits, auroient été contraints de quitter le fauxbourg et de chercher fortune ailleurs. » [1]
Les habitants du faubourg reprochent également aux maîtres de tenir un double langage. S’ils se montrent très bruyants contre l’ignominie des ouvriers sans-qualité du faubourg Saint-Antoine, les maîtres parisiens n’hésitent toutefois pas à recourir à leurs services dans l’exercice de leur métier. « La plupart d’entre eux viennent au fauxbourg faire exécuter par les supplians les plus beaux ouvrages qu’on leur commande dans leurs boutiques à Paris », soutiennent les habitants du faubourg. [2]
Croissance de la population
La croissance vigoureuse du nombre de la population du faubourg Saint-Antoine témoigne du succès économique de la liberté du travail. Ainsi, les Parisiens de l’Ancien régime ont bel et bien « voté avec leurs pieds » en affluant toujours plus nombreux pour s’installer dans le faubourg, où ils étaient à même d’entreprendre et de travailler selon leurs souhaits.
Ces nouveaux habitants viennent de tous les milieux. Certains sont pauvres, voire indigents : ils fuient l’espace corporatif parce que les statuts affirment que le postulant à la maîtrise doit « avoir de quoi », et ce capital leur fait défaut. Certains, quoique sans être désargentés, n’ont pas la patience de suivre le circuit apprenti-compagnon-maître ou sont convaincus du caractère spoliateur ou immoral de l’organisation corporative. D’autres fuient les rigueurs des statuts, comme les enfants nés hors mariage ou les protestants, exclus des corporations. Enfin, le faubourg abrite aussi des artisans chevronnés, parfois titulaires d’un titre de maîtrise, qui trouvent dans sa liberté l’occasion de développer des produits innovants. Nous retrouvons encore ici cette ambivalence des corporations, luttant d’un côté contre le privilège du faubourg Saint-Antoine, mais dont certains membres se sont intégrés dans cette zone de liberté. Outre celle des vrais maîtres, la défection que connaissent les corporations parisiennes vient aussi des apprentis et compagnons, fatigués des rigueurs attachées à leur condition et rêvant d’un avenir prospère qui leur est de plus en plus refusé, surtout s’ils n’ont pas les ressources financières ou les relations qui pourraient leur faire atteindre la maîtrise. Au sein du faubourg, ils trouvent, comme les autres habitants, une occasion d’ouvrir eux aussi leur boutique et de gagner davantage.
Les bons produits du faubourg
Malgré les critiques biaisées des maîtres parisiens, les artisans du faubourg Saint-Antoine jouissent à l’époque d’une grande notoriété. En 1779, le Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs se rend le porte-parole de cette réputation : « Ce quartier est renommé par la prodigieuse quantité d’ouvriers en tout genre dont fourmille la grande rue du Faubourg Saint-Antoine et par les chaudronniers auvergnats qui y logent. Ce faubourg n’est pas moins fameux par ses manufactures importantes, par celle des glaces de Reuilly, celle des taffetas, de toiles cirées, d’étoffes de Paris, de papiers peints de toutes couleurs, celle de colle forte, de poêle, etc. » [3] Le faubourg, visiblement, attire une clientèle nombreuse. On peut en trouver deux explications : la première, c’est que loin d’être incapables, les ouvriers du faubourg produisent des articles de luxe très remarqués du public ; la seconde, que la liberté dont jouissent ses habitants leur permet aussi de produire pour toutes les bourses, hors du sentier balisé de l’organisation corporative.
La forte présence de l’artisanat de luxe au faubourg Saint-Antoine étonne de prime abord. Les ouvriers sans qualité ne sont-ils pas des pauvres travailleurs sous-formés ? Visiblement, leur incompétence technique tient plus du fantasme ou de la calomnie gratuite que de la réalité. Les Parisiens se pressent dans le faubourg pour commander des pièces d’ébénisterie, des faïences, des miroirs. Les merciers, formant pourtant une corporation officiellement très opposée au privilège du faubourg Saint-Antoine, n’hésitent pas à s’y fournir pour répondre aux demandes pressantes et récurrentes de leurs clients dans le reste de la capitale.
Dans cet enclos de liberté, la souveraineté du consommateur s’exerce pleinement. À côté des productions de luxe, le faubourg assure la fabrication et la commercialisation de produits courants, disponibles pour toutes les bourses, comme les chaussures, les meubles ou les vêtements. C’est que les consommateurs ne désirent pas tous la meilleure qualité possible, et que d’ailleurs les ouvriers ne sont pas tous en mesure de produire des chefs-d’œuvre. Telle est l’essence même d’un marché libre que de permettre la satisfaction de tous les types de besoins, luxueux, standards, basiques, ou médiocres. À ce titre ses premiers théoriciens ne s’étaient pas trompés. « Dans les étoffes comme dans beaucoup d’autres choses, écrivait Vincent de Gournay, il faut nécessairement qu’il y ait du bon, du médiocre, du mauvais. Vouloir absolument retrancher cette dernière espèce, c’est porter surement atteinte aux deux autres ; le mauvais en matière de fabrique, vaut mieux que rien ; d’ailleurs si une étoffe qui nous paraît mauvaise se consomme, elle n’est pas mauvaise, et si elle ne se consomme pas le fabricant est puni dans l’instant même, et se réforme. » [4] La souveraineté du consommateur, dont Gournay et quelques autres affirmaient la supériorité dans leurs écrits, s’illustrait pleinement au faubourg Saint-Antoine, comme pour prouver ses mérites. Les habitants du faubourg étaient bien conscients des avantages de pouvoir suivre la demande et répondre aux modes ; cette liberté, quand d’autres devaient suivre des règlements poussiéreux, assurait leur prospérité. Le mémoire des ouvriers et artisans du faubourg Saint-Antoine formule cette nécessité pratique. « Combien de personnes dans l’impuissance d’acheter des ouvrages neufs, ou qui n’en ayant besoin que pour peu de temps, ne les veulent point de la meilleure qualité et viennent les chercher dans le faubourg où on les leur vend tels qu’ils le souhaitent, mais où il ne seroit plus possible de les contenter si les ouvriers étoient dans l’obligation de suivre les règlemens des communautez de Paris, s’ils étoient assujettis à la visite de jurez. » [5] Le privilège, en d’autres termes, permettait au faubourg de satisfaire les besoins des basses classes de la population parisienne, auxquels l’exigence de qualité du système corporatif ne pouvait convenir.
Le faubourg, lieu d’innovations
Agacés par les procès permanents, les artisans audacieux rejoignent très vite le faubourg Saint-Antoine pour développer des innovations que les statuts corporatifs interdisent. Leur effort est favorisé par l’intervention croissance de financiers, qui perçoivent l’intérêt de miser sur des expérimentations innovantes pouvant ensuite être écoulées, soit légalement, à l’étranger, soit illégalement, dans le reste du pays. L’apport capitalistique extérieur apparaît d’autant plus crucial que les ouvriers sans qualité manquent souvent de fonds pour concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales. Il autorise en outre l’introduction rapide de la mécanisation dans la fabrication textile et l’établissement de manufactures.
Les nombreuses requêtes envoyées depuis le faubourg Saint-Antoine pour obtenir un privilège du Bureau de Commerce pour l’exploitation d’un nouveau produit ou d’une nouvelle technique, témoignent du goût pour l’innovation et de la mentalité entrepreneuriale de ses habitants. Elles ne renseignent pourtant que sur la partie visible de l’iceberg, laissant dans l’ombre les histoires infiniment plus nombreuses d’échecs ou d’abandons.
L’innovation constante anime l’économie du faubourg Saint-Antoine et concourt, de même que la qualité des produits et la largeur de gamme proposée, à attirer en masse la clientèle parisienne.
Succès des produits du faubourg hors des frontières de celui-ci
En tant que clients, les Parisiens ont aussi « voté avec leurs pieds », rendant un verdict historique en faveur de la liberté du travail et de l’industrie.
Comme nous l’avons vu, les accusations sur les « faux ouvriers » produisant des mauvaises marchandises sont sans fondement. Aucune preuve n’est à ce titre plus forte que l’afflux considérable de clients parisiens dans le faubourg, pour se fournir des productions les plus diverses.
Leur déplacement n’était d’ailleurs pas interdit, car si les artisans du faubourg Saint-Antoine ne pouvaient en aucun cas sortir de leur lieu privilégié, rien n’empêchait (formellement) les habitants du reste de la capitale de venir visiter leurs boutiques du faubourg.
À la vue des masses d’individus qui venaient dans le faubourg pour consommer, il fallait se rendre à l’évidence des bons effets de la liberté. Le public est la dupe de la liberté du travail, qui est la liberté de mal faire, disaient les maîtres des corporations. Il faut convenir, répondaient les habitants du faubourg, qu’il « n’est pas si mauvais connaisseur qu’on se le persuade peut-être ; c’est sa voix qu’il faut écouter dans les affaires qui le regardent, et s’il n’était pas plus souvent trompé par les Maîtres de Paris qu’il ne l’est pas les ouvriers du faubourg, ceux-ci n’auraient pas tant d’occupations. » [6] Et n’était-ce pas délicieux d’observer que les mêmes maîtres, si adversaires, en public, du privilège du faubourg, venaient eux aussi y faire leurs achats et y commander des ouvrages ? La pratique, très répandue, est bien documentée. « Tout le monde ou presque tire en réalité profit du privilège du faubourg Saint-Antoine, écrit Alain Thillay. Les maîtres parisiens s’arrangent avec ceux du faubourg, les premiers protègent parfois les seconds ou bien les ouvriers en chambre auxquels ils confient la production d’objets plus ou moins réglementaires. Ils s’associent ou commercent ensemble en permanence. » [7] Ultime preuve, s’il en était besoin, des bienfaits de la liberté du travail et de la réussite du modèle de libre marché que représentait le faubourg Saint-Antoine.
_______________________
[1] A.N., F12 781c, 10e dossier, Mémoire des ouvriers et artisans du faubourg Saint-Antoine, vers 1717
[2] Ibid.
[3] Hurtaut et Magny, Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, Paris, 1779, volume 4, p.194
[4] Remarques, p.195
[5] A.N., F12 781c, 10e dossier, Mémoire des ouvriers et artisans du faubourg Saint-Antoine, vers 1717
[6] Cité par Kaplan, La fin des corporations, Fayard, 2001, p.342
[7] Thillay, Le faubourg Saint-Antoine et ses « faux-ouvriers ». La liberté du travail aux XVIIe et XVIIIe siècles, Champ Vallon, 2002, p.254
V. Un modèle contre le système réglementaire
Offrant un contraste parfait avec l’environnement hyper-réglementé du reste de la capitale, le faubourg Saint-Antoine ne pouvait manquer de concentrer sur lui les plaintes et les espoirs des adversaires et des défenseurs de la liberté du travail. Pour les uns, le faubourg était le symbole de l’anarchie économique où est artisan qui veut, où les hiérarchies n’existent plus, et où l’on suit avec empressement les goûts des consommateurs et les modes, plutôt que les anciens usages et les règlements. Pour les autres, le développement économique remarquable du faubourg Saint-Antoine préfigurait la prospérité que connaîtrait la France, quand elle romprait avec les tracasseries règlementaires et la police corporative.
Épouvantail pour les interventionnistes
Lorsque les économistes commencent leur croisade contre les corporations, celles-ci ne trouvent d’autre réponse que de poursuivre leur incrimination du faubourg Saint-Antoine. « C’est là que se vend tout ce qui est mal fabriqué, disent les blondiniers-boutoniers. C’est là que l’ouvrier ne consultant que le besoin de vivre, travaille toute la semaine pour aller le samedi de nuit trouver des acheteurs à qui il donne à bon marché ce qu’il a fait à la hâte et sans précaution. » [1] Les maîtres parisiens craignent surtout que la mode de la liberté du travail ne se répande, et que leurs apprentis et compagnons les abandonnent en masse pour venir goûter, eux aussi, au rêve du faubourg. Qui voudrait peiner cinq, dix ou quinze ans, se ruiner pour acquérir un titre de maîtrise, si, en changeant de quartier, il pouvait devenir maître sans condition, et s’intégrer dans un éco-système florissant ?
Lorsque les arguments libéraux finirent par emporter l’assentiment et que Turgot se prépara à abolir purement et simplement les corporations, les maîtres parisiens se servirent du faubourg comme d’un épouvantail. « Tout Paris sera le faubourg Saint-Antoine, point de talent, point de solidité, beaucoup d’intrigues, nulle réalité dans les fortunes, point de confiance qui n’est attachée qu’à un établissement solide. » [2] Mais l’affaire était entendue, et par un édit appelé à devenir célèbre, Turgot abolit les corps de métier, permettant à tous les habitants de travailler librement.
Modèle pour les libéraux
En 1776, si les maîtres parisiens présentent le faubourg Saint-Antoine comme un épouvantail, les libéraux en font un modèle capable d’emporter la conviction des indécis. Assurément, l’argument du succès économique des faubourgs disposant de privilèges n’était pas nouveau. Dans son mémoire sur les corporations daté de 1753, Vincent de Gournay rappelait déjà le destin des migrants français qui, après avoir fuit les rigueurs de la police corporative, « formèrent à Londres un faubourg connu sous le nom de Spintefield, où se fabriquent les plus belles étoffes de soie, d’or et d’argent. On ne leur demanda pas s’ils étaient maîtres et s’ils avaient fait leur apprentissage ; on laissa fabriquer qui voulut, et à l’abri de cette liberté ils firent bientôt des élèves qui égalèrent et surpassèrent leurs maîtres. » [3]
De ce point de vue, le faubourg Saint-Antoine n’est rien d’autre qu’un énième exemple, un exemple français, des succès des lieux de travail privilégié. Il doit servir, selon les promoteurs de la liberté du travail, à rassurer sur les effets à attendre de la destruction du système réglementaire. Ainsi Turgot, dans le préambule de son édit, fait-il lui-même usage de l’exemple du faubourg :
« Nous ne serons point arrêté dans cet acte de justice, par la crainte qu’une foule d’artisans n’usent de la liberté rendue à tous pour exercer des métiers qu’ils ignorent, et que le public ne soit inondé d’ouvrages mal fabriqués. La liberté n’a point produit ces fâcheux effets dans les lieux où elle est établie depuis longtemps. Les ouvriers des faubourgs et des autres lieux privilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux de l’intérieur de Paris. » [4]
Le faubourg Saint-Antoine est ainsi appelé à jouer un rôle majeur dans l’argumentaire libéral, parce qu’il prouve par l’exemple, par les faits, quand les écrits et les paroles s’avèrent incapables de vaincre tous les scepticismes. Dans une science où les expériences de laboratoires sont impossibles, le résultat d’un essai de liberté du travail présente un grand intérêt et se trouve logiquement mobilisé. C’est ainsi qu’en cette même année 1776, dans son ouvrage devenu classique, Adam Smith écrira : « C’est sans le moindre fondement qu’on a prétexté que les corporations étaient nécessaires pour le meilleur régime des métiers. La discipline véritable et efficace qui s’exerce sur un ouvrier, ce n’est pas celle de son corps, mais bien celle de ses pratiques. C’est la crainte de perdre l’ouvrage qu’elles lui donnent, qui prévient ses fraudes et corrige sa négligence. Une corporation exclusive diminue nécessairement la force de cette discipline. On vous oblige alors d’employer une classe particulière de gens, soit qu’ils se comportent bien ou mal. C’est pour cette raison que, dans plusieurs grandes villes de corporation, on ne trouve quelquefois pas d’ouvriers passables, même dans les métiers les plus indispensables. Si vous voulez avoir de l’ouvrage fait avec quelque soin, il faut le commander dans les faubourgs, où les ouvriers, n’ayant pas de privilège exclusif, ne peuvent compter que sur la bonne réputation qu’ils se font, et ensuite il faut le faire entrer du mieux que vous pouvez en contrebande dans la ville.» [5]
Conclusion
Modèle pour les économistes et réformateurs libéraux du siècle des Lumières, le destin remarquable du faubourg Saint-Antoine peut constituer une source d’inspiration pour notre époque. Ainsi que l’écrit Alain Thillay dans son étude, « en 150 ans, le faubourg Saint-Antoine est devenu une ruche ouvrière dans laquelle les artisans produisent et innovent, fabriquent des objets de qualité courante ou des produits d’art, collaborent entre eux ou travaillent sous l’emprise des marchands et des entrepreneurs. » [6] L’histoire de cette remarquable réussite de la liberté du travail peut soutenir les efforts de ceux qui s’efforcent de montrer pourquoi la liberté du travail est à la fois un impératif de justice et une cause majeure de prospérité pour tous, et en premier lieu pour les plus pauvres. En rappelant les miracles que peut accomplir la liberté, elle peut inciter les Français à l’aimer à nouveau.
Benoît Malbranque
_______________________
[1] B.N., Coll. Joly de Fleury, 462, fol. 108-11
[2] Ibid.
[3] Mémoire adressé à la Chambre de commerce de Lyon, février 1753, in Takumi Tusda (éd.), Mémoires et lettres de Vincent de Gournay, Tokyo, Kinokuniya, 1993, p.16
[4] Gustave Schelle, Œuvres de Turgot et documents le concernant, tome 5, p.243
[5] Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, traduction Germain Garnier, Paris, 1802
[6] Thillay, Le faubourg Saint-Antoine et ses « faux-ouvriers ». La liberté du travail aux XVIIe et XVIIIe siècles, Champ Vallon, 2002, p.159
1 commentaire
Trackbacks and pingbacks
Pas de rétrolien ou pingback disponible pour cet article

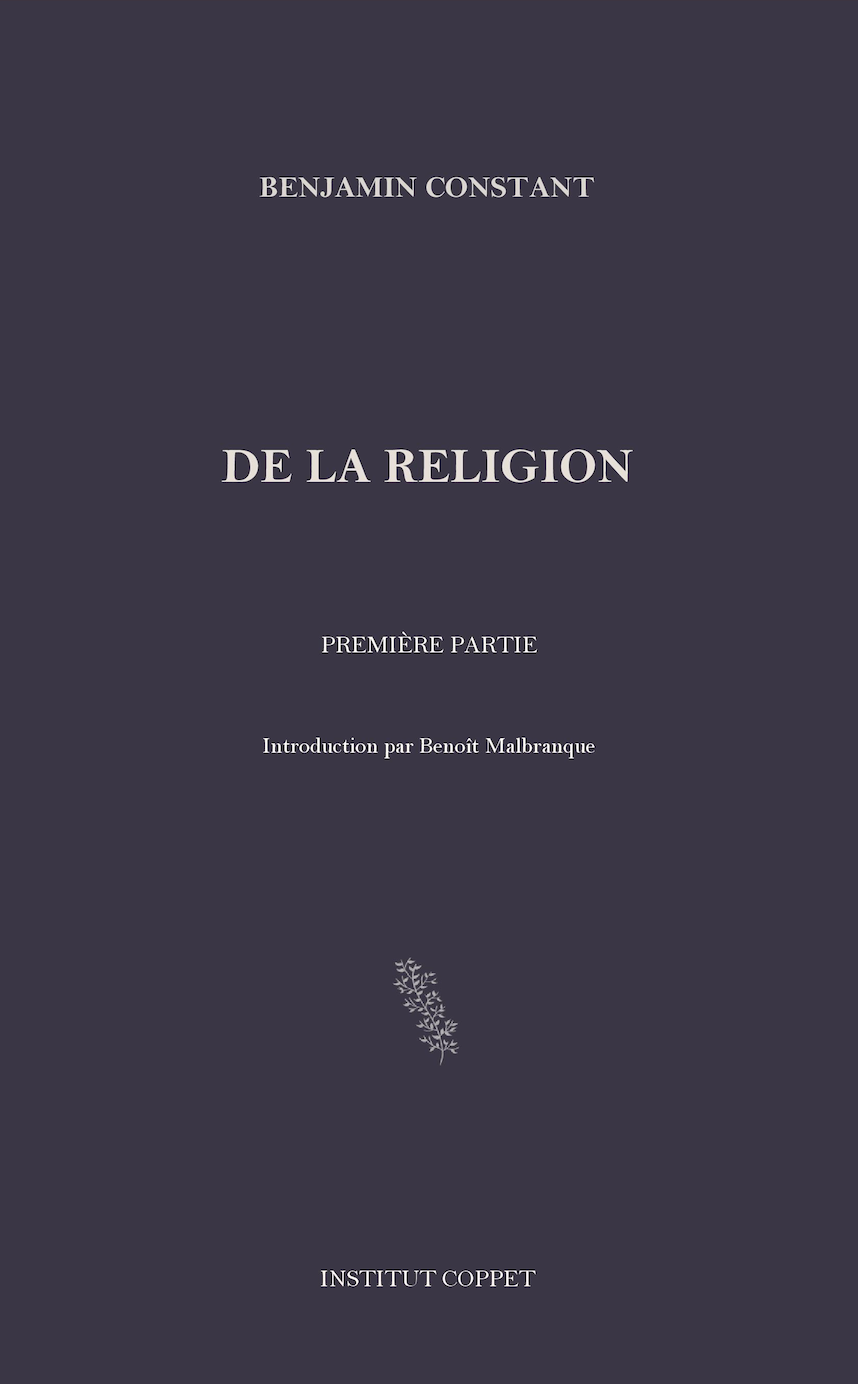
Passionnant
Merci