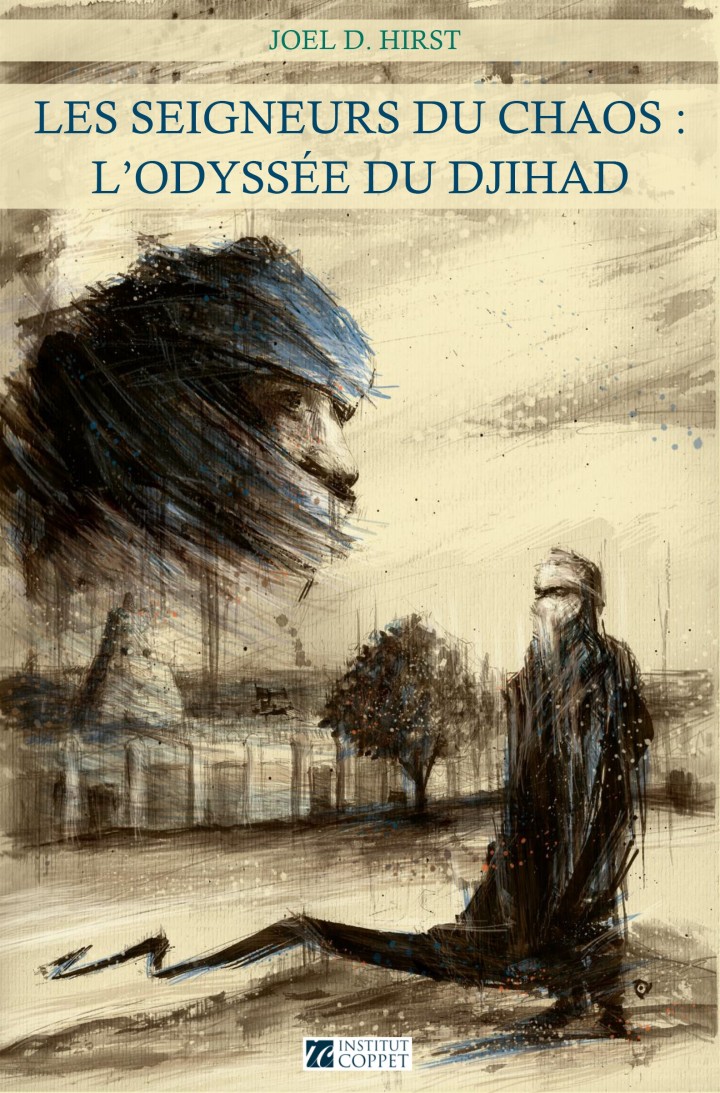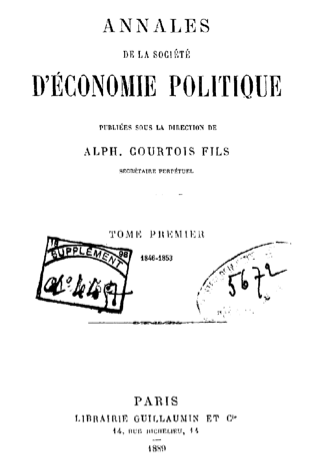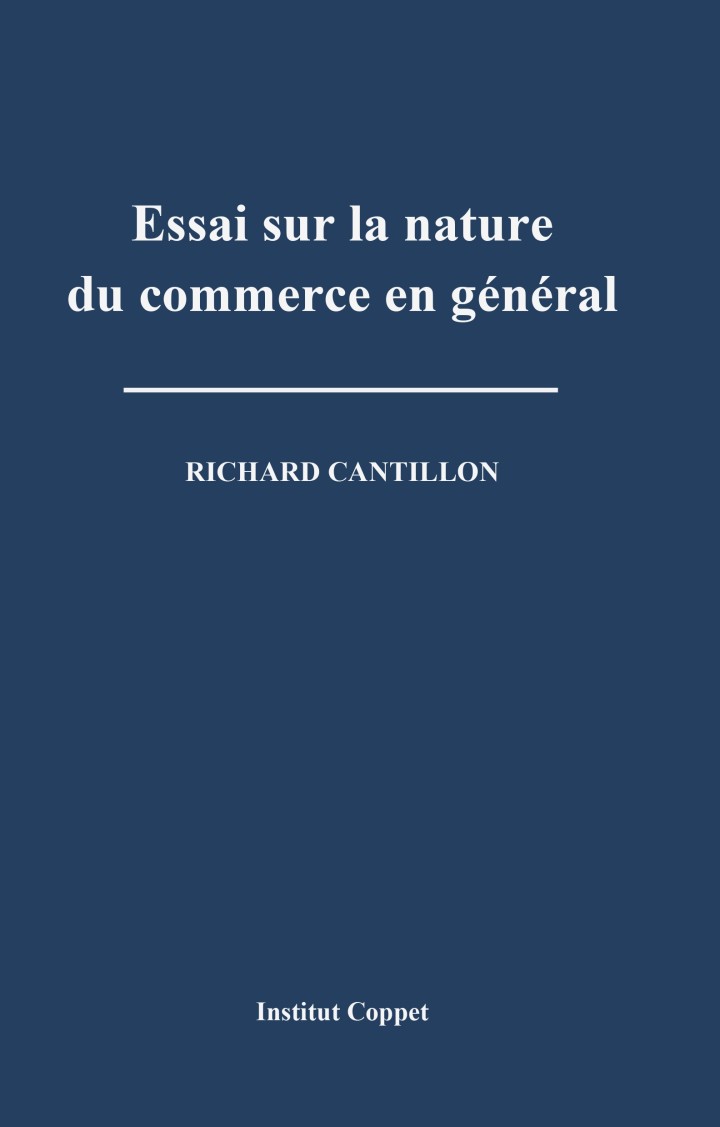Archive pour la ‘blog’ Catégorie
En 1848, la propriété privée est l’objet d’attaques virulentes, contre lesquelles se mobilisent les économistes de la Société d’économie politique. Bastiat écrit Propriété et Loi. Adolphe Thiers est un allié de taille dans cette lutte, lui qui est déjà auréolé d’une gloire certaine. Dans De la propriété, il prend la défense de ce principe maltraité. Dans le troisième chapitre de la première partie, il montre que la propriété est « un fait constant, universel dans tous les temps et dans tous les pays ». B.M.
Adolphe Thiers, De la propriété (1848) CHAPITRE III. DE L’UNIVERSALITÉ DE LA PROPRIÉTÉ.Que la propriété est un fait constant, universel dans tous les temps et dans tous les pays.
La méthode d’observation étant reconnue la seule bonne pour les sciences morales, aussi bien que pour les sciences physiques, j’examine d’abord la nature humaine dans tous les pays, dans tous les temps, à tous les états de civilisation, et partout je trouve la propriété comme un fait général, universel, ne souffrant aucune exception.
Les publicistes, dans le dernier siècle, voulant distinguer entre l’état naturel et l’état civil, se plaisaient à imaginer une époque où l’homme errait dans les forêts et les déserts, n’obéissant à aucune règle fixe, et une autre époque où il s’était aggloméré, réuni, et lié par des contrats appelés lois. On qualifiait du titre de droit naturel les conditions supposées de ce premier état, du titre de droit civil les conditions réelles et connues du second. C’est là une pure hypothèse, car l’homme n’a été découvert nulle part dans l’isolement, même parmi les sauvages les plus grossiers, les plus stupides de l’Amérique et de l’Océanie. De même que parmi les animaux il y en a qui, gouvernés par l’instinct, vivent en troupes, tels que les herbivores qui paissent en commun, tandis que les carnivores vivent isolés pour chasser sans rivaux, de même l’homme a toujours été aperçu en société. L’instinct, la première, la plus ancienne des lois, le rapproche de son semblable, et le constitue un animal sociable. Que ferait-il, s’il en était autrement, de ce regard intelligent par lequel il interroge et répond avant de savoir, parler ? Que ferait-il de cet esprit qui conçoit, généralise, qualifie les choses, de cette voix qui les désigne par des sons, de cette parole enfin, instrument de la pensée, lien et charme de la société ? Un être si noblement organisé, ayant le besoin et le moyen de communiquer avec ses semblables, ne pouvait être fait pour l’isolement. Ces tristes habitants de l’Océanie, les plus semblables aux singes que la création nous présente, consacrés à la pêche, la moins instructive de toutes les manières d’être pour l’homme, ont été trouvés rapprochés les uns des autres, vivant en commun, et communiquant entre eux par des sons rauques et sauvages.
Toujours encore on a trouvé l’homme ayant sa demeure particulière, dans cette demeure sa femme, ses enfants, formant de premières agglomérations qu’on appelle familles, lesquelles juxtaposées les unes aux autres, forment des rassemblements ou peuplades, qui, par un instinct naturel, se défendent en commun, comme elles vivent en commun. Voyez les cerfs, les daims, les chamois paissant tranquillement dans les belles clairières de nos forêts européennes, ou bien sur les plateaux verdoyants des Alpes et des Pyrénées : qu’un souffle d’air porte à leurs sens si fins un son qui les avertisse, ils donnent de la voix ou du pied un signe d’émotion, qui à l’instant se communique à la troupe, et ils fuient en commun, car leur défense est dans la merveilleuse légèreté de leurs jambes. L’homme, né pour créer et braver le canon, l’homme au lieu de fuir, se jette sur les armes plus ou moins perfectionnées qu’il a imaginées, prend un bois à l’extrémité duquel il place une pierre tranchante, et, armé de cette lance, grossière, se serre à son voisin, fait tête à l’ennemi, résiste ou cède tour à tour, suivant la direction qu’il reçoit du plus adroit, du plus hardi des membres de la peuplade.
Tous ces actes s’accomplissent d’instinct, avant qu’on ait rien écrit ni sur les lois ni sur les arts, avant qu’on soit convenu de rien. Les règles instinctives de cet état primitif, les plus rudimentaires de toutes, les plus générales, les plus nécessaires, peuvent bien être appelées droit naturel. Or la propriété existe dès ce moment, car on n’a jamais vu que, dans cet état, l’homme n’eût pas sa cabane ou sa tente, sa femme, ses enfants, avec quelques accumulations des produits, de sa pêche, de sa chasse ou de ses troupeaux, en forme de provisions de famille. Et si un voisin ayant des instincts précoces d’iniquité veut lui ravir quelques-uns des biens modestes composant son avoir, il s’adresse à ce chef plus fort, plus adroit, autour duquel il a pris l’habitude de se ranger pendant le combat, lui demande redressement, protection, et celui-ci prononce en raison des notions de justice développées dans la peuplade.
Chez tous les peuples, quelque grossiers qu’ils soient, on trouve donc la propriété, comme un fait d’abord, et puis comme une idée, idée plus ou moins claire suivant le degré de civilisation auquel ils sont parvenus, mais toujours invariablement arrêtée. Ainsi le Sauvage chasseur a du moins la propriété de son arc, de ses flèches, et du gibier qu’il a tué. Le nomade qui est pasteur, a du moins la propriété de ses tentes, de ses troupeaux. Il n’a pas encore admis celle de la terre, parce qu’il n’a pas encore jugé à propos d’y appliquer ses efforts. Mais l’Arabe qui a élevé de nombreux troupeaux, entend bien en être le propriétaire, et vient en échanger les produits contre le blé qu’un autre Arabe, déjà fixé sur le sol, a fait naître ailleurs. Il mesure exactement la valeur de l’objet qu’il donne contre la valeur de celui qu’on lui cède, il entend bien être propriétaire de l’un avant le marché, propriétaire du second après. La propriété immobilière n’existe pas encore chez lui. Quelquefois seulement, on le voit pendant deux ou trois mois de l’année se fixer sur des terres qui ne sont à personne, y donner un labour, y jeter du grain, le recueillir, puis s’en aller en d’autres lieux. Mais pendant le temps qu’il a employé à labourer, à ensemencer cette terre, à la moissonner, le nomade entend en être le propriétaire, et il se précipiterait avec ses armes sur celui qui lui en disputerait les fruits. Sa propriété dure en proportion de son travail. Peu à peu cependant le nomade se fixe et devient agriculteur, car il est dans le cœur de l’homme d’aimer à avoir son chez-lui, comme aux oiseaux d’avoir leurs nids, à certains quadrupèdes d’avoir leurs terriers. Il finit par choisir un territoire, par le distribuer en patrimoines où chaque famille s’établit, travaille, cultive pour elle et sa postérité. De même que l’homme ne peut laisser errer son cœur sur tous les membres de la tribu, et qu’il a besoin d’avoir à lui sa femme, ses enfants, qu’il aime, soigne, protège, sur lesquels se concentrent ses craintes, ses espérances, sa vie enfin, il a besoin d’avoir son champ, qu’il cultive, plante, embellit à son goût, enclôt de limites, qu’il espère livrer à ses descendants couvert d’arbres qui n’auront pas grandi pour lui, mais pour eux. Alors à la propriété mobilière du nomade succède la propriété immobilière du peuple agriculteur ; la seconde propriété naît, et avec elle des lois compliquées, il est vrai, que le temps rend plus justes, plus prévoyantes, mais sans en changer le principe, qu’il faut faire appliquer par des juges et par une force publique. La propriété résultant d’un premier effet de l’instinct, devient une convention sociale, car je protège votre propriété pour que vous protégiez la mienne, je la protège ou de ma personne comme soldat, ou de mon argent comme contribuable, en consacrant une partie de mon revenu à l’entretien d’une force publique.
Ainsi l’homme insouciant d’abord, peu attaché au sol qui lui offre des fruits sauvages ou de nombreux animaux à dévorer, sans qu’il ait beaucoup de peine à se donner, s’assied à cette table chargée de mets naturels, et où il y a place pour tous, sans jalousie, sans dispute, tour à tour s’y asseyant, la quittant, y revenant comme à un festin toujours servi par un maître libéral, maître qui n’est autre que Dieu lui-même. Mais peu à peu il prend goût à des mets plus recherchés ; il faut les faire naître ; il commence à y tenir parce qu’ils valent mieux, parce qu’il a fallu beaucoup travailler pour les produire. Il se partage ainsi la terre, s’attache fortement à sa part, et si des nations la lui disputent en masse il combat en corps de nation ; si dans l’intérieur de la cité où il vit, son voisin lui dispute sa parcelle, il plaide devant un juge. Mais sa tente et ses troupeaux d’abord, sa terre et sa ferme ensuite, attirent successivement ses affections, et constituent les divers modes de sa propriété.
Ainsi à mesure que l’homme se développe, il devient plus attaché à ce qu’il possède, plus propriétaire en un mot. À l’état barbare, il l’est à peine ; à l’état civilisé, il l’est avec passion. On a dit que l’idée de la propriété s’affaiblissait dans le monde. C’est une erreur de fait. Elle se règle, se précise, et s’affermit loin de s’affaiblir. Elle cesse, par exemple, de s’appliquer à ce qui n’est pas susceptible d’être une chose possédée, c’est-à-dire à l’homme, et dès ce moment l’esclavage cesse. C’est un progrès dans les idées de justice, ce n’est pas un affaiblissement dans l’idée de la propriété. Par exemple encore le seigneur pouvait seul dans le Moyen âge tuer le gibier, nourri sur la terre de tous. Quiconque aujourd’hui rencontre un animal sur sa terre le peut tuer, car il a vécu chez lui. Chez les anciens la terre était la propriété de la République ; en Asie elle est celle du despote ; dans le Moyen âge elle était celle des seigneurs suzerains. Avec le progrès des idées de liberté, en arrivant à affranchir l’homme on affranchit sa chose ; il est déclaré, lui, propriétaire de sa terre, indépendamment de la République, du despote ou du suzerain. Dès ce moment la confiscation se trouve abolie. Le jour où on lui a rendu l’usage de ses facultés, la propriété s’est individualisée davantage, elle est devenue plus propre à l’individu lui-même, c’est-à-dire plus propriété qu’elle n’était.
Autre exemple. Dans le Moyen âge, ou dans les États despotiques, on concédait à l’homme la surface de la terre, mais on ne lui en accordait pas le fond. Le droit de creuser des mines était un droit régalien, qu’on déléguait à prix d’argent, et temporairement, à quelques extracteurs de métaux. Avec le progrès du temps on a compris que l’intérieur de la terre pouvant être le théâtre d’un travail nouveau, devait devenir le théâtre d’une propriété nouvelle, et on a constitué la propriété des mines, de façon qu’aujourd’hui il y a deux propriétés sur la terre, une au-dessus, celle du laboureur, une au-dessous, celle du mineur.
La propriété est donc un fait général, universel, croissant et non décroissant. Les naturalistes en voyant un animal qui, comme le castor ou l’abeille, construit des demeures, déclarent sans hésiter que l’abeille, le castor sont des animaux constructeurs. Avec le même fondement, les philosophes, qui sont les naturalistes de l’espèce humaine, ne peuvent-ils pas dire que la propriété est une loi de l’homme, qu’il est fait pour la propriété, qu’elle est une loi de son espèce ! Et ce n’est pas dire assez que de prétendre qu’elle est une loi de son espèce, elle est celle de toutes les espèces vivantes. Est-ce que le lapin n’a pas son terrier, le castor sa cabane, l’abeille sa ruche ? Est-ce que l’hirondelle, joie de nos climats au printemps, n’a pas son nid qu’elle retrouve, qu’elle n’entend pas céder ; et si elle avait le don de la pensée, ne serait-elle pas révoltée elle aussi des théories de nos sophistes ? L’animal qui pâture, vit paisiblement en troupe, comme les nomades du désert, dans certains pâturages dont il ne s’éloigne jamais, car chez lui la propriété se manifeste par l’habitude. Le carnassier, le lion, semblable au Sauvage chasseur, ne peut pas vivre en troupe, il se nuirait ; il a un arrondissement de destruction, où il entend habiter seul, et d’où il expulse tout autre carnassier qui voudrait partager son gibier. Lui aussi, s’il savait penser, il se proclamerait propriétaire. Et, revenant à l’homme, regardez l’enfant, gouverné par l’instinct non moins que l’animal ! Voyez avec quelle naïveté se révèle chez lui le penchant à la propriété ! J’observe quelquefois un jeune enfant, héritier unique d’une fortune considérable, comprenant déjà qu’il n’aura point à partager avec d’autres frères le château où sa mère le conduit tous les étés, se sachant donc seul propriétaire du beau lieu où s’écoule son enfance ; eh bien ! à peine arrivé, il veut dans ce château même avoir son jardin, où il cultivera des légumes qu’il ne mangera point, des fleurs qu’il ne songera point à cueillir, mais où il sera maître, maître dans un petit coin du domaine, en attendant qu’il le soit du domaine tout entier !
Après avoir vu dans tous les temps, dans tous les pays, l’homme s’approprier tout ce qu’il touche, d’abord son arc et ses flèches, puis sa terre, sa maison, son palais, instituer constamment la propriété comme prix nécessaire du travail, si on raisonnait pour lui ainsi que Pline ou Buffon l’ont fait pour les animaux, on n’hésiterait pas à déclarer, après avoir observé une manière d’être si générale, que la propriété est une loi nécessaire de son espèce. Mais cet animal n’est pas un animal ordinaire, il est roi, roi de la création, comme on aurait dit jadis, et on lui conteste ses titres : on a raison, il faut les examiner de plus près. Le fait, dit-on, n’est pas le droit ; la tyrannie aussi est un fait, un fait très général. Il faut donc prouver que le fait de la propriété est un droit, et en mérite le titre. C’est déjà beaucoup du reste d’avoir montré que ce fait est croissant au lieu d’être décroissant, car la tyrannie s’affaiblit, disparaît au lieu de s’étendre. Toutefois poursuivons, et vous verrez que ce fait est le plus respectable, le plus fécond de tous, le plus digne d’être appelé un droit, car c’est par lui que Dieu a civilisé le monde, et mené l’homme du désert à la cité, de la cruauté à la douceur, de l’ignorance au savoir, de la barbarie à la civilisation.
Francis Richard vient de publier une recension du roman de Joel Hirst, Les seigneurs du chaos : l’odyssée du djihad. Nous la republions ici en le remerciant et en invitant nos lecteurs à découvrir ce livre.
Les seigneurs du chaos: l’odyssée du djihad, de Joel D. HirstComment expliquer qu’un jeune Touareg devienne un jour djihadiste? Qu’un jeune homme bleu, nomade du désert, devienne un jour sédentaire d’une cité? C’est, sous la forme romanesque, ce que raconte, avec toute sa connaissance du terrain, Joel D. Hirst dans Les seigneurs du chaos.
Le roman savant a l’avantage sur l’essai de personnaliser ce qui se passe dans la tête des protagonistes et, ce faisant, de l’humaniser en quelque sorte, autrement dit de le rendre compréhensible, sinon acceptable.
Le roman de Joel Hirst commence par l’épilogue de cette tragédie: Aliuf Ag Albachar, le Touareg de l’histoire, va mourir. Il a cru naïvement qu’était enfin venue l’heure de l’Azawad, cette terre mystique qui n’existait que dans l’imagination de son peuple.
Pour y parvenir, tombant dans le travers humain, trop humain, de vouloir imposer des idées aux autres par la force, il s’est tourné vers la violence; mais il existe toujours quelqu’un de plus violent. Comme il existe toujours dans les révolutions, serait-on tenté d’ajouter, un plus pur que le pur qui, à son tour, l’épure.
Tombouctou, la cité légendaire, a été fondée par le peuple touareg, qui s’en est retiré quand elle est devenue une ville animée. Les Touaregs l’ont en effet laissée aux grands empires noirs qui les ont remerciés en les opprimant, c’est-à-dire en faisant fi de leur fierté et de leur indépendance.
Quand Aliuf se rend avec sa mère à Tombouctou pour obtenir des papiers nécessaires pour aller à Tamanrasset, depuis une dune qui domine la ville, il prie silencieusement: Que Dieu me donne cette ville un jour et je la ferais servir à sa gloire.
Dans Tombouctou, Aliuf fait la rencontre de Salif, un noir dont le père est Peul et la mère Bozo. Salif, pour se désennuyer, cherche aux autres des ennuis. C’est ainsi qu’il passe à tabac Aliuf. A la troisième rencontre – c’est masculin -, ils sont amis.
Cette amitié, quelque temps plus tard, va faire basculer le destin d’Aliuf. En portant secours à Salif sur la route de Taoudeni, il va tuer deux soldats maliens et devenir fugitif avec lui. Grâce à ses relations, ils trouvent refuge à Tamanrasset.
Leurs chemins se séparent alors. Sous l’influence de Yattara, qui habite sous le même toit qu’eux, Salif devient combattant djihadiste, tandis qu’Aliuf refuse de les suivre, non pas par lâcheté, mais parce qu’il doute que ce soit la volonté d’Allah.
Pour savoir quelle est la volonté d’Allah, Aliuf va voir le vieil Imam de la mosquée fréquentée par Salif. Youness vient vers lui après avoir entendu leur conversation. De lui il apprend que, pour accomplir, la volonté d’Allah, il existe une autre voie que celle du djihad, celle de l’esprit.
Aliuf part donc pour Marrakech. Là-bas il reçoit l’enseignement de l’Imam Bouchtat. L’authentique musulmane attitude peut se résumer à cette phrase extraite d’un de ses cours: Il ne nous appartient pas de penser ou d’analyser, seulement de suivre.
Ce rejet de la philosophie spéculative, de la dialectique, du kalam, Issam Bouchtat l’exprime plus loin avec force, après qu’Aliuf a évoqué les enseignements multi-séculaires des grands philosophes et mystiques de son peuple, à Tombouctou, la ville des 333 saints:
Tout ce que vous pensez savoir, toutes les idées qui vous sont présentées comme la vérité sont les tentatives faites par les hommes pour interpréter le message de Dieu. Ils refusent d’accepter que leur devoir n’est pas d’interpréter, mais de lire, de comprendre et d’obéir.
Aliuf devient un sage religieux. Toutefois il est homme et ce sont des motifs personnels qui vont le faire d’abord se tourner vers la violence, puis s’en détourner, tant il est vrai qu’un homme n’agit pas seulement avec sa raison, mais avec son coeur.
Dans sa préface Benoît Malbranque, en guise de conclusion, écrit à propos du djihad: Par sa violence terrible, il nous épouvante et nous paraît irrationnel: car comment, autrement que par la folie, l’horreur associée au djihad pourrait-elle être commise? Mais le djihad a aussi ses racines, matérielles et intellectuelles, que ce roman essaye d’illustrer et de présenter.
On ne saurait mieux dire.
Francis Richard
Les seigneurs du chaos: l’odyssée du djihad, Joel D Hirst, 348 pages (traduit de l’anglais par M. Lassort et B. Malbranque) Institut Coppet
Sous l’Ancien régime, la corvée était un impôt en nature touchant toute la population, mais dont la noblesse et le clergé s’exonéraient naturellement, et qui ne touchait donc que le bas peuple. Suite à son instauration, chaque habitant pouvait se voir contraint de partir travailler plusieurs jours, en nombre variable, pour la construction ou la réparation des routes à proximité de son lieu de résidence, et cela sans toucher le moindre salaire ni même la moindre compensation pour le travail des champs qu’il abandonnait ainsi que sa famille.
Les chemins faits avec la corvée l’étaient mal. Elle aboutissait à des constructions incomplètes, fragiles, mal ordonnées, mal exécutées. Étaient à blâmer les décisions incohérentes des directeurs, mais surtout le peu d’entrain que les paysans mettaient à ce travail, dont ils ne tiraient aucun salaire, et qu’ils effectuaient à contrecœur, tandis qu’ils devaient s’occuper de leur famille et de leur champ. Les paysans perdaient du temps sur les chantiers à attendre les décisions, à attendre les matières premières, et même à s’attendre mutuellement. Or les paysans partis construire les routes laissaient leurs champs, parfois à des périodes où leur attention et leur vigilance devaient être totales pour garantir la récolte.
Du fait de cet impôt en nature, les ouvriers travaillant sur les routes étaient totalement incapables d’y mettre un quelconque savoir-faire : le résultat était grossier, plein d’imperfections, d’autant que leur intérêt personnel les incitait à en faire le moins possible. Qui songe à produire le plus bel ouvrage s’il n’est pas payé ? Qui songe même à fournir le plus d’effort possible ? Qui s’y applique avec la plus grande vigilance ? Certainement, le nombre des bons citoyens s’y livrant avec sérieux et entrain était peu nombreux. « La corvée, écrit Vignon dans son étude de référence sur le sujet, était commandée avec mollesse, mal conduite, sujette à mille abus, insuffisante à continuer ou seulement à conserver les ouvrages commencés, et complètement décriée. » (Eugène-Jean Marie Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1862, tome III, p.54)
Le système des corvées, quels qu’aient pu être par ailleurs ses résultats pratiques, était indéfendable. Il était d’abord rempli d’inégalités. Le poids de la corvée n’était d’abord pas égal à travers le territoire : dans quelques régions, on devait trois journées, dans d’autres quatre ou cinq ; dans certaines, on n’était quitte qu’après douze journées à travailler sans salaire. Ensuite, et c’est primordial, ceux qui profitaient les premiers de la qualité des routes et des chemins étaient évidemment ceux qui s’en servaient, les commerçants, les industriels, mais aussi les grands propriétaires, qui allaient et venaient constamment entre Paris et leur domicile de campagne. Or, précisément, tous ces gens étaient exemptés de la corvée. Par un curieux arrangement, l’exemption touchait également ceux qu’on pouvait appeler les protégés du syndic, c’est-à-dire de l’homme, paysan lui-même, qui était chargé de répartir le travail entre la population d’une localité. Or encore une fois, peu habitué à détenir un tel pouvoir, le syndic en usait mal.
Dans le premier article qu’il offre aux Éphémérides du Citoyen, Dupont de Nemours dresse le procès de la corvée du point de vue économique, mais aussi moral. Il précise ses idéaux de réforme et salue la grande avancée effectuée à Caen par Fontette, et à Limoges par Turgot, pour l’amélioration de ce système funeste pour l’agriculture et la richesse de la France. B.M.
Dupont de Nemours, « De l’administration des chemins », Éphémérides du Citoyen, 1767, tome V, p.131-213 ; réédité en brochure en 1767 (Pékin et Paris).
ÉPHÉMÉRIDES DU CITOYEN, ou BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.1767. TOME CINQUIÈME.
TROISIÈME PARTIE.
ÉVÉNEMENTS PUBLICS.
N°. Premier. Essais de réforme dans l’Administration des Chemins.Parmi les objets que le Gouvernement a pris à cœur, pour soulager le Peuple et pour augmenter l’aisance des Cultivateurs, aujourd’hui reconnue comme unique source de la richesse nationale, un des plus importants sans doute, est l’essai qu’on a fait dans quelques Provinces de l’abolition des corvées, et d’une nouvelle Administration des grandes Routes.
On doit les premières idées de cette réformation, à l’Ami des Hommes, qui s’est élevé fortement contre l’ancien système ; mais parmi les Administrateurs, deux Magistrats distingués par leurs lumières et par leur patriotisme, M. de F*** Intendant de C**, et M. T** Intendant de L.*** ont la gloire d’avoir mis les premiers en usages à cet égard, des principes plus analogues à ceux de la Science économique ; leur exemple a fait naître l’émulation, et plusieurs s’empressent de connaître leurs procédés pour les imiter. L’écrit qu’on va lire, expose la théorie fondamentale de l’Administration des chemins, les préjugés spécieux, qui ont fait oublier cette théorie, les inconvénients que ces préjugés ont produits, et enfin la pratique nouvellement introduite dans quelques Généralités, dont l’effet doit conduire naturellement, et par degrés, à l’observation des vraies règles, desquelles, malgré les meilleures intentions, on s’était malheureusement si fort éloigné, par une erreur involontaire.
Nos Lecteurs verront que ce petit Ouvrage est d’un Auteur connu par son zèle pour la Science morale et politique. C’est le premier dont il ait orné notre Recueil ; mais nous espérons que ce ne sera pas le dernier.
***
Præfectis per omnes Provincias imperavit, ne Agriculturam impedirent unquam alio laborum genere vexando Agricolas, ut largam ubique annonam procurarent.
Lex Xuni, in Historia Sina Martini Martinii Decade primâ, p.45.
Pour avoir partout une récolte abondante, il défendit aux Intendants des Provinces, de jamais exiger des Cultivateurs aucune espèce de travaux qui pût les détourner de l’Agriculture.
Loi de XUN, huitième Empereur de la Chine, qui vivait 240 ans avant Moïse. Il y a 4024 ans, que cette Loi est perpétuellement exécutée à la Chine ; ce qui n’a pas peu contribué, sans doute, à la prospérité de ce grand Empire.
DE L’ADMINISTRATION DES CHEMINS.
Par M. DU PONT, des Sociétés Royales d’Agriculture de Soissons et d’Orléans, et Correspondant de la Société d’Émulation de Londres.
CHAPITRE PREMIER.
Principes généraux sur l’Administration des Chemins.
Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur l’utilité des chemins : on sait assez que sans eux il ne pourrait presque point se faire de commerce ; que sans commerce il n’y aurait point de communication de secours réciproques entre les hommes, point d’équilibre entre les prix, une immense quantité de productions existantes et de productions possibles perdues pour l’humanité, une vicissitude perpétuelle entre la misère de l’abondance et celle du besoin.
L’avantage le plus direct et le plus sensible des chemins est pour les propriétaires des terres. Le produit net de la culture, qui leur appartient, est de toutes les richesses renaissantes, celle sur laquelle la facilité des chemins a le plus d’influence. La concurrence qui se trouve entre les Cultivateurs les force de tenir compte aux Propriétaires de tout l’accroissement de produit net que procure l’augmentation de débit et de prix à la vente de la première main, qui résulte de la diminution des frais de commerce. On peut donc regarder les chemins comme une sorte de propriété commune, nécessaire et indispensable, pour que l’on puisse faire valoir les propriétés particulières des possesseurs du territoire. La construction des chemins augmente donc la valeur des propriétés ; elle est donc une charge des propriétaires, car la dépense doit être pour ceux qui retirent le profit.
Cette dépense est une des dépenses publiques, une de celles pour laquelle le Gouvernement lève l’impôt. Toutes les dépenses publiques sont aussi des charges de propriétaires. Elles le sont dans le droit ; car elles tournent toutes au plus grand profit des propriétaires, par la loi de la concurrence, qui oblige tous les autres Citoyens à se borner à leur rétribution et à la rentrée de leurs avances. Elles le sont dans le fait ; car, en vain croirait-on en charger les Cultivateurs ou les Artisans : les premiers ne donnent de revenu aux possesseurs des terres, qu’après s’être remboursé de l’impôt qu’ils ont été contraints d’avancer, et les seconds font payer leur taxe à ceux qui payent leur salaire.
Lors donc que les fonds publics ne suffisent pas aux dépenses publiques, et que le Gouvernement est obligé de demander une addition d’impôt pour compléter le service dont il est chargé ; il ne peut, non plus que pour les contributions ordinaires, s’adresser qu’aux possesseurs du produit net du territoire.
Il y a pour cela deux moyens. L’un est de s’adresser en effet à eux directement : et par ce moyen les Propriétaires ne payent précisément que la somme dont le Gouvernement a besoin, celui-ci dépense tout ce qu’il a reçu ; l’ordre des travaux, celui de la reproduction, celui des salaires restent dans le même état ; les autres classes de Citoyens ne s’aperçoivent seulement pas par qui a été faite la dépense du revenu. Le second moyen est de ne s’adresser qu’indirectement aux Propriétaires, en s’adressant directement à quelque autre ordre de Citoyens : et par ce moyen le Gouvernement ne reçoit pas davantage, les Propriétaires payent beaucoup plus, les travaux utiles qu’exécutent ceux à qui l’on s’adresse sont interrompus, la reproduction des denrées et des richesses diminue, l’humanité entière souffre une perte sur ses jouissances qui amène l’extinction d’une partie de la population.
Lorsque les circonstances permettront de faire un arrangement solide et fondamental pour la construction et l’entretien des chemins, il est donc évident que si l’impôt ordinaire ne suffit pas à cette dépense importante, essentielle, indispensable, ce devra être uniquement et directement les Propriétaires des terres qui seront tenus de fournir la contribution nécessaire.
Il est sans doute inutile de dire que si l’on avait un corps nombreux d’hommes entretenus aux dépens du Public, consacrés au service public, et néanmoins presque inoccupés pour le Public : ce corps semblerait désigné par sa nature à exécuter ce travail public.
Il est sans doute inutile de dire qu’une semi-paie au-dessus de leur paie ordinaire, qu’il paraîtrait juste de donner aux salariés de ce corps, lorsqu’on les emploierait au travail des chemins, leur procurerait une beaucoup plus grande aisance que celle dont ils jouissent, et en ferait néanmoins quant à cette partie de très bons ouvriers très peu couteux pour la Nation.
Il est sans doute inutile de dire que si ce corps de salariés était en même temps celui des défenseurs de la Patrie, il serait infiniment désirable pour eux, et par conséquent infiniment avantageux pour l’État qu’on leur formât pendant la paix une santé robuste par des travaux modérés, mais qui demandent de la vigueur et qui l’augmentent, par des travaux qui rendraient leurs corps et leurs bras endurcis dignes de seconder leur courage, et propres à soutenir les fatigues de la guerre, mille fois plus à craindre que ses dangers, pour les hommes qui ont été longtemps oisifs, dont le désœuvrement a toujours abattu les forces, et chez lesquels il a trop souvent été la première cause de maladies funestes.
Il est inutile de dire que c’est ainsi que les Romains formèrent ces redoutables Légionnaires auxquels ils durent la conquête de l’Univers, et avec lesquels ils construisirent ces chemins solides que nous admirons encore, qui traversaient l’Europe et l’Asie, et qui ont bravé l’injure des temps.
Ces faits évidents sont connus de tout le monde ; et si le temps n’est pas encore venu qu’ils doivent contribuer à diriger notre conduite que des circonstances particulières ont vraisemblablement décidée, au moins faut-il convenir, à la louange de notre siècle, que ce temps parait approcher avec rapidité.
Mais que l’on emploie les Soldats à la construction des ouvrages publics, comme on l’a fait à celle du Canal de Briare[1], ou qu’on ne les y emploie pas ; que l’on économise par ce moyen la dépense des chemins de manière à rendre la défense de l’État moins pénible, plus sure et moins coûteuse, ou que cette idée reste au rang de tant d’autres qu’on applaudit et qu’on néglige ; il n’en sera pas moins vrai que la construction et l’entretien des chemins formera toujours un article de dépense dont le profit sera pour les propriétaires du produit net de la culture, et dont la charge par conséquent ne peut et ne doit porter que sur eux ; il n’en sera pas moins vrai que l’on ne pourra leur imposer indirectement cette charge, non plus qu’aucune autre charge publique, sans une perte immense et inévitable pour eux et pour l’État.
En effet, il est évident que si les chemins sont mauvais, les frais du transport des productions, du lieu de leur naissance à celui de leur consommation, sont beaucoup plus considérables ; que si ces frais de transport sont considérables, le prix de la vente de la première main est d’autant plus faible ; que si le prix de la première vente des productions est faible, le cultivateur ne peut donner que peu de revenu au propriétaire.
Par la raison inverse, il est évident que la construction et l’entretien des chemins diminuent les frais de transport, assurent par conséquent aux vendeurs des productions une jouissance plus entière du prix qu’en payent les acheteurs consommateurs ; que les productions se soutenant constamment à un prix plus avantageux à la vente de la première main, la culture en est plus profitable ; que la culture étant plus profitable, il y a plus de concurrence entre les entrepreneurs de culture, et par conséquent plus de revenu pour les propriétaires.
Il est également évident que si au lieu de s’adresser directement aux propriétaires pour la contribution nécessaire à la construction et à l’entretien des chemins, dans le cas où l’impôt ordinaire ne pourrait pas y suffire, on s’adressait par exemple aux cultivateurs, et qu’on les détournât eux et leurs ateliers de leur travail productif pour les employer à la corvée, la reproduction diminuerait en raison du temps perdu par ceux qui la font naître. Alors la part des Propriétaires diminuerait inévitablement. D’abord en raison de la diminution forcée du produit total. Et en outre, en raison de ce que les cultivateurs seraient néanmoins obligés de retirer sur les récoltes affaiblies, le salaire du temps qu’ils auraient employé à travailler gratuitement sur les chemins ; de sorte que ce salaire au lieu d’être payé par la nature, comme celui du temps que les colons emploient à leurs travaux productifs, serait nécessairement payé aux dépens de la part du propriétaire déjà restreinte par la diminution des récoltes.
Nous ne pouvons donc nous dispenser de conclure comme nous avons commencé que ce sont les propriétaires seuls qui doivent être chargés des dépenses qu’entraînent la construction et l’entretien des chemins, lorsque l’impôt ordinaire n’y saurait suffire ; 2°. que dans ce cas il est infiniment avantageux pour eux de payer directement cette dépense, et pour l’État de n’exiger ce payement que d’eux seuls.
C’est dans ces deux principes que consiste à ce que je crois la théorie fondamentale de l’administration des chemins. J’aurai occasion de développer encore mieux leur évidence dans les Chapitres suivants.
CHAPITRE II.
Motifs qui se sont opposés à l’arrangement qui serait le plus convenable pour assurer équitablement et avantageusement la construction et l’entretien des Chemins. Moyens qu’on a pris. Erreur involontaire, mais terrible dans le choix de ces moyens. Inconvénients de la corvée en nature.
Dans un temps très moderne, il est arrivé en France ce cas extraordinaire dont nous avons parlé, et dans lequel le Gouvernement entraîné par les circonstances, s’est cru obligé de consacrer à d’autres usages la partie des fonds publics destinée à la construction et à l’entretien des chemins. Il a pourtant fallu continuer de faire et d’entretenir des chemins. On a cru qu’en prenant indirectement sur les propriétaires l’impôt nécessaire pour y subvenir, il leur paraîtrait moins sensible. On a cru que puisque les hommes gagnaient de l’argent avec l’emploi de leur temps, avec leur travail, il était égal de demander du temps et du travail, ou de l’argent. On a cru même que la contribution en temps et travail pour les chemins leur serait plus avantageuse, parce qu’on a cru qu’ils avaient tous du temps et la faculté de se livrer au travail de la corvée, au lieu qu’il y en avait un grand nombre qui n’avaient point d’argent. On a cru qu’un impôt levé de cette manière ne pourrait jamais être détourné de sa vraie destination. Le souvenir de notre ancien droit féodal a achevé de décider pour la corvée en nature, qui paru n’être qu’une rénovation. Et par une conséquence, sans doute trop rapide, on pensa que l’ordre des Citoyens déjà chargé des corvées féodales, devait être aussi assujetti à la corvée des chemins[2].
Il faut donc rendre aux Administrateurs qui se déterminèrent pour cette manière de construire et d’entretenir les chemins, la justice de croire que ce fut avec les meilleures intentions qu’ils prirent ce parti. Mais il faut également convenir que le défaut de plusieurs connaissances pratiques qu’il ne leur était pas facile de se procurer, pût seul les empêcher d’apercevoir qu’ils tombaient dans une erreur bien dangereuse pour la prospérité publique. Cinq observations importantes et claires vont démontrer sans réplique cette triste vérité.
1°. La corvée en nature est un Impôt qui porte directement sur ceux qui n’ont que peu ou point d’intérêt à l’emploi qu’on en fait. Nous avons remarqué que la principale utilité des chemins est pour les propriétaires du produit net de la culture, et que la grandeur de cette utilité est en raison de la grandeur de leurs propriétés : or ce ne sont pas les propriétaires, et encore moins les grands propriétaires que l’on fait aller à la corvée.
2°. C’est un impôt qui ne porte que sur une partie de ceux qu’ont y a cru contribuables. Les Paroisses limitrophes des chemins en supportent seules le fardeau qui se trouve par là même infiniment plus lourd pour elles.
3°. C’est un impôt qui dans les Paroisses qui en sont chargées, est nécessairement réparti avec une inégalité invincible. Je m’en rapporte là-dessus à tous ceux qui ont été dans le cas de diriger cette affligeante répartition.
4° C’est un impôt qui coûte réellement à ceux qui le supportent, en sommes pécuniaires, en journées d’hommes et d’animaux, en dépérissement de voitures, etc., au moins le double de la valeur du travail qui en résulte. On est souvent obligé de commander des Paroisses dont le clocher est éloigné de trois lieues de l’atelier, et qui renferment des Hameaux qui en sont à plus de quatre lieues. M. le Comte DE LUBERSAC atteste même dans les excellents Mémoires qu’il a rédigés sur la Province de Franche–Comté, qu’il a vu travailler dans cette Province, de malheureux Corvoyeurs qui demeuraient à cinq lieues du chemin qu’on les contraignait de faire. Le temps se perd, les hommes et les animaux se fatiguent, et les voitures essuient mille accidents par des chemins de traverse impraticables, avant d’être arrivés sur le lieu du travail. Il faut en repartir de bonne heure, afin de retourner chez soi. Et dans le court intervalle qui reste, l’ouvrage se fait avec la lenteur et le découragement inévitable chez des hommes qui n’en attendent point de salaire. De pareilles journées ne valent pas une heure d’un homme payé, qui craint qu’un autre ne le supplante et ne lui enlève son gagne-pain ; pas une demi-heure d’un Soldat bien nourri, qui travaille au milieu de ses Camarades, sous les yeux de son Supérieur, et qui est jaloux de se distinguer. Cependant elles coûtent autant que des journées utilement employées à ceux qui en font les frais, et en souffrent la fatigue.
5°. C’est un impôt qui, détournant les Cultivateurs de leurs travaux productifs, anéantit avant leur naissance les productions qui auraient été le fruit de ces travaux ; et qui par cette déprédation, par cet anéantissement forcé de productions, coûte aux Cultivateurs, aux Propriétaires et à l’État, cent fois peut-être la valeur du travail des Corvoyeurs. Ce n’est que dans nos Villes, ce n’est qu’au sein de la plus profonde ignorance des travaux champêtres, qu’on avait pu se former l’idée de prendre d’ordonnance les journées, les voitures, et les animaux de travail de ceux qui exploitent les terres, de ceux qui font renaître l’impôt du Souverain, les revenus des propriétaires, la dîme du Sacerdoce, les salaires de tous les autres ordres de Citoyens, la subsistance de la Nation entière. Ce n’est, dis-je, qu’au sein de la plus profonde ignorance qu’on a pu s’imaginer d’employer le travail si précieux de ces pères nourriciers de l’espèce humaine, à la construction des chemins, et cela dans les mortes faisons de l’agriculture ! Ceux qui ont inventé cette expression croyaient sans doute que le travail de la terre se bornait à semer et à recueillir. Ils ne savaient pas, qu’excepté les grandes gelées, qui ne sont pas des temps propres pour travailler aux chemins, et qui sont même consacrées à une multitude de travaux indispensables pour les Fermiers, tout le reste de l’année est employé à la préparation des terres ; qu’il faut que tous les jours l’entrepreneur de culture examine le temps qu’il fait pour se déterminer sur le lieu et la nature du travail qu’il doit commander. Telle terre veut être labourée dans la plus grande chaleur ; telle autre dans un temps sombre ; telle autre dans un jour tout à fait humide ; telle autre avant ou après la pluie, etc. Il ne serait pas possible au plus habile cultivateur de dire deux jours à l’avance, s’il aura ou n’aura pas un pressant besoin de son atelier le surlendemain. Comment donc des gens qui n’entendent rien à son art et à sa physique, pourraient-ils lui prescrire des jours de morte saison ? Quand par hasard ils rencontreraient juste pour un ou deux seulement, comment le feraient-ils pour tout un Pays, où du côté d’une haie à l’autre, la différence de la nature du sol oblige un Laboureur à forcer de travail, tandis que son voisin ne peut rien faire. Il y a des terres qui ne peuvent plus recevoir un bon travail, lorsqu’on a manqué le moment favorable ; la récolte de ces terres devient alors extrêmement faible, quelquefois nulle ; comment évaluer de pareilles pertes ? Telle journée de Laboureur vaut la subsistance d’une famille, et plus de cent écus de revenu à l’État. Sur vingt ateliers qui seront commandés pour la corvée, et qui feront une dépense de dix pistoles et un travail de cinquante francs, on peut évaluer qu’il y en a dix qui perdent des journées de cette espèce ; par conséquent l’État y fait une perte évidente de six mille pour cent[3].
Cette perte retombe en entier sur le produit net de la culture, comme nous l’avons démontré dans le Chapitre précédent ; et comme nous pourrons encore le démontrer dans le suivant ; car il est des vérités si importantes et néanmoins si négligées, que les vrais Citoyens ne peuvent ni ne doivent se lasser de les répéter et de les représenter sous toutes les faces possibles aux Lecteurs.
Mais il est à remarquer que dans le produit net de la culture le Souverain a et doit avoir une part proportionnelle. Nos usages actuels ont fixé cette part aux deux-septièmes du produit net ; portion très forte, qui fournirait un revenu immense et plus que suffisant pour les dépenses publiques, dans un Royaume où le Commerce serait libre et immune, et par conséquent le territoire bien cultivé. Or, si le Souverain a dans notre pays, la jouissance des deux-septièmes du produit net de notre culture, il s’ensuit que lorsque par l’effet d’un travail de cent francs que l’on a fait faire par corvées aux Cultivateurs, ce produit net se trouve diminué de six mille livres ; le fisc public y perd pour sa part plus de 1 700 livres.
Il est encore à remarquer que cette perte énorme sur le produit net de la culture et sur le revenu public de la Nation, résulte d’une extinction de produit total, d’un anéantissement de productions qui auraient existé, si la corvée n’avait intercepté les causes de leur existence. Mais il ne peut y avoir de diminution soutenue dans la masse des productions et des revenus, sans qu’il arrive une diminution proportionnelle, et forcée par la misère, dans la population. Une somme de six mille francs, en productions annuelles, aurait fait subsister dix familles, qui sont d’abord condamnées à la mendicité, à l’émigration ou au supplice, par l’interruption irrémédiable des travaux productifs auxquels on enlève les Corvoyeurs, pour les envoyer sur les chemins faire un travail stérile de la valeur de cent francs. Bientôt ces dix malheureuses familles cessent de renaître sur un sol qui leur refuse la pâture.
Qu’on calcule combien de toises de chemin on peut faire avec cent francs ; combien de fois il faut répéter cette dépense sur les grandes Routes de France, et l’on se formera une idée des pertes que causent la corvée, cette contribution établie sur ceux qui ont le moins d’intérêt à la payer, inégale par sa nature dans sa répartition générale, inévitablement inégale dans sa répartition particulière, dispendieuse à l’excès dans sa perception, et prodigieusement destructrice des revenus des Propriétaires et du Souverain, et de la population du Royaume. On concevra combien il y aurait de profits pour la Nation, pour le Gouvernement, pour les Propriétaires, si ces derniers étaient seuls tenus de subvenir à la dépense des chemins, lorsque l’impôt ordinaire n’y peut suffire ; et surtout si l’on employait alors, à ce service public, les troupes dont il accroîtrait la vigueur et la santé, et qui n’auraient pas besoin d’un salaire aussi fort que d’autres ouvriers, qui n’ont pas d’avance leur subsistance assurée comme le soldat.
CHAPITRE III.
Difficultés qui pourraient s’opposer aujourd’hui à l’établissement de la meilleure manière possible de subvenir aux dépenses de la construction et de l’entretien des Chemins. Ignorance des Propriétaires, dont il faut triompher en leur manifestant l’évidence de leur propre intérêt. Nécessité de prendre au moins un parti provisoire.
D’après ce que nous venons de d’exposer, tous nos Lecteurs sentent vraisemblablement la nécessité de renoncer le plus tôt qu’il sera possible au moyen ruineux de faire les chemins par corvée ; et la plupart d’entre eux croient sans doute aussi qu’il est fort aisé de prendre tout de suite la méthode la plus naturelle. Mais cette seconde partie de nos Lecteurs oublie que chez toutes les Nations les vérités les plus utiles ont besoin d’être, longtemps, bien longtemps, démontrées avant qu’on puisse se déterminer à les adopter pour unique règle de conduite.
Le plus grand nombre des Propriétaires du produit net de la culture, ignore encore en France que toutes les impositions retombent sur eux, et qu’elles y retombent avec une surcharge proportionnée à l’étendue du circuit qu’elles ont fait avant de revenir aux Propriétaires. Ils ne savent point que celles, particulièrement, qui portent sur les Cultivateurs et qui ne diminuent le revenu qu’après avoir détruit une partie de la reproduction des richesses renaissantes, sont les plus redoutables ; que ce sont elles qui ruinent les Fermiers, qui dégradent les terres, qui les font retomber entre les mains des Propriétaires, effruitées, dépaillées, hors d’état de produire un bon revenu, sans des dépenses extrêmes, que le Propriétaire ne saurait faire, que nul Cultivateur ne voudrait ni ne pourrait entreprendre qu’en diminuant le fermage à proportion, et qui trop souvent sont un obstacle invincible à la bonne culture ; attendu que les mêmes causes qui ont ruiné le Fermier d’une terre réduite à cet état, ont aussi diminué la fortune des autres, et ont fait naitre l’espèce de pauvreté la plus triste, la plus redoutable et la plus irrémédiable pour un Pays, celle qui résulte du défaut de richesses d’exploitation. Loin de connaître ces vérités, les Propriétaires cherchent toujours, et partout, à éluder l’impôt[4]. Dans des temps d’orage et de subvention, où chacun doit faire effort, ne quid Respublica detrimenti patiatur, l’établissement d’un vingtième leur cause la plus grande sensibilité. Mais ils voient toujours avec indifférence accroître les autres impositions, et même les tailles, qui sont prises directement aux dépens de leur revenu, ou, ce qui est bien plus fréquent et bien plus redoutable encore, aux dépens et en destruction des seules richesses qui puissent faire naître leur revenu.
Lors des augmentations de taille, les Propriétaires ont le choix de deux partis : celui de dédommager leurs Cultivateurs de la surcharge causée par cette augmentation ; ou celui de laisser les Cultivateurs se retourner comme ils pourront, afin de faire face à cette surcharge imprévue. Si les Propriétaires étaient d’humeur à se déterminer pour le premier arrangement, qui serait le plus sage, ils s’occuperaient tout autant des augmentations de la taille, qu’ils le font aujourd’hui de celles du vingtième ; car ces deux augmentations d’imposition produiraient visiblement pour eux le même effet. Ils embrassent ordinairement le dernier parti, soit par pure négligence, soit par un mouvement de cupidité, d’autant plus condamnable qu’elle n’est pas éclairée. Mais en se livrant à ce parti funeste pour eux-mêmes, pour le Souverain, pour la Nation entière, ils n’en envisagent pas les conséquences ; ils ne songent point que dans les conventions qu’ils ont faites avec leurs Cultivateurs, ils ont exigé en rigueur d’être payés par ceux-ci de tout le produit net de leurs terres, l’impôt ordinaire prélevé, et qu’ils ne leur ont laissé que la jouissance, souvent bien exiguë, des reprises indispensablement nécessaires à la culture ; que les Cultivateurs ainsi réduits à leurs reprises strictes, ne peuvent payer aucun impôt qu’en diminuant d’autant leurs dépenses productives ; que la diminution des dépenses productives nécessite la diminution des récoltes ; que cette diminution de récolte tourne forcément et en entier au préjudice de la part du Propriétaire, si le Cultivateur peut renouveler ses conventions, ou reste encore à la charge du Cultivateur si celui-ci est lié par des engagements positifs ; que dans ce second cas, la diminution des récoltes, qui ne dispense pas de payer les mêmes sommes aux Propriétaires, forme pour les Cultivateurs, une nouvelle surcharge ajoutée à celle de l’augmentation d’impôt qu’ils n’avaient pas prévue, ni dû, ni pû prévoir ; que cette nouvelle surcharge s’accumule et redouble d’année en année, par les diminutions de récoltes dont elle est la cause immédiate, et qu’il en résulte une destruction énorme, rapide et progressive de richesses, qui retombe nécessairement à la fin sur les Propriétaires, et dans laquelle on trouve une branche très considérable de l’arbre généalogique des fermes ruinées, des terres effruitées et dégradées, des friches.
Si les propriétaires font si peu d’attention à ces vérités terribles, ce n’est pas qu’elles soient fort difficiles à apercevoir. II ne faut certainement pas un grand effort d’esprit pour comprendre, qu’en supposant que le bien public exigeât nécessairement la levée d’un septier de blé de plus qu’à l’ordinaire, sur le produit d’une telle ferme, si le propriétaire donne un septier à la place de son cultivateur, il ne perdra que ce septier, dont le bien public exige le sacrifice ; mais que s’il laisse prendre ce septier sur les semences qui auraient produit six pour un, le cultivateur sèmera un septier de moins, et la récolte fera de six septiers plus faible, ce qui retranchera d’abord la nourriture de deux hommes dans l’État. Il est tout aussi visible que dès que la récolte fera de six septiers plus faible, le propriétaire ne pourra justement exiger du cultivateur le paiement de ces six septiers, qui n’existeront pas, et qu’il perdra donc six septiers de revenu, pour avoir imprudemment refusé d’en donner un. Il est encore palpable, que si le propriétaire, autorisé par un bail, dont le Gouvernement garantirait les conditions, faute de s’apercevoir que par la levée d’un septier sur les semences il en aurait rendu l’exécution impossible ; que si le propriétaire, à la faveur d’un tel bail et de la protection peu éclairée de l’autorité, force le cultivateur à payer ces six septiers, qu’il ne doit pas selon la justice naturelle, le cultivateur ne pourra subvenir à ce paiement, qu’en retranchant six autres septiers sur ses semences prochaines, lesquelles se trouveront donc de sept septiers plus faibles qu’à l’ordinaire ; savoir, un septier pour l’augmentation d’impôt, et six septiers pour le propriétaire injuste et peu réfléchi qui n’aura pas voulu dédommager son cultivateur de l’impôt, ni même de la perte causée par cet impôt destructeur : or, sept septiers de moins sur les semences causeront l’année suivante une diminution de quarante-deux septiers sur la récolte, et par conséquent sur le revenu du propriétaire qui aurait évité cette perte en payant d’abord un septier, et qui ne pourrait la reculer, sans l’aggraver encore dans la même progression chaque année de la durée de son bail.
Ces conséquences sont évidemment incontestables. Elles sont à la portée de tout le monde, parce que tout le monde sait que les récoltes ne peuvent exister sans que l’on ait commencé par semer. Mais les semences ne sont pas la seule condition nécessaire à l’existence des récoltes : il faut des travaux qui préparent la terre à recevoir ces semences ; il faut des engrais qui réparent et renouvellent les sucs nutritifs de la terre, afin que ces semences fructifient : voilà ce que personne n’ignore entièrement, et ce que très peu de gens se rappellent dans l’occasion. Si au lieu de retrancher les semences on retranchait les labours qui détruisent les mauvaises herbes qui ameublissent la terre, qui en présentent successivement les différentes parties aux influences de l’air par lequel elles sont fécondées, on aurait peu ou point de récolte. Si en laissant les semences et les labours, on retranchait les engrais qui fomentent les sels de la terre, et qui y ajoutent, les terres seraient bientôt épuisées, et les récoltes deviendraient si chétives qu’elles ne vaudraient pas les frais. C’est ce qui arrive quand les cultivateurs sont chargés de quelque imposition imprévue. Ils ne suppriment pas d’abord leurs semences, comme nous venons de le supposer pour rendre la chose plus sensible aux Lecteurs peu au fait de ces matières ; mais ils vendent une partie de leurs bestiaux, ce qui les prive des fumiers nécessaires ; ils se défont de leurs bons chevaux pour en acheter de médiocres, qui ne font les travaux ni aussi vite ni aussi bien ; ils prennent des Domestiques moins chers et moins intelligents ; au lieu de donner quatre bons labours à leurs terres, ils n’en donnent que trois légers. Les terres sont mal préparées et mal fumées, les récoltes décroissent nécessairement comme si l’on avait soustrait une partie des semences. Et si le propriétaire n’y met ordre en se chargeant de l’impôt, les récoltes et les moyens du Laboureur diminuant d’année en année, celui-ci se voit contraint par degrés de substituer aux chevaux médiocres, des haridelles ; aux haridelles, des bœufs ; aux bœufs, des vaches ; aux vaches, des ânes ; aux ânes, des femmes, telles que j’en ai vues attelées à la charrue près de Montargis. Force vient, dans le cours de cette dégradation, de diminuer enfin les semences même ; et nos meilleurs, nos plus sages Écrivains d’Agriculture pratique, sont réduits aujourd’hui à conseiller à nos Laboureurs d’ensemencer moins de terrain que ne faisaient leurs Pères, afin de mieux proportionner leurs entreprises à l’étendue de leurs facultés dépéries. [5] La plupart des Propriétaires sont tranquilles sur cette destruction progressive et funeste. Ils ne voient point que rien ne leur importe davantage. Et s’ils ne se croient pas intéressés aux effets si grossièrement évidents des augmentations de taille qu’ils laissent supporter aux Cultivateurs de leurs domaines, on peut juger qu’ils sont encore bien plus loin de comprendre que toutes les autres impositions qu’ils ne payent pas directement sur leur revenu, produisent des dégradations également destructives de ce revenu ; et qu’il leur serait ainsi très avantageux de se charger de payer eux-mêmes au Fisc la valeur de ces impositions. Il est facile d’augurer de là, combien l’Administration pourrait rencontrer de difficultés et d’oppositions à l’établissement de la méthode indiquée par la nature, par la justice, par la raison, par l’intérêt calculé du Public et des Propriétaires, pour subvenir à la dépense de la construction et de l’entretien des chemins. Nos enfants auront peine à se le persuader ; mais il n’est malheureusement que trop vrai, que dans ce siècle lettré, il y a encore en France très peu de Propriétaires assez instruits pour ne se pas croire lésés si, en supprimant les corvées, on établissait et répartissait aujourd’hui sur eux, au marc la livre de leurs vingtièmes, l’imposition nécessaire à la construction et à l’entretien des chemins ; quand même cette imposition serait réduite au taux le plus bas qu’il serait possible, et quand pour l’alléger en économisant la dépense, comme pour entretenir les forces et l’activité du soldat, on prendrait enfin le parti d’employer les troupes à cet ouvrage, dont l’importance est digne de leur dévouement pour la chose publique.
Les préjugés et les oppositions de ces Propriétaires peu éclairés céderaient sans doute à la preuve évidente des avantages qu’ils trouveraient à l’abolition des corvées. Ceux d’entre eux qui veulent réfléchir concevraient à la fin, que les charges qui portent sur leurs Fermiers, sur leurs Métayers et sur tous les autres Ouvriers employés directement ou indirectement à la culture de leurs domaines, diminuent au moins d’autant le produit, qu’eux Propriétaires en retireraient sans ces charges ; et que par conséquent, si elles causent à ceux qui en font les avances un préjudice plus grand que n’est la valeur effective de ces charges, elles sont plus nuisibles aux Propriétaires que ne le leur serait le payement direct de cette valeur effective. Et quand on leur aurait démontré, comme je tâche de le faire dans cet Ouvrage, et plus clairement encore, s’il est possible, que la corvée cause en effet à ceux qui y sont assujettis, un dommage progressif infiniment au-dessus de la valeur des chemins, et des dépenses que coûterait leur construction et leur entretien à prix d’argent ; quand on leur aurait prouvé qu’un travail qu’ils pourraient faire faire pour cent francs à des Ouvriers ordinaires, que ce même travail, lorsqu’il est exécuté par leurs Cultivateurs, au préjudice de l’exploitation de leurs terres, les prive de trois mille quatre cents livres de leur revenu[6], il est certain que tous les Propriétaires sensés, préféreraient la dépense directe des chemins nécessaires, à l’arrangement actuel, où les corvées causent une déprédation toujours renaissante, et toujours multipliée aux dépens de leurs richesses annuelles. Mais il faut s’attendre que cette résolution des Propriétaires du produit net de la culture, ne se formera que lentement et par degrés ; car entre la démonstration évidente et la persuasion universelle, il y a loin pour une Nation qui sort à peine des ténèbres de l’ignorance sur les points les plus essentiels à son bonheur, et chez laquelle un grand nombre de causes politiques et morales ont formé de la plus considérable partie des Propriétaires, une classe mixte, occupée de toute autre chose, que du soin de veiller au bien de ses propriétés territoriales.
Il faut, cependant, gouverner les Peuples selon leur cœur, comme dit l’Écriture Sainte ; et de ce principe de condescendance sage, est vraisemblablement née la circonspection avec laquelle l’administration marche toujours, même vers le bien. Il est plus agréable de faire vouloir que de commander ; et quand on ne veut ordonner que des choses utiles, il n’est point de marche plus sûre que de manifester l’évidence de leur utilité, avant de faire parler les Lois. La liberté, que les lumières et la bienfaisance du Gouvernement laissent depuis quelque temps, d’écrire sur les matières qui importent au bien public, constatera, j’ose le croire, la nécessité de suivre entièrement par rapport aux chemins, les principes que j’ai exposés dans le premier Chapitre de cet Ouvrage. Quand ces principes auront été suffisamment discutés, quand le silence ou la défaite des contradicteurs qu’ils pourraient encore trouver, auront fait voir que la partie la plus considérable de la Nation les adopte ; alors, sans doute, une Loi générale sera accordée aux vœux des propriétaires éclairés, pour régler de la manière la plus avantageuse possible à l’État, au Souverain, et aux Propriétaires, la contribution nécessaire pour la dépense des chemins, lorsque l’impôt ordinaire n’y pourra suffire.
Mais en attendant le moment de ce Règlement si nécessaire et si désirable, les inconvénients attachés à la corvée en nature, et qui causent au Souverain même, des pertes immenses en sa qualité de Co-propriétaire universel du produit net de la culture de son Empire ; ces inconvénients invincibles et si préjudiciables à l’humanité entière, demandent un très prompt remède. Il semble donc extrêmement pressant d’adopter provisoirement et généralement une autre méthode pour la construction et l’entretien des chemins, qui sans être celle à laquelle il faudra se fixer dès qu’on le pourra, soit du moins propre à prévenir les maux les plus frappants qui résultent du régime dans lequel les circonstances avaient entraîné l’administration en cette partie.
On a déjà tenté avec succès, dans quelques Généralités cette entreprise mitoyenne et salutaire. J’exposerai dans le Chapitre suivant la marche qu’on a suivie, j’en ferai sentir les avantages, et je remarquerai aussi les inconvénients qui y sont encore attachés.
CHAPITRE IV,
ET DERNIER.
Moyens provisoires employés dans deux Provinces, pour remplacer la corvée en nature ; et dans lesquels on trouve des avantages immenses, en les comparant avec ce que l’on fait en général aujourd’hui, quoiqu’ils soient encore loin du but où l’on pourrait et devrait parvenir à cet égard.
Je ressens un plaisir doux et pur en commençant ce Chapitre, je n’ai plus dans cet Ouvrage qu’à faire l’histoire des bienfaits et de la sagesse de l’administration, des lumières et du zèle de plusieurs Magistrats distingués : c’était un délassement nécessaire, après avoir été obligé de m’appesantir dans les Chapitres précédents sur nos erreurs passées, je devrais plutôt dire passantes, et sur les malheurs qui en étaient, qui en sont, qui en auraient été les suites inévitables.
Les moyens que je vais exposer pour suppléer à la corvée, ne peuvent être mis dans la classe des projets nouveaux qui demandent beaucoup de raisonnements pour être démontrés, beaucoup de tentatives et d’expériences pour en constater la possibilité. Il y a plusieurs années qu’ils sont adoptés et employés avec succès et avec l’approbation du Gouvernement dans deux Généralités du Royaume.
M. Orceau de Fontette, Intendant de Caen, est le premier, qui frappé des maux qu’entraîne la corvée, des inconvénients, des abus qui en sont inséparables, et s’élevant au-dessus des préjugés pusillanimes, qui tendent à laisser toutes les choses bonnes ou mauvaises dans l’état où on les trouve, résolut d’affranchir la Province confiée à ses soins, d’un fléau destructeur des récoltes, de la population, et des revenus du Souverain et des Propriétaires : voici de quelle manière s’y prit ce digne Magistrat.
Les Paroisses voisines des chemins sont chargées suivant une répartition déjà faite entre elles d’une certaine étendue de tâche pour les travaux de construction ou d’entretien de ces chemins. M. de Fontette proposa à chacune de délibérer pour choisir, ou de faire sa tâche en nature, ou de se soumettre à payer en argent au marc la livre de sa taille, l’adjudication qui en serait faite ; déclarant au surplus, que faute d’avoir dans un délai limité, notifié expressément qu’elle préfère la corvée à l’imposition nécessaire pour faire exécuter sa tâche, elle sera bien et dûment censée avoir accepté le dernier parti, et qu’en conséquence la tâche adjugée publiquement au rabais, et payée en argent, serait répartie sur les contribuables de la Paroisse qui aurait dû la faire, et qui aurait préféré de la payer. Par cet arrangement, les chemins sont construits et réparés sans que les travaux de la culture soient interrompus, et le plus redoutable des inconvénients qui résultaient de l’ancien Régime, se trouve paré et prévenu.
Peu après l’établissement de cette réforme salutaire dans la Généralité de Caen, M. Turgot fut nommé Intendant de celle de Limoges ; animé du même zèle que M. de Fontette, il en adopta les vues, et en perfectionna le plan pour l’appliquer aux deux Provinces qui composent cette Généralité.
On y propose, comme dans la Généralité de Caen, aux Paroisses limitrophes des chemins, de délibérer pour se soumettre à faire leur tâche, ou à en payer l’adjudication. Mais en leur offrant ce choix, M. l’Intendant leur promet, si elles prennent le dernier parti, de diminuer leur taille d’une somme égale à celle à laquelle aura monté l’adjudication de leur tâche : le résultat de la délibération n’est donc pas douteux. Si quelque Paroisse balance ou se refuse même à la première délibération, comme cela est arrivé dans les commencements à une Paroisse de l’Angoumois, ce ne peut être que par une suite de ce préjugé funeste, que les malheurs et les erreurs des temps passés ont fait naître, et qui porte les Habitants des campagnes à redouter l’administration jusque dans ses présents. Mais ce préjugé qu’un Gouvernement plus éclairé cherche à détruire, et qui cède toujours aux bienfaits soutenus, est dissipé par une année au plus d’expérience et d’exemple de la franchise dont jouissent les Paroisses circonvoisines, tandis que celle à qui une crainte mal-entendue a fait préférer la corvée en nature, s’y voit seule assujettie dans son canton.
Sur le vû de la délibération de chaque Paroisse, M. l’Intendant la diminue au département des tailles d’une somme égale à la valeur de l’adjudication, ainsi qu’il l’a promis ; et par un rôle séparé, dans le préambule duquel il vise et accepte la délibération de la Paroisse, et fait mention de la diminution qui lui est accordée en conséquence, il impose sur cette Paroisse le montant de l’adjudication au marc la livre de la taille.
La valeur du Rôle général des adjudications résultant de l’addition de tous les Rôles particuliers des Paroisses voisines des chemins, qui dans le système de la corvée auraient été seules chargées et surchargés par les dépenses de leur construction, et qui ont délibéré pour les faire exécuter par adjudication ; la valeur, dis-je, de ce Rôle général est ajoutée à la somme totale des tailles de la Province, et se trouve répartie sur toutes les Paroisses avec la taille même.
Cette méthode paraît préférable à celle que l’on suit dans la Généralité de Caen, en ce qu’elle évite un inconvénient de plus, qui est celui de ne faire supporter la charge des chemins qu’aux Paroisses qui en sont limitrophes[7]. Il n’y avait, il est vrai, que ces Paroisses limitrophes qui fussent assujetties à la corvée ; parce qu’il n’y avait qu’elles dont on pût exiger un travail en nature. Mais dès qu’il s’agit d’une contribution en argent, il est juste qu’elle soit répartie sur tous ceux qui profitent de l’usage qu’on en fait, et c’est ce qui arrive au moyen de l’arrangement adopté dans la Généralité de Limoges. Au moyen de la diminution que M. Turgot accorde aux Paroisses qui étaient autrefois écrasées sous le faix de la construction et de la réparation des chemins, elles n’en paient plus que leur quote-part, en raison de la répartition générale faite sur toute la Province. Les Paroisses plus éloignées, qui profitent de l’avantage des chemins, souvent autant, et quelquefois plus que les Paroisses qui en sont voisines, supportent une partie de la dépense de ce travail public, et la charge en devient plus légère par la multiplicité de ceux qui concourent à la soutenir.
Cette opération ressemble à ce qui se pratique en faveur des Paroisses grêlées, ou qui ont à faire des réparations considérables à leur Église, etc. On leur accorde une diminution dont le montant est supporté par le reste de la Généralité : usage fondé sur le Droit naturel et social, qui veut que tous les membres de la Société viennent au secours de celui qui par des circonstances malheureuses se trouve dans le cas indispensable d’avoir besoin de ce secours. La répartition générale de la dépense qui supplée à la corvée, est appuyée sur des raisons encore plus fortes. Car non seulement toutes les Paroisses d’une Province sont exposées à avoir quelque jour des chemins à faire, comme à rebâtir leur Église, et à retrouver alors avec plaisir le secours qu’elles prêtent à celles qui ont actuellement ce fardeau ; mais toutes les Paroisses d’une Généralité profitent de proche en proche de la facilité des chemins qui la traversent, au lieu qu’elles ne profitent pas toutes de l’Église ou du Presbytère que l’on rebâtit dans une d’entre elles.
De cette manière, l’Ouvrage coûte moitié moins, en comparant la dépense en argent qu’il occasionne, avec la valeur des journées d’hommes, de voitures et d’animaux que la corvée employait ; il coûte soixante fois moins, en comparant cette même dépense avec la déprédation que causait dans l’ancien système le temps précieux et inestimable que la corvée enlevait aux Cultivateurs, et dont la perte était irréparable pour eux. Nous avons vu que pour faire un travail de cent francs par corvées, l’État et la Nation souffraient une perte de six mille francs[8].
De cette manière on peut faire la même quantité de chemins, avec la moitié moins de journées et de voitures, (comme nous l’avons prouvé ci-dessus pages 157 et 158) et ces chemins sont au moins quadruples en solidité ; parce que les Entrepreneurs qui sont tenus de garantir les Chemins qu’ils ont faits, ont grand intérêt de les faire bien exécuter, afin que les frais d’entretien soient réduits presqu’à zéro ; et encore parce que les Ouvriers qu’ils emploient ont aussi grand intérêt à être attentifs, soigneux et intelligents, de peur d’être renvoyés et de perdre ce travail qui leur fait gagner leur vie. Au lieu que les Corvoyeurs, que l’on contraint de travailler sans salaire, apportent à leur ouvrage une négligence nécessairement invincible. Pressé de retourner à son travail productif le Corvoyeur n’a et ne peut avoir d’autre vue que de s’acquitter promptement de la tâche onéreuse et stérile à laquelle il est assujetti, ce qu’il ne peut faire qu’au préjudice de la solidité. Aussi voit-on dans une espace de chemin assez court, des parties rompues et délabrées, tandis que d’autres sont entières ; ce qui ne peut provenir que des changements de Corvéables, qui ont plus ou moins bien exécuté leur travail.
De cette manière la construction des chemins, au lieu d’enlever le travail des Habitants des Campagnes, leur en offre, qu’ils sont bien aises de prendre, quand ils le peuvent sans préjudicier aux travaux de leur culture : ce dont ils sont seuls juges éclairés et compétents.
Dans cette manière, l’impôt qui doit subvenir à la dépense des chemins, a une forme de répartition régulière, et qui en rend le fardeau infiniment moins pesant. Au lieu que par la corvée, le profit de la construction des chemins ne dédommage pas la Province, ni l’État, de la surcharge excessive, qui ne porte que sur un petit nombre de Paroisses, et qui n’y saurait même être assujettie à aucune forme sûre et équitable de répartition ; elle semble au contraire charger ceux qu’on y a cru contribuables, en raison inverse de leurs facultés, et de l’intérêt qu’ils ont à la construction des chemins.
Cette opération serait parfaite si, au lieu d’être répartie au marc la livre de la taille, la contribution levée pour les chemins était répartie au marc la livre des vingtièmes. Mais cela aurait passé les pouvoirs des Magistrats auxquels nous devons l’essai patriotique de la destruction de la corvée : on ne peut espérer que d’une Loi cette disposition, la seule qui soit équitable, parce que c’est la seule qui puisse rendre cette contribution le moins onéreuse qu’il soit possible aux propriétaires et à la société. Il aurait seulement été à désirer qu’en attendant cette Loi nécessaire on eût préféré de répartir la dépense des chemins en raison de la Capitation, plutôt qu’en raison de la Taille, 1°. Parce que cela eût rendu la répartition plus légère, attendu que beaucoup de personnes sont exemptes de Taille, tandis qu’il n’y a point d’exempt de Capitation ; 2°. Parce que cela eût rapproché de l’ordre naturel, puisque les exempts de Tailles sont principalement des propriétaires, et de grands propriétaires, qui sont les plus intéressés de tous à la construction des chemins, et à ce que cette construction ne se fasse pas d’une manière destructive de leur revenu ; comme il arrive, ainsi que nous l’avons démontré dans le Chapitre précédent, lorsque les cultivateurs supportent des augmentations de Taille, et n’en sont pas dédommagés sur-le-champ par leurs propriétaires.
La dépense des chemins ajoutée à la Taille, conserve les inconvénients attachés à toute imposition qui n’est pas prise directement en entier sur le produit net du territoire, et proportionnellement à ce produit net. Nous avons indiqué (depuis la page 169, jusque et comprise la page 178) quelques-uns de ces inconvénients. On peut voir combien ils sont immenses, et destructeurs des revenus du Souverain, des Propriétaires, et de la Nation, ainsi que de la population du Royaume. On peut se convaincre de l’intérêt pressant qu’a le Gouvernement d’y mettre ordre, le plutôt possible ; et de celui qu’ont les Propriétaires de prévenir la Loi qui interviendra sûrement à cet égard, par des arrangements économiques et amiables avec leurs Cultivateurs. Mais il faut convenir que ces inconvénients existaient tous d’une manière bien plus terrible, et avec des circonstances bien plus désastreuses encore dans la corvée en nature ; de sorte que la Généralité de Caen, et surtout celle de Limoges, éprouvent un soulagement considérable, quoi que ce ne soit pas à beaucoup près le plus grand qu’il eût été possible de leur procurer.
Au reste, il est évident qu’on ne saurait regarder comme une difficulté, ou comme un nouvel impôt, la perception des deniers nécessaires pour suppléer à la corvée. Celle-ci subsiste, elle est un impôt réel réductible en argent, dont la somme, ainsi évaluée, est au moins double de la dépense qu’exige la construction des chemins, et dont l’anéantissement de richesses qui en est inséparable, l’inégalité forcée de la répartition, la rigueur inévitable de la perception, centuplent au moins la pesanteur. Lever au lieu d’un impôt si redoutable, la somme nécessaire pour la construction des chemins, et en répartir la dépense sur toute une Province, ce n’est donc pas établir un nouvel impôt, ce n’est pas augmenter ses charges ; c’est la soulager au contraire des quatre-vingt-dix-neuf-centièmes d’une charge onéreuse pour elle et pour l’État, et qui par sa nature n’est pas propre à procurer convenablement au public le service qu’on en attendait.
On pourrait objecter il est vrai, que la levée des fonds qui suppléeraient à la corvée, serait une perception illégale. Il serait facile de répondre à cette objection, si les principes et le plan que je propose étaient adoptés ; et la Loi qui ordonnerait de faire les chemins pour le prix qu’ils valent, qui défendrait de faire une perte de six mille pour cent dans leur construction, qui contiendrait enfin l’abolition générale et perpétuelle de la corvée, et qui statuerait, par conséquent, sur les moyens de faire avantageusement et à peu de frais le service public, auquel elle ne peut subvenir qu’avec une déprédation effrayante ; une Loi si salutaire, aurait l’évidence de son utilité pour garant du respect et de la reconnaissance qu’elle inspirerait à tous les Ordres de Citoyens. D’ailleurs la corvée, elle-même, qui forme une imposition bien plus considérable et bien plus rigoureuse que la levée des deniers nécessaires pour la remplacer, la corvée qui a des effets si désastreusement étendus, n’a jamais été une imposition légale ; c’est-à-dire qu’elle n’a été autorisée que par des ordres particuliers.
Une objection plus sérieuse et propre à faire impression aux meilleurs Citoyens, serait celle qui résulterait de la crainte que dans des temps malheureux le Gouvernement n’appliquât à une autre destination le produit de la contribution qu’on lèverait pour la dépense des chemins, et ne rétablisse la corvée à laquelle cette contribution aurait succédé. À cette objection spécieuse, je réponds, 1°. que selon le plan que je viens d’exposer, la contribution qui succède à la corvée n’est point une imposition stable, et dont le revenu soit déterminé. La délibération des Paroisses, et le prix des adjudications qui en fixent l’existence et la quotité tous les ans, en font une espèce de cotisation, qui se paye à mesure que la dépense se fait, et dont l’emploi ne saurait par conséquent être interverti. Je réponds, 2°. que quand ce serait une imposition ordinaire et stable, jamais à l’avenir le Gouvernement ne la détournerait de sa destination, et ne la remplacerait par la corvée. S’il peut y avoir quelques exemples d’opérations à peu près semblables, ils sont de ces temps de ténèbres où personne ne songeait à l’agriculture, où tout le monde ignorait qu’elle fût la source unique des revenus, où pourvu que les Manufactures de Tours et de Lyon fussent occupées, et que des relevés, nécessairement fautifs, d’exportations et d’importations parussent nous attester que nous recevions la solde en argent de la balance du commerce, on croyait que tout allait bien dans l’État. Mais aujourd’hui qu’on s’occupe de combinaisons plus solides, que l’on commence à remonter à l’origine des richesses, à calculer les Lois physiques de leur reproduction et de leur distribution ; aujourd’hui que l’on peut se convaincre, qu’en rétablissant la corvée, pour pouvoir appliquer à d’autres usages une couple de millions, qui auraient été destinés à la dépense des chemins, le Souverain perdrait bientôt plus de trente millions de revenu annuel, il n’y a pas à craindre que l’on fasse une opération aussi absurde. L’intérêt du fisc même est ici le garant de l’observation de l’ordre naturel. Il n’est pas permis de présumer que des hommes insensés pussent jamais parvenir aux premières places de l’administration. Et s’il était possible qu’un jour à venir quelqu’un osât proposer de diminuer de trente millions le revenu du Souverain, pour lui procurer par une injustice la jouissance passagère de deux millions ; il est évident que l’indignation du Prince, et le mépris universel, vengeraient à l’instant la Nation d’un conseil aussi peu réfléchi.
La conversion des corvées en argent a été indiquée à MM. les Commissaires départis, par l’instruction qui leur fut donnée en 1737, et qui les autorise à faire faire à prix d’argent les tâches que les Paroisses n’auront pas achevées dans un certain délai, et à en répartir le montant sur les corvéables. Convertir la corvée en argent, est déjà sans doute un avantage considérable ; puisque c’est éviter la dépréciation qui résulte de la perte du temps précieux des cultivateurs et de leurs ateliers. Mais se borner à cette opération, ce n’est point assez faire ; c’est laisser subsister l’inégalité excessive de la répartition entre les Paroisses ; c’est oublier que la construction des chemins est une charge publique, et qui doit donc porter sur la totalité du public ; c’est souffrir encore que la facilité des communications établies pour le bien général, soit un fléau pour le petit nombre de Paroisses qui en sont les plus prochaines : osons le dire, c’est manquer au principe de toute imposition qui doit être plus profitable qu’à charge à ceux qui la payent, sans quoi rien ne pourrait garantir son existence, et moins encore sa perpétuité.
Il ne serait donc point étonnant que si l’on se contentait de substituer l’imposition en argent à la corvée en nature et de répartir cette imposition sur les corvéables seuls des Paroisses voisines des chemins, on n’excitât les plaintes de ces Paroisses effrayées par tout ce qui est opération nouvelle ; et qui dans cette nouveauté propre à réveiller leur attention, sentiraient l’énorme inégalité de la répartition de l’impôt des chemins, et seraient plus frappés de l’idée de supporter une charge, dont d’autres Paroisses voisines seraient exemptes, qu’attentives au soulagement réel que leur donnerait la nouvelle forme de perception.
Il n’en saurait être de même du plan que je propose, et qui, comme je l’ai dit, a déjà mérité dans quelques Provinces l’approbation du Gouvernement. La délibération des Paroisses lui donne la forme la plus douce, et la plus sûre quant à la destination[9].
La répartition générale de la dépense au marc la livre de la Capitation, rendrait la contribution des chemins la moins pesante qu’il soit possible dans les circonstances actuelles, qui ne permettent peut-être pas encore de la lever par la seule voie qui soit entièrement équitable, et qui ne soit pas destructive, c’est-à-dire uniquement sur les propriétaires des biens fonds. Quand le temps infiniment désirable pour le Gouvernement, et attendu avec impatience par les propriétaires éclairés qui calculent leurs véritables intérêts ; quand le temps sera venu où l’on pourra suivre pour l’impôt des chemins cette marche naturelle et juste, l’opération sera toute préparée, si l’on adopte celle que j’indique ; il n’y aura qu’à suppléer la délibération des propriétaires à celle des contribuables actuels[10].
Plusieurs de MM. les Intendants des Généralités, touchés des maux qu’entraîne la corvée et de la diminution progressive de richesses qu’elle cause dans leurs Provinces, fatigués par l’impossibilité de mettre de l’ordre et une forme de répartition régulière dans cet impôt irrégulier et de prévenir toutes les occasions d’abus et de vexations particulières qui y sont attachées, affligés d’être sans cesse contraints d’employer des voies rigoureuses et de sévir contre la partie la plus innocente, la plus utile, et l’une des plus respectables de la Nation, cherchent les moyens de faire de meilleurs chemins et d’une manière moins dispendieuse, moins destructive que par la corvée. Ils voudraient répandre des salaires dans les Campagnes, offrir du travail à l’indigence, et soulager les Paroisses voisines des chemins, qui sont depuis trop longtemps surchargées par un fardeau que le droit naturel, la justice et la raison obligent de reconnaître pour une charge commune des Provinces entières qui en profitent.
C’est à ces dignes Magistrats que j’offre cet écrit, dans lequel je n’ai d’autre mérite que celui d’exposer des idées qui leur sont probablement communes à tous, et de développer un plan qui a été formé dans leur corps, qui a été justifié par ses succès, et que le Ministère sage qui l’avait d’abord simplement permis, a ensuite expressément autorisé dans les Provinces où il s’exécute.
_____________
[1] Le Canal de Briare fut construit en 1607, sous Henri IV, et par les soins du Duc de Sully. Ces deux grands Hommes qui étaient les amis et pour ainsi dire les camarades de leurs Soldats, ne crurent point les avilir, et pensèrent au contraire les récompenser, en employant six mille hommes de troupes à cet ouvrage important et patriotique, qui fut achevé avec une célérité et une perfection surprenantes.
Les Militaires de ce temps là avaient certainement autant de dignité que ceux d’aujourd’hui. Et ceux d’aujourd’hui n’ont certainement pas moins de patriotisme et moins de zèle, pour servir utilement l’État.
[2] Il y a bien peu d’États qui, comme la Chine et le Pérou, aient le bonheur d’avoir été fondés par des Législateurs. Tous les Corps politiques de l’Europe ont pris leur forme dans des siècles d’ignorance et de barbarie. Heureux sont ceux à qui, dans la loterie des événements, il est échu un fonds de Constitution propre à les conduire à la prospérité. Tel est en France l’établissement d’une autorité tutélaire suffisante pour réprimer les intérêts particuliers désordonnés, et celui d’un revenu public territorial, dans une proportion assez forte pour maintenir la supériorité de cette autorité nécessaire et bienfaisante. Mais cette Constitution avantageuse, qui semble assurer le service public, et les revenus nécessaires pour subvenir aux dépenses de ce service, ne s’est arrangée que par degrés. Nos braves ancêtres étaient fort ignorants et nullement propres aux combinaisons qui auraient demandé des calculs tant soit peu compliqués ; il parait surtout, qu’ils n’aimaient pas les stipulations en argent. Ils ne payaient point le service public ; ils préféraient de le faire. Ils n’entretenaient point d’armées ; ils allaient à la guerre en personne. Ils n’affermaient point leurs terres ; ils les donnaient pour des redevances en cens, en champarts, et surtout en corvées, comme cela se pratique encore en Pologne. Les enfants de ceux qui avaient ainsi reçu des terres des Seigneurs ou grands Propriétaires, à la charge de travaux ou corvées au profit de ce Seigneur donateur, naissaient attachés à sa terre, serfs de sa glèbe. Cette espèce de servitude, dont on s’est formé dans nos derniers temps des idées fort extraordinaires, et où l’on a cru voir la tyrannie d’une part, et l’avilissement de l’espèce humaine de l’autre, n’était rien moins que l’esclavage. C’était, comme aujourd’hui en Pologne, un simple contrat entre le Seigneur qui fournissait la terre et les avances de la culture à celui qui devenait son Serf, et ce même Serf qui payait en travaux le loyer de la terre qu’il avait reçue. Les héritiers de ce Serf de la glèbe, qui devenaient ainsi Serfs eux-mêmes, ne regardaient point cela comme un désavantage ; ils héritaient de la servitude territoriale, parce qu’ils héritaient de la terre qui avait été donnée à leurs parents sous la clause de cette servitude, qui était le titre de leur propriété. On peut voir par les monuments qui nous restent dans le Moine du Vigeois, dans Eustache Deschamps, et dans plusieurs autres Auteurs contemporains, sur l’opulence, et même sur la magnificence de ces Seigneurs qui vivaient dans leurs terres, et qui y étaient eux-mêmes les Entrepreneurs de la culture, dont ils payaient les travaux à leurs Serfs par les terres même qu’ils leur concédaient, ou leur avaient concédées ; on peut voir, dis-je, que ces arrangements n’étaient pas fort préjudiciables à la prospérité de l’Agriculture, qui est la source des revenus des Propriétaires, et des salaires des Artisans. Ces arrangements assuraient aux Seigneurs la jouissance du revenu, de leurs terres et les profits de leurs richesses d’exploitation, et aux Colons la subsistance et les gains dus à leurs travaux. La différence des avantages et des avances faites par le Seigneur donateur à ceux qui recevaient sa terre, a fait naître la différence de la nature et de la quotité des redevances que nous trouvons variées à l’infini. Il parait que lorsque la terre était donnée à quelqu’un en état de l’exploiter, et à qui il fallait peu ou point d’avances de la part du Seigneur, c’était le cas des censives, qui ne sont que l’engagement d’un loyer perpétuel. Il paraît que lorsque le Seigneur donnait non seulement la terre, mais encore les bestiaux, les bâtiments et les instruments propres à la mettre en valeur, c’était le cas des redevances en champarts et corvées : ce qui revient assez aux arrangements qui se font encore aujourd’hui pour les terres exploitées par des Métayers, où les Propriétaires partagent les récoltes et le profit des bestiaux, et fournissent aux Métayers les avances de l’exploitation.
Une chose jette beaucoup de confusion sur notre ancienne Histoire. Ceux qui l’ont écrite, n’ont pas assez distingué la servitude de la glèbe, de l’esclavage ou de la servitude personnelle et proprement dite. La première résultait des contrats faits entre les Seigneurs et ceux qui étaient soumis à cette sorte de servitude ; en vertu de laquelle, la terre, la maison, les meubles et les bestiaux concédés par le Seigneur lui revenaient de droit naturel, lors de la mort, sans enfants, de celui qui les avait reçus, ou lors de son expatriation absolue et constatée, qui rompait le contrat, en privant le Seigneur des redevances, lesquelles étaient pour ainsi dire le prix de l’espèce de vente qu’il avait faite. Cette servitude territoriale est la seule qui put assujettir, régulièrement et sans désastre, à des corvées, et par conséquent la seule que nous ayons à examiner ici. L’autre servitude, personnelle et arbitraire, est née de l’abus du pouvoir des Seigneurs, et des usurpations, fréquentes dans le désordre des guerres féodales. Ces deux espèces de servitude, l’une légitime et l’autre injuste et contraire à toutes les Lois du Droit naturel, ont existé en même temps. Nos Historiens modernes ont souvent pris l’une pour l’autre ; et de là, les différents Tableaux du Gouvernement Féodal, que quelques-uns ont trouvé admirable, tandis que les autres l’ont regardé comme le comble du délire de l’injustice et de la barbarie. Pour moi j’ose croire que ce Gouvernement ne méritait en lui-même, ni les éloges outrés qu’il a reçus, ni les satires amères qu’on en a faites. C’était un Gouvernement imparfait qui, dans ses plus beaux jours, était susceptible de grands abus ; mais peut-être moins destructeurs que ceux qui se sont glissés depuis dans d’autres Gouvernements imparfaits, dont la forme paraît plus régulière. C’était un Gouvernement qui se formait, plutôt qu’un Gouvernement formé. La division extrême des intérêts, et le défaut d’autorité tutélaire qui protégeât les faibles contre les puissants, rendaient la durée de ce Gouvernement impossible. Les progrès de la discipline militaire, et l’invention de la poudre à canon, qui ont rendu les guerres plus savantes, plus régulières et beaucoup plus dispendieuses, ont précipité sa destruction. Il n’a plus été possible de faire le service militaire, au lieu de le payer. Il a fallu que les Souverains eussent des fonds pour les dépenses de l’artillerie, et par conséquent qu’ils levassent des impôts. Dès qu’ils ont eu des impôts réguliers pour subvenir aux dépenses de leurs guerres, ils ont eu des guerres plus longues ; et pour les soutenir il leur a fallu des troupes salariées, attendu que le service féodal le mieux rempli, n’obligeait que pour un temps limité. Dès que les Souverains ont eu des troupes à leur solde, la Noblesse a brigué de l’emploi dans ces troupes. Dès qu’ils ont levé des impôts, les Seigneurs les ont environnés pour en obtenir des grâces, et ont cessé d’être les Entrepreneurs et les grands Inspecteurs de la culture de leurs domaines. Alors l’ordre des Fermiers, Associés et Lieutenants des plus grands Propriétaires pour le bien de la Nation, cet ordre respectable a pris naissance ; les autres Colons ont été salariés. Ces Fermiers payent en rigueur au Propriétaire le fermage des terres qu’ils cultivent, et l’impôt au Souverain ; les Colons salariés ne reçoivent que la rétribution nécessaire pour leur subsistance, à laquelle leur temps et leur travail sont consacrés. Dans cet état la corvée, ou toute autre chose, qu’on exigerait de ces deux classes de Citoyens, au-delà de ces arrangements, ne présenterait qu’une exaction préjudiciable à la prospérité de l’État, et qu’une subversion de l’ordre de la Société ; ce qu’on n’aperçoit point du tout dans les droits de corvées dus par les Serfs de la glèbe à leurs Seigneurs, et qui étaient, comme, ils le sont encore en Pologne, l’effet d’un contrat. C’est donc à tort que l’on a cru trouver dans les corvées féodales, une raison pour justifier la corvée des chemins, puisqu’elles ne sont en aucunes manière de la même nature ; que les premières étaient la suite de conditions justes et avantageuses au corvéable, et que les secondes ne sont pour lui qu’une surcharge au-delà de ce qu’il doit et peut payer à la chose publique. Aussi ces dernières sont-elles visiblement ruineuses pour l’État, et les premières pouvaient ne l’être pas.
[3] Une Personne respectable a pensé que cette évaluation était trop forte. Je suis parfaitement convaincu qu’en cela, cette Personne s’est trompée ; mais, quand on en rabattrait la moitié, quand on en rabattrait les trois quarts, ne serait-ce rien, qu’une perte de quinze-cent pour cent, sur un travail public ? Et cela ne crierait-il pas suffisamment au remède ?
[4] En Angleterre même, où ils ne payent guère directement que quatorze deniers pour liv. de leur revenu, ils croient être francs du reste. Ils ne s’aperçoivent pas qu’ils sont écrasés par des impositions indirectes, par des Excises, qui leur coûtent le double de ce qu’elles rapportent à l’État, et qui, par leur variation, exposent leurs Fermiers au danger terrible pour eux, pour les Propriétaires et pour la Nation, de ne pouvoir évaluer, en contractant leurs baux, les charges dont leur exploitation sera grevée ; ce qui les oblige à payer souvent ces charges aux dépens de leurs avances, et ce qui est ainsi une cause perpétuelle et sourde d’appauvrissement pour cette Île célèbre, qui n’a encore vu que la moitié du chemin qui devait la conduire à une prospérité solide.
[5] Voy. l’Agricult. par écon. de M. Maupin.
Dans les pays de vignoble, la dégradation suit une marche différente, mais qui revient au même pour les conséquences. Le Vigneron qui se trouve surchargé par un impôt imprévu, n’a plus le moyen de payer assez de journaliers, ni assez habiles, ni celui de se procurer des fumiers en quantité suffisante. La vigne mal façonnée et mal fumée produit moins. Le Vigneron appauvri par la diminution de récolte, qui se joint à la surcharge, ne peut faire les frais d’une vendange dirigée avec une lenteur intelligente ; il ne peut faire trier, et encore moins égrapper le raisin ; le vin devient plus mauvais. La diminution de qualité et de quantité le met hors d’état d’acheter du bon plant, quand il faut renouveler sa vigne. Il en vient enfin, à être obligé de cultiver quelques arpents de mauvais blé noir, pour se procurer la subsistance que la médiocre valeur de son vin lui refuse. Les vignes dégradées, et en quelque façon abandonnées, deviennent dans un état presque sauvage ; rampantes, si elles ne trouvent point où s’accrocher ; en hautins, si elles rencontrent quelques arbres. À la récolte on cueille rapidement tout le raisin, vert, mur, pourri, comme il se trouve ; on le jette dans une cuve, où on le laisse bouillir, et de laquelle il sort du vin comme il plaît à Dieu. Et le revenu de la plus riche culture du territoire est alors réduit à zéro, ou bien peu s’en faut.
[6] On estime que le produit net de la culture se partage de manière que les Propriétaires des terres ont les quatre septièmes, l’impôt deux septièmes, et la dîme un septième. Sur un anéantissement de six mille francs de produit net, causé par la perte du temps qu’auraient employé à la culture les Colons, qu’on en détourne pour faire sur les chemins un travail de cent francs, il y a donc environ 1 700 livres de perte pour le Roi, 3 400 livres pour les Propriétaires, et 850 livres pour les Décimateurs. Il est évident par là, que ces derniers qui ont un très grand intérêt à la construction et à l’entretien des chemins pour débiter avantageusement leurs dîmes, et qui souffrent une perte si considérable par les conséquences de la corvée, doivent concourir, à raison de cet intérêt, à la contribution nécessaire pour suppléer à la corvée et pour accroître leurs revenus, en construisant et réparant les chemins à prix d’argent.
[7] On dit, il est vrai, qu’il y a tant de chemins ouverts dans la Généralité de Caen, qu’il n’y a point ou presque point de Paroisses qui y fussent dispensées de corvées par leur éloignement des routes, et qu’ainsi l’arrangement qu’on a pris revient à peu près au même que si l’on avait réparti la dépense des chemins sur toute la Généralité. Je ne crois point cependant que cela revienne au même, à moins que toutes les Paroisses ne fussent dans le cas d’y travailler chaque année, ce qui n’est pas vraisemblable ; car si la dépense des chemins porte sur toutes les Paroisses alternativement, et non pas sur toutes à la fois, il en résulte seulement qu’elles ne sont surchargées que l’une après l’autre ; et quoique cette surcharge soit incomparablement moindre que n’était celle de la corvée, il s’ensuit toujours que leur sort est beaucoup moins avantageux que si elles avaient tous les ans à supporter une dépense égale, régulière et plus modique. D’ailleurs en joignant à la taille de toute la Province, la répartition générale de la contribution qui supplée à la corvée, un grand nombre de Particuliers qui étaient exempts de corvée, et qui ne le sont point de taille, concourent à la dépense des chemins et au soulagement de la Province. Ce qui ne peut arriver, quand on ne fait payer la contribution qu’à ceux qui auraient été obligés de marcher à la corvée dans l’année.
[8] Je n’ai pas voulu surcharger ce petit Ouvrage de détails de calculs fastidieux ; mais s’il trouve des contradicteurs, j’aurai l’honneur de leur répondre, et de publier alors les Éléments des mes calculs et mes pièces justificatives.
[9] C’est sans doute un grand bien que d’accoutumer peu à peu les Citoyens, à ne pas se regarder comme absolument étrangers à la chose publique ; de leur faire voir que l’on cherche leur bien, que l’on consulte leur goût, que l’on compte leurs voix, que l’on pèse leur opinion ; et de diriger ainsi les travaux utiles à l’État, non pas avec la tournure impérieuse des simples émanations de l’autorité, mais comme les arrangements économiques d’une Administration paternelle. Si l’on voulait songer combien ces petites choses et ces légères attentions peuvent, par degrés, élever l’âme de l’Homme et du Citoyen, lui inspirer le sentiment noble et doux de la dignité de son état, étendre ses lumières, faire germer le bonheur et la vertu chez une Nation ; on verrait, avec un transport de joie, que les soins du Gouvernement, qu’on a cru si pénibles, pourraient se réduire à un nombre très borné de moyens faciles et précieux d’enchaîner l’obéissance des hommes, par leur intérêt et par leur amour.
[10] Les grands Propriétaires pourraient se faire représenter dans ces Délibérations par leurs Régisseurs, leurs Receveurs, ou leurs Fermiers.
Associé à l’édition des Mélanges d’économie politique (éd. Guillaumin, 1848), le jeune Gustave de Molinari fut chargé de composer des notices biographiques sur chacun des auteurs du recueil. À l’endroit de Bentham, Molinari exprime les plus sincères éloges, saluant sa doctrine de l’utilité et la défendant même contre des sceptiques issus du rang des économistes libéraux français de son époque, comme L. Reybaud. B.M.
Notice sur Bentham, par Gustave de Molinari
Mélanges D’économie Politique, t.II, 1848
Bentham (Jérémie), le chef célèbre de l’école des Utilitaires, naquit le 15 février 1748 à Houndsdisch. Son père était membre de la compagnie des notaires de Londres. Dès sa plus tendre enfance, Bentham manifesta des dispositions extraordinaires ; il était, à l’âge de six ans, la merveille de l’école de Westminster. L’homme devait tenir, et au delà, toutes les promesses de l’enfant. Cependant Bentham subit un échec au début de sa carrière. Son père avait voulu en faire un avocat, croyant lui ouvrir ainsi le chemin des honneurs et de la fortune, mais il s’aperçut bientôt qu’il s’était trompé. « Le vieux Bentham, dit M. Louis Reybaud dans ses remarquables Études sur les réformateurs modernes, avait épousé en secondes noces Mme Abbot, mère de Charles Abbot, depuis lord Colchester. Jérémie et Charles débutèrent au barreau presque en même temps, et le père suivait avec le plus grand intérêt cette rivalité de famille. Ses vœux inclinaient naturellement pour l’enfant de son sang, et prévenu comme il l’était en faveur de Jérémie, il ne concevait pas le moindre doute sur l’issue de la lutte. Cependant les illusions paternelles durent céder à l’évidence. Charles Abbot marchait dans la carrière, d’un pas ferme et heureux, signalant chacun de ses essais par un triomphe, pendant que Jérémie, sur qui reposaient tant d’espérances, Jérémie, qui devait être la gloire du barreau de la magistrature, conquérir les sièges les plus élevés des cours de justice, et arriver même jusqu’aux sceaux de l’État, loin de justifier ce favorable augure, ce Jérémie, l’orgueil des siens, perdait chaque jour du terrain, et désertant la jurisprudence, inclinait involontairement vers l’improductive étude de la philosophie[1]. » Mais cet apprentissage de la chicane ne fut pas inutile à Bentham ; il vit, il toucha lui-même les abus de la législation anglaise, et il sentit la nécessité de les réformer. Il se mit donc à étudier les lois, non plus en praticien, mais en philosophe et en réformateur. Le premier résultat de ses études fut une Réfutation des Commentaires de Blackstone, publiée en 1776, sans nom d’auteur, sous ce titre : A fragment on government, being an examination of what is delivered on the subject in Blackstone’s commentaries. Ce fragment, dans lequel le jeune philosophe démolissait avec la logique serrée et vigoureuse qui le caractérise les sophismes de Blackstone, commença sa réputation ; depuis cette époque, jusqu’en 1832, année de sa mort, Bentham marcha sans se laisser arrêter un seul jour dans la voie qu’il s’était tracée. Aucun homme n’a plus travaillé que Bentham ; aucun homme, sauf peut-être Franklin, avec qui le chef des Utilitaires offre du reste certains points de ressemblance, n’a su mieux diviser et économiser son temps. L’existence de Bentham a été, au reste, consacrée toute entière aux spéculations de la philosophie. Bentham ne se mêla jamais au mouvement des affaires publiques.
Un instant, il faillit y être entraîné. C’était en 1781 ; il était devenu le commensal de lord Shelburne, depuis marquis de Landsdowne, qui lui avait accordé l’hospitalité dans sa magnifique résidence de Bowood. À cette époque, Bowood était le rendez-vous d’une foule de célébrités. On y voyait Camdeu, le célèbre jurisconsulte, avec son collaborateur Dunning, Bankes, Chatham, le jeune William Pitt, Samuel Romilly, Étienne Dumont de Genève. Un jour, lord Landsdowne offrit à Bentham de le faire nommer dans l’un des bourgs dont disposait la famille Shelburne ; Bentham parut d’abord n’attacher aucune importance à cette offre, mais ayant réfléchi, il pria instamment lord Landsdowne de tenir sa promesse. Le moment était mal choisi : lord Landsdowne, retiré des affaires, ne possédait plus qu’une influence assez restreinte ; il tacha donc d’éconduire poliment notre philosophe ; mais celui-ci, tenace et naïf, avait pris l’affaire au sérieux, et il écrivit un Mémoire de soixante-et-une pages à son noble amphytrion, pour lui démontrer la nécessité de tenir une promesse donnée un peu en guise d’eau bénite de cour. Lord Landsdowne eut toutes les peines du monde à extraire de la large cervelle de notre philosophe cette idée de la députation qu’il y avait implantée si imprudemment. Bentham s’absorba alors tout entier dans ses travaux de cabinet ; associé avec Étienne Dumont, qu’il avait rencontré à Bowood, il publia en français quelques-uns de ses plus importants ouvrages, les Traités de législation civile et pénale, la Théorie des peines et récompenses, etc. Auparavant, toutefois, il alla faire un voyage dans la Russie méridionale, où résidait son frère Someul qui était entré au service de la Russie. Ce fut dans ce voyage, et sur les bords de la mer d’Azoff, qu’il écrivit sa célèbre Défense de l’usure, sous ce titre : Defense of Usury, showing the impolicy of the present legal restraints on pecuniary bargains. Chef-d’œuvre de logique et de raison, la Défense de l’usure a beaucoup contribué à détruire les préjugés favorables à la fixation légale du taux des prêts à intérêts. Vingt ans auparavant, Turgot, dans son Mémoire sur les prêts d’argent, avait défendu comme Bentham, et avec non moins d’éloquence, la cause des préteurs à intérêts, et probablement est-ce dans le Mémoire de Turgot, que le philosophe anglais a puisé l’idée de ses fameuses lettres. Quoi qu’il en soit, la Défense de l’Usure suffit pour lui marquer une belle place parmi les économistes. Bentham a consacré aussi de nombreux ouvrages à la réforme pénitentiaire ; il est, pour ainsi dire, le père de cette réforme qui a commencé à s’accomplir en Amérique et qui se poursuit aujourd’hui dans l’Europe entière. En 1791, parut son Panopticon or the Inspection House, containing the idea of a new principle of construction applicable to any place of confinement, 3 vol. Le pénitentiaire modèle de Bentham avait été adopté par la commune de Paris, mais les événements de 1792 en empêchèrent l’exécution. Eu 1793, la Convention nationale décerna à Bentham le titre de citoyen français en compagnie de Thomas Payne, de Wilberforce, de Clarkson, de Pestalozzi, de Washington, de Klopstock, de Kosciusko et de plusieurs autres notabilités. Bentham adressa à la Convention une lettre de remerciements, dans laquelle on trouve une éloquente réclamation en faveur des émigrés. La même année, il publiait une Letter to a member of the national Convention, sur la nécessité de déclarer les Colonies indépendantes.
Nous donnons plus loin, d’après la Biographie universelle, la liste des nombreux ouvrages que Bentham a publiés depuis cette époque. De son cabinet, dont il sortait rarement, Bentham exerça la plus grande influence sur ses contemporains : en Angleterre, il entretenait des relations avec les principaux chefs du parti réformiste, Burdett, Hunt, Brougham, Cobbett ; il était lié aussi avec un grand nombre d’hommes éminents dans le reste de l’Europe, entre autres avec notre illustre J.-B. Say, à qui il a légué son portrait enchâssé dans une bague. Vers la fin de sa vie, Bentham eut pour collaborateur le docteur Bowring, qui se chargea de recueillir et de publier ses Mémoires. Bentham mourut le 6 juin 1832. Dans son testament, il enjoignit à ses héritiers de faire porter son corps à l’amphithéâtre de dissection, voulant ainsi être utile à ses concitoyens, même après sa mort. Les héritiers de Bentham crurent devoir respecter ses dernières volontés, et le corps de l’illustre philosophe fut porté à l’amphithéâtre, où il fut disséqué en présence d’un immense concours de monde.
Le plus beau titre de Bentham est la célèbre doctrine de l’utilité. Selon Bentham, il y a une coïncidence naturelle entre le juste et l’utile, le beau et le bon. La vertu n’est autre chose que l’intérêt bien entendu, et les criminels sont avant tout des hommes qui raisonnent mal, qui n’entendent point leurs véritables intérêts. On voit d’un coup-d’œil combien cette doctrine est féconde. Si, comme l’affirme Bentham, rien n’est utile à l’homme que ce qui est juste, si toute déviation de la route de l’honnête se traduit en fin de compte nécessairement en un dommage, combien il devient facile de faire accepter aux hommes la notion et la pratique du devoir ! Pourquoi seraient-ils méchants et vicieux, s’ils ont intérêt à être bons et vertueux ? Avec une telle doctrine, le mal ne peut plus venir que de l’ignorance ; car quel homme éclairé voudrait commettre un acte immoral, si cet acte doit en définitive lui être nuisible ? Ce qui est vrai pour les individus ne l’est pas moins pour les nations. Si toute infraction à la loi de justice entraîne nécessairement un dommage pour celui qui s’en rend coupable, quel peuple voudra désormais abuser de sa force pour opprimer ou spolier ses voisins ? Voyez combien la politique se trouve de la sorte simplifiée. Au lieu de chercher dans les calculs d’un étroit égoïsme ou dans les sombres inspirations de l’envie et de la haine, la règle de sa conduite, un peuple la cherchera uniquement dans la loi de la justice. La politique la plus habile et la plus sage consistera à suivre religieusement les prescriptions du droit des gens ; alors plus d’armées, plus de diplomatie ! À quoi serviraient en effet des gens de guerre et des diplomates ? Chaque nation se trouvant intéressée à être juste, tout conflit devient impossible, ou si quelque difficulté survient, elle est bientôt résolue par le droit sens des deux nations ; l’opinion publique, librement manifestée des deux cotés, indique la solution la meilleure ! Voilà où conduit la théorie de Bentham, et voilà aussi où conduit l’étude approfondie de l’Économie politique. Quand on observe le jeu naturel des intérêts humains, quand on étudie les lois qui président au développement et à la distribution de la richesse, on ne tarde pas à s’apercevoir que toute infraction au droit, à la justice, est toujours, soit médiatement, soit immédiatement, suivie d’une perte, d’un dommage ; d’où il suit qu’on doit condamner, au point de vue de l’utile, toute institution économique qui porte atteinte au principe du juste. L’étude des lois de la nature conduit donc les économistes au même point où l’étude plus spéciale des lois humaines a conduit Bentham, et très probablement c’est à l’Économie politique qu’il sera donné de populariser le principe mis en lumière par le célèbre philosophe anglais.
Dans son livre sur les réformateurs, M. L. Reybaud reproche à la doctrine de Bentham d’être étroite et desséchante. « Les vertus issues de l’utilité, dit-il, sont certainement des vertus plus étroites que celles qui dérivent du détachement : la simple réflexion l’indique et les faits le prouvent. C’est dans ce sens que les doctrines de Bentham ont exercé un effet fâcheux. On en retrouve l’influence dans cette soif immodérée du profit qui tourmente les générations actuelles, dans un besoin de jouissances chaque jour plus vif et plus général. Tous les moyens sont bons pour arriver à la fortune ; ce qui est utile semble toujours assez moral, et l’intérêt s’empare de la société. Sous cette action dissolvante, le calcul se glisse là où régnait le dévouement : dans l’enseignement, dans la magistrature, dans l’armée, dans les lettres, dans les arts, dans les sciences. Il n’est rien qui peu à peu ne devienne matière à spéculation, et dans plusieurs cas cette effervescence des intérêts va jusqu’à prendre le caractère d’une émotion publique. Des individus la contagion passe jusqu’aux États. Les peuples ne se battent plus pour un faux point d’honneur, mais ils se battent déjà pour la richesse. De mille côtés on se précipite vers l’utile de toute la vitesse du désir, en laissant le long du chemin ce qui fit la parure des générations antérieures : le désintéressement, l’abnégation, la modération dans la soif du bien-être. Ces ravages sont évidents, et il est impossible de n’y pas reconnaître l’action des doctrines de Bentham et de ses disciples[2]. »
Il nous semble que M. L. Reybaud se montre injuste à l’égard de Bentham et de ses disciples. Les maux qu’il déplore ne sont nullement contenus dans la doctrine de l’utilitarisme. Cette doctrine ne préconise pas plus les jouissances matérielles que les jouissances immatérielles, et ce n’est pas elle, certes, qui pousserait les peuples à se battre pour la richesse. Bentham envisage les choses de ce monde d’un point de vue plus élevé et plus large. Il spécule, il raisonne à la vérité, sur le bien et le mal, mais dans ses raisonnements et dans ses calculs fait-il un seul moment abstraction de la loi morale ? Tous ses raisonnements et tous ses calculs n’ont-ils pas pour objet de confirmer l’existence de cette loi et son utilité ? Serait-ce donc rabaisser la morale, la vertu, que de montrer qu’elle est utile, même en ce monde ? Sans doute, il serait fâcheux de n’arriver que par le calcul et par le raisonnement à l’observation de la loi morale ; mieux vaut y arriver naturellement, en obéissant à son instinct. Mais quand cet instinct est faible, quand le sens moral, pour nous servir de l’expression usuelle, est peu développé, n’est-il pas bon de le fortifier par le raisonnement et par le calcul ? N’est-il pas bon d’apporter au sentiment qui est notre guide naturel dans les actions de la vie, l’appui de notre intelligence ? Voilà ce que fait Bentham. S’il recommandait aux hommes de recourir au critérium de l’utile, alors même que ce critérium devrait dans la pratique être en contradiction avec celui du juste, oh ! alors, nous comprendrions les reproches de M. L. Reybaud et nous nous y associerions ; mais il n’en est pas ainsi : toute la doctrine de Bentham est fondée sur la coïncidence de ces deux principes, et nous ne croyons pas, en vérité, que les âmes dussent se trouver abaissées, parce qu’on leur aurait démontré, fût-ce par un calcul mathématique, qu’il y a plus d’utilité dans une action morale que dans une action immorale. Une semblable démonstration relève le principe de l’utilité, sans amoindrir aucunement celui du juste !
Pour les hommes qui possèdent à un haut degré le sens moral, la doctrine de Bentham, nous en conviendrons volontiers, n’a pas une grande utilité ; car dans ces âmes privilégiées, la loi du juste est la règle souveraine des actions : jamais un homme dont la moralité est parfaite ne s’arrêtera un instant à considérer les conséquences utiles ou nuisibles d’un de ses actes. Cependant, si cet homme croyait que la justice et l’utilité sont des principes antagonistes, au lieu d’être harmoniques, s’il n’était pas assuré qu’une action juste ne saurait nuire ni à lui-même ni aux autres, ne demeurerait-il pas plongé dans une perpétuelle inquiétude ? ne serait-il pas sans cesse ému de la crainte d’avoir nui aux autres, même par ses actions les plus morales, les plus honnêtes ? Ce repos du juste qui consiste dans la conscience intime de n’avoir nui à personne, ne serait-il point atteint profondément, et la vie ne deviendrait-elle pas pour l’honnête homme, comme pour le criminel, une succession continuelle d’inquiétudes et de tourments ?
Mais pour les âmes dans lesquelles la règle morale est faible, incertaine, combien plus salutaire encore est l’utilité d’une pareille doctrine ! Supposez qu’il y ait un antagonisme fatal entre le juste et l’utile, et aussitôt vous verrez la foule déserter le juste pour l’utile ! vous verrez toute considération de justice s’affaiblir dans le commun des âmes, et toute moralité disparaître de leurs actes. Alors le seul frein qu’on pourra opposer au désordre des passions, résidera dans la force ou dans une superstition grossière et l’ordre ne pourra être maintenu qu’avec l’auxiliaire de l’esclavage et de l’ignorance. Enseignez au contraire que la justice est la plus utile règle de conduite, enseignez aussi que l’honnêteté est la meilleure politique (honesty is the best policy), et aussitôt toute entrave, toute gêne apportées à la liberté humaine deviendront inutiles, aussitôt vous verrez le commun des hommes devenir, dans la pratique, moraux, honnêtes sous l’impulsion de l’intérêt. Sans doute, il vaudrait mieux qu’ils le devinssent par le fait d’un platonique amour pour l’honnêteté, pour la vertu ; mais cet amour, la doctrine de l’utilité n’empêche pas de les leur inspirer. Au contraire ! en les habituant à pratiquer la vertu sous l’influence d’un mobile inférieur, il est vrai, cette doctrine ne contribue-t-elle pas à le leur faire connaître ? Et, si peu morale que soit une nature, la connaissance de la vertu ne suffit-elle pas souvent pour lui en inspirer le goût ? Alors qu’arrive-t-il ? Il arrive le plus souvent que l’homme qui d’abord a été honnête par intérêt, le devient par amour pour l’honnêteté ? il arrive que l’utile le met sur la voie du juste. Vaudrait-il mieux que cet homme eût continué de croupir dans la fange de l’immoralité ? Non ! à coup sûr ! C’est donc se montrer bien injuste que d’accuser la théorie de Bentham d’éloigner les âmes de la moralité, tandis qu’elle est un des plus puissants et des plus admirables véhicules qui puissent y conduire.
À part cette appréciation inexacte, selon nous, de la moralité de la doctrine des Utilitaires, le brillant auteur du livre des Réformateurs a pleinement rendu justice au noble caractère et à la belle intelligence de Jérémie Bentham.
On divise ordinairement les ouvrages de Bentham en deux séries : la première comprend les ouvrages qui ont été publiés par Dumont, de Genève, sur les manuscrits de l’auteur ; la seconde, les ouvrages publiés en anglais, soit par Bentham, soit par son collaborateur Bowring.
La première comprend :
I. Introduction aux principes de morale et de jurisprudence. 1789,Londres,in-4. — II. Traités de législation civile et pénale. Paris, 1802, 3 vol. in-8. — III. Théorie des peines et des récompenses. Paris, 1812, 2 vol. in-8. — IV. Pièces relatives à la codification et à l’instruction publique, comprenant une correspondance avec l’empereur de Russie et diverses autorités constituées des États-Unis d’Amérique. Londres, 1817, 1 vol. in-8. — V. Traité des preuves judiciaires. Paris, 1823, 1 vol. in-8. —VI. De l’évidence judiciaire spécialement appliquée à la pratique anglaise. Londres, 1827, 5 forts vol. in-8. — VII. Panoptique, ou Maison d’inspection. Londres, 1791, 2 vol. in-12.— VIII. Code proposé à toutes les nations qui professent des idées libérales. Londres, 1822, 72 pag. in-8. — IX. Code constitutionnel. Londres, 1830. — X. Essai sur la tactique des assemblées politiques, suivi d’un traité des sophismes politiques. Genève, 1816, 2 vol. in-8. — À ces dix ouvrages, il faut ajouter la Déontologie, ou Théorie des devoirs, traduit par M. Benjamin Laroche. Paris, 1833. Réunis, ces ouvrages forment tout un corps de législation.
La seconde série comprend :
I. Fragments sur les gouvernements.Londres,1775. — II. Coup d’œil sur le bill relatif aux travaux forcés. Londres, 1778. — III. Défense de l’usure, ou Lettres sur l’inconvénient des lois qui fixent le taux de l’intérêt de l’argent. Londres, 1787, traduit en français sur la 4e édit. in-8 de 19 feuilles. Paris, 1827. À cette traduction se trouve annexé le Mémoire sur les prêts d’argent, de Turgot, et une introduction de M. Bazard, qui depuis fut l’un des chefs de la doctrine Saint-Simonienne. — IV. Esquisse d’un Code pour l’organisation judiciaire de la France. — V. Lettre à un membre de la Convention nationale. Londres, 1793. — VI. Émancipez vos colonies. Londres, 1793 (adressé à l’Assemblée législative). — VII. Finances sans charges ou échute au lieu de taxes. —VIII. Protestation contre les taxes, traduit en français dans la bibliothèque universelle de Genève. — IX. Plan d’administration pour les pauvres. 1797, traduit en français par Duquesnoy. — X. Lettre à lord Pelham, sur Botany-Bay. 1802. — XI. Plaidoyer pour la constitution. 1803 (toujours contre l’établissement de Botany-Bay, que l’on ne peuple, dit l’auteur, que par une violation de la Constitution). — XII. Réforme écossaise. 1806. Lettres à lord Grandville sur l’administration de la justice en Écosse. — XIII. Défense de l’économie contre Burcke. 1810-11. —XIV. Éléments de l’art d’assortir un jury. 1810-11. — XV. Sur la loi relative à la conviction. 1812. — XVI. Ne jurez pas. 1813 (Pamphlets contre le serment). — XVII. Tableau des motifs et des sources des actions. 1817. — XVIII. Chrestomathie. 1817, 2 vol. in-8. Divisée en deux parties : l’une traitant de l’Éducation, l’autre relative à la Classification des connaissances humaines. Le neveu de l’auteur sir, G. Bentham, a donné, sous le titre d’Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’art et de science, Paris, 1823, in-8, un extrait de cet ouvrage. — XIX. Considérations sur l’Église d’Angleterre et son catéchisme. 1817, énorme in-folio de 800 pages, notes, etc. — XX. Plan d’une réforme parlementaire. 1817, in-8 de 400 pages. — XXI. Bill de réforme radicale. 1819, avec notes. — XXII. Observations sur les restrictions et prohibitions apportées au commerce. 1820 (avec de nombreux rapports au décret des cortès espagnols de juillet 1820), rédigé par le docteur Bowring. —XXIII. Traité relatif aux affaires d’Espagne et de Portugal. 1821. — XXIV. Lettres au comte de Toreno, sur le Code pénal des cortès. (Bentham le critique amèrement.) 1822. — XXV. La vérité contre Ashurt. 1822. — XXVI. Principes fondamentaux d’un Code constitutionnel pour chaque État. 1827. — XXVII. Le livre des sophismes. 1824. —XXVIII. Dénonciations qui concernent lord Eldon. 1827 (contre les frais de justice, la rapacité des gens de loi). — XXIX. Pétition en faveur de la justice et de la codification. — XXX. J. Bentham à ses concitoyens les Français sur la peine de mort. — XXXI. J. Bentham à la chambre des pairs de France. — XXXII. Déclaration des principes des candidats parlementaires. — XXXIII. Du bill de banqueroute, etc. 1832.
On trouve des notices sur Bentham, dans la traduction allemande des Traités de législation, par Benecke ; dans l’Orbituary anglais de 1832 ; dans le Supplément à la Biographie universelle, article de M. Parisot ; des appréciations de sa doctrine et de ses œuvres, dans la préface des Souvenirs de Mirabeau, par Étienne Dumont ; dans les Études sur les réformateurs modernes, de M. Louis Reybaud, etc.
Gustave de Molinari
_______
[1] Études sur les Réformateurs ou Socialistes modernes, t. II, p. 187.
[2] Études sur les Réformateurs modernes, t. II, p. 260.
Ce n’est rien d’autre qu’une vie de sacrifice, de peines et de calomnies, qui fut le lot des premiers économistes français. Partisans tous deux, avec des nuances, d’une fiscalité proportionnelle sur tous les revenus, en lieu et place du système fiscal d’alors, et de la liberté du commerce des marchandises, Boisguilbert et Vauban se sont attirés, sous le siècle de Louis XIV, les plus sévères condamnations des ministres. Vauban, déjà malade, fut vivement accablé des poursuites faites contre lui et contre son livre Projet d’une Dime Royale (1707), et s’éteignit une semaine à peine après la condamnation du Conseil. Boisguilbert, visé par une condamnation le même jour de février 1707 pour son livre le Factum de la France, fut exilé à Brives-la-Gaillarde, malgré sa demande de pardon, sa promesse de ne plus se mêler des réformes économiques de la France, et malgré qu’il ait assuré avoir brûlé tous ses manuscrits. B.M.
Deux économistes proscrits au siècle de Louis XIV : Boisguilbert et VaubanMémoire de M. Boislisle, lu à l’Académie des Sciences morales et politiques, et publié en brochure en 1875.
Il est, dans l’histoire, de tristes épisodes que l’esprit se refuse à accepter sur la foi d’autorités plus ou moins récusables, et c’est ainsi qu’après avoir eu les preuves de la proscription du Projet de dîme royale, on a persisté à rejeter, ou du moins à discuter le seul témoignage contemporain qui nous fît connaître jusqu’ici les tristes suites de cette proscription et les causes de la mort de Vauban. Plutôt que de croire, d’après Saint-Simon, l’illustre maréchal abandonné du maître qu’il avait si bien servi, et atteint au cœur par les arrêts qui condamnaient son livre, on a relégué ce tableau au nombre des pages des Mémoires où certaines touches exagérées font douter de l’exactitude des souvenirs et de la véracité du chroniqueur.
Les documents inédits dont je vais faire connaître la substance à l’Académie, sont loin de faire la lumière complète, et nous pouvons encore espérer de nouvelles découvertes ; cependant celle-ci suffira, si je ne me trompe, pour justifier en plus d’un point le récit de Saint-Simon et montrer une relation directe entre la mort du maréchal et les rigueurs provoquées par les ministres de Louis XIV contre un livre qui les gênait.
L’Académie me permettra, tout d’abord, de rappeler en quelques mots les origines du Projet de dîme royale.
La pensée d’une réforme générale du système d’impôt avait été inspirée de bonne heure à Vauban par le spectacle du désordre et des misères que sa vie errante lui faisait découvrir dans toutes les parties du royaume. On a lieu de croire qu’il s’en ouvrit à Louvois vers l’année 1688, et qu’il fut fort mal reçu. C’est en 1691 que nous trouvons une première formule dans la Description de l’élection de Vézelai, et nous savons que, trois ans plus tard, une entrevue avec Pierre de Boisguilbert, qui allait faire paraître le Détail de la France, amena certaines modifications dans les idées ou le plan de Vauban. Mais on arrivait alors à l’année 1695 et à la capitation. Vauban proposa au roi un système de taxes progressives qui eût probablement changé les résultats de cette nouvelle imposition : n’ayant pas été accepté, il revint définitivement à celle qui lui semblait, de toutes, « la plus légale et la plus productive. » Il l’annonce sous le titre de « dîme » royale sur toutes les natures de revenus », dans une lettre qui doit être datée de janvier 1695. La paix de Ryswick étant venue peu après lui donner les deux ou trois premières années de loisir qu’il eût eues depuis un demi-siècle, il les consacra à la rédaction du Projet de dîme royale. Aussitôt que le manuscrit fut complet, vers la fin de 1699, il l’envoya au Contrôle général, en même temps qu’au roi. Chamillart et ses conseillers daignèrent accueillir avec intérêt cette communication, et ils consultèrent divers intendants sur ce que l’un de ces derniers, Foucault, appelle un « projet de capitation et de taille réelle d’après Vauban. » Quant à Louis XIV, il avait déjà reçu plus d’un avertissement, plus d’une révélation de ce genre sur l’état misérable de son royaume, et les manuscrits du château de Versailles sont encore là pour attester qu’il se trouvait parmi les courtisans et les sujets du grand roi assez de bons patriotes et d’hommes de cœur pour lui faire connaître la vérité. Cependant Saint-Simon dit que la communication de Vauban fut fort mal reçue du roi et de ses ministres. Il y a lieu de douter que ce passage de son récit soit exact, ou du moins se rapporte au manuscrit présenté en 1700 par Vauban : non seulement le contrôleur général Chamillart donna une attention particulière au projet qui lui arrivait sous les auspices d’un nom déjà illustre à tant de titres, mais il songea même à expérimenter le système de la Dîme, comme nous l’apprenons par une lettre de Boisguilbert, tout jaloux de ce succès. Il y a loin de là au mauvais accueil dont parle Saint-Simon, et Vauban n’eut point lieu d’abandonner son Projet, comme il l’aurait fait sans doute, si la froideur et le mécontentement du maître s’étaient manifestés aussi nettement que le disent les Mémoires. Pendant les trois années suivantes, malgré la reprise des opérations militaires, qui lui valurent enfin le bâton de maréchal, il ne s’occupa que de retoucher la forme de certaines parties de son manuscrit, sans rien changer au fond. À cette époque, il eut de nouvelles conférences avec Boisguilbert ; les renseignements que son émule rouennais possédait sur la statistique, lui étaient précieux, quoique, sur le chapitre des théories, il le considérât comme un « fou peu éveillé du côté de l’entendement » ; on voit, d’autre part, par les correspondances inédites, que Boisguilbert n’était guère plus respectueux dans son appréciation des idées économiques du maréchal, et ce serait un chapitre curieux à écrire que celui des relations de ces deux hommes, si différents de situation et de caractère, mais si constamment rapprochés par leur ardeur patriotique et leur naturelle intuition des principes économiques.
Les corrections de la Dîme furent terminées en 1704, pendant un séjour dans le Morvan. Vauban en fit alors relier une nouvelle copie pour le roi ; mais nous ignorons s’il put la présenter : ce fut seulement dans le cours de l’année 1706 qu’il se résolut à donner quelque publicité au livre qui était comme la conclusion, le couronnement de sa belle existence.
Jamais le mal n’avait été si pressant, ni les circonstances plus propres à démontrer l’urgence d’une réforme. Quel spectacle ! Roi et ministres se débattent au hasard dans un cercle vicieux, où seuls les traitants exécrés peuvent trouver leur profit. À l’intérieur, une misère générale ; à l’extérieur, des désastres répétés, honteux. Dans cette dernière lutte du désespoir, il faut faire argent de tout ; mais la France, haletant sous le fardeau, ne rend plus que des sueurs stériles. Les impôts ne donnent rien ; les fermes sont ruinées par des rabais successifs, les gabelles anéanties par le faux-saunage, la circulation monétaire entravée par le défaut de commerce, par le faux-monnayage, par le billonnage des étrangers, ou par ces folles variations du cours des espèces qui achèvent d’entraîner au dehors du royaume plus de la moitié de son numéraire. Tout annonce la banqueroute, la ruine.
Si le pays entier ne peut plus méconnaître ces symptômes effrayants de décomposition, quelles doivent être les angoisses des patriotes clairvoyants dont les prophéties sont allées, depuis tant d’années, s’engloutir dans les bureaux de ministres insouciants ou incapables ! Chacun comprend la nécessité d’un suprême effort, et, tandis que Boisguilbert lance de son côté le Factum de la France, paraphrase hardie et désespérée du Détail, Vauban se décide à courir les risques d’une publicité qui répugne cependant à son caractère tout autant qu’elle est familière au magistrat rouennais. C’en est fait. Il n’hésite plus à compromettre, s’il le faut, son crédit, son repos et les honneurs si laborieusement conquis en cinquante années du plus dur service. Le maître et ses froideurs sont redoutables ; mais qu’importent ces disgrâces passagères, lorsqu’on est habitué aux grossières rebuffades d’un Louvois ou aux injurieuses préférences de Chamillart pour le courtisan de la place des Victoires ! Et d’ailleurs Vauban n’a-t-il pas quelque droit de compter sur l’évidence du mal si universellement reconnu, sur le bon sens des ministres qui sont ses amis, ses égaux, sur le privilège des dignités et des hauts emplois dont le roi vient de l’honorer, enfin sur l’appui des hauts personnages qui ont été plus d’une fois les confidents de ses inspirations et qui représentent autour du trône la modération et la sagesse ?
À la fin de l’année 1706, Vauban revint pour la dernière fois à Paris. La campagne dans le Nord avait été glorieuse, mais fatigante : incommodé par un rhume tenace, il demanda un congé que motivaient et son âge, et l’état de sa santé, et même celui de ses ressources pécuniaires, promptement épuisées par le séjour à l’armée. Ce congé lui fut accordé au mois de novembre : quittant aussitôt Dunkerque, il arriva à Paris et s’installa dans son hôtel de la rue Saint-Vincent (aujourd’hui rue du Dauphin). Il ne tarda pas à y être rejoint par son commensal ordinaire, l’abbé Ragot de Beaumont. C’était un homme fort singulier, et même fort mal noté ; mais le maréchal l’utilisait comme collaborateur littéraire, et, pendant tout le temps qu’il pouvait consacrer à la rédaction de ses manuscrits, il avait l’habitude de lui donner l’hospitalité dans une dépendance de son hôtel, en communication directe avec son propre cabinet.
Durant ces derniers mois de 1706 et les premières semaines de 1707, ils travaillèrent à un traité de la Défense des places, destiné sans doute à l’instruction du duc de Bourgogne ; mais on s’occupa aussi, et surtout, de la Dîme royale, de son impression et de la distribution des exemplaires. Boisguilbert, dans une lettre au contrôleur général, dit que l’abbé de Beaumont avait composé la « meilleure partie » de l’ouvrage ; les études de Vauban et ses manuscrits protestent contre cette imputation, où il y a beaucoup du fait de la jalousie ; mais, quoi qu’il en fût de la collaboration de l’abbé, on peut penser qu’il avait profité de son séjour à Rouen — où le roi le tenait relégué depuis plusieurs années — pour faire imprimer le manuscrit du maréchal par quelqu’un de ces typographes normands qui donnaient tant de soucis à la police. L’impression s’étant faite sans privilège ni autorisation, des poursuites étaient à craindre, et il fallait agir prudemment. Aussi, lorsque deux premiers ballots de livres en feuilles arrivèrent aux portes de Paris, vers les derniers jours du mois de décembre 1706, ce fut le maréchal lui-même, dans son carrosse et aidé de ses gens, qui dut les recevoir furtivement et les introduire dans la ville. Des précautions analogues furent prises pour faire relier les exemplaires chez la veuve d’un nommé Fétil, qui possédait toute la confiance de Vauban depuis de longues années et qui avait déjà préparé en 1704 l’exemplaire de la Dîme destiné au roi. Ce travail fut pressé activement, les livraisons se firent avec mystère, et à mesure que Vauban reçut les volumes reliés, il se hâta de les distribuer à ses amis : c’était la seule publicité qu’il désirât, et il ne songeait pas à s’en cacher. De leur côté, les visiteurs qui venaient à la rue Saint-Vincent ne se faisaient aucun scrupule de solliciter le don d’un exemplaire, car la nouveauté du projet et le renom de l’auteur piquaient la curiosité de tous : personne n’eût pu soupçonner combien ce succès devait être fatal à Vauban.
Je ne saurais citer ici en entier les pages émues où Saint-Simon a raconté la disgrâce du maréchal et la proscription de son livre. Il est cependant indispensable d’en reproduire quelques passages, dont l’exactitude plus ou moins grande ressortira mieux des documents qui viendront ensuite.
« À la vérité, dit-il, le livre de Vauban donnait au roi plus qu’il ne tirait par les voies jusqu’alors pratiquées ; il sauvait aussi les peuples de ruine et de vexations, et les enrichissait en leur laissant tout ce qui n’entrait point dans les coffres du roi, à peu de choses près ; mais il ruinait une armée de financiers, de commis, d’employés de toute espèce… C’était déjà de quoi échouer. Le crime fut qu’avec cette nouvelle pratique, tombait l’autorité du contrôleur général, sa faveur, sa fortune, sa toute-puissance, et, par proportion, celles des intendants des provinces, de leurs secrétaires, de leurs protégés… Il n’est donc pas surprenant que tant de gens si puissants en tout genre, à qui ce livre arrachait tout des mains, ne conspirassent contre un système si utile à l’État, si heureux pour le roi, si avantageux aux peuples du royaume, mais si ruineux pour eux. La robe entière en rugit pour son intérêt…
« Les liens du sang fascinèrent les yeux aux deux gendres de Colbert, de l’esprit et du gouvernement duquel ce livre s’écartait fort, et ils furent trompés par les raisonnements vifs et captieux de Desmaretz… Chamillart, si doux, si amoureux du bien… tomba sous la même séduction. Le chancelier, qui se sentait toujours d’avoir été, quoique malgré lui, contrôleur général des finances, s’emporta. En un mot, il n’y eut que les impuissants et les désintéressés pour Vauban et Boisguilbert, je veux dire l’Église et la Noblesse ; car, pour les peuples qui y gagnaient tout, ils ignorèrent qu’ils avaient touché à leur salut, que les bons bourgeois seuls déplorèrent.
« Ce ne fut donc pas merveilles si le roi, prévenu et investi de la sorte, reçut très mal le maréchal de Vauban, lorsqu’il lui présenta son livre, qui lui était adressé dans tout le contenu de l’ouvrage. On peut juger si les ministres à qui il le présenta lui firent un meilleur accueil. De ce moment, ses services, sa capacité militaire, unique en son genre, ses vertus, l’affection que le roi y avait mise jusqu’à se croire couronné de lauriers en l’élevant, tout disparut à l’instant à ses yeux ; il ne vit plus en lui qu’un insensé pour l’amour du public, et qu’un criminel qui attentait à l’autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne ; il s’en expliqua de la sorte sans ménagement.
« L’écho en retentit plus aigrement dans toute la nation offensée, qui abusa sans ménagement de sa victoire ; et le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître, pour qui il avait tout fait, et mourut peu de mois après, ne voyant plus personne, consommé de douleur et d’une affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle le roi fut insensible, jusqu’à ne pas faire semblant de s’apercevoir qu’il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. Il n’en fut pas moins célébré par toute l’Europe et par les ennemis mêmes, ni moins regretté en France de tout ce qui n’était pas financier ou suppôt de financier. »
Ainsi, Saint-Simon désigne comme principaux auteurs de la disgrâce qui allait coûter la vie à Vauban, d’abord les deux gendres de Colbert, MM. de Beauvillier et de Chevreuse ; puis, le neveu du même Colbert, Desmaretz, redevenu tout-puissant depuis 1703 et considéré comme le véritable ministre des finances, quoiqu’il n’eût à cette époque que le titre de directeur général ; puis encore, le contrôleur général lui-même, ce Chamillart « si doux, si amoureux du bien » ; enfin, le chancelier de Pontchartrain.
Bien que les deux beaux-frères dénoncés en première ligne eussent avec Saint-Simon une intimité de tous les instants, il faudrait des preuves bien authentiques pour accepter une accusation aussi grave : le duc de Bourgogne et ses conseillers, parmi lesquels MM. de Beauvillier et de Chevreuse tenaient le premier rang, avaient fait bon accueil aux premiers projets du maréchal ; comment admettre une odieuse coalition des chefs du parti humanitaire avec la finance, contre l’homme qui était la plus haute expression des vertus patriotiques ?
Chamillart et Desmaretz offraient au contraire une prise facile aux influences, aux suggestions intéressées de cette « armée de financiers, de commis, d’employés de toute espèce », qui rongeait le pays sous le couvert du Contrôle général. Tous deux étaient excédés, depuis sept ou huit ans, par des légions de donneurs d’avis et de faiseurs de systèmes, auxquels ils n’avaient jamais su emprunter que des expédients désastreux pour vivre au jour le jour, quand des réformes radicales eussent été le seul remède efficace. Tout dernièrement, ils n’avaient eu qu’à se repentir d’un essai du système de Boisguilbert sur quelques paroisses de l’Orléanais, et l’insuccès de cette tentative, du aux mêmes obstacles qui avaient toujours entravé les améliorations les plus simples, était une preuve convaincante pour le Contrôle général de l’inanité de ces grands projets, comparée au commode roulement des affaires extraordinaires. De ce côté, la lassitude et l’aigreur étaient donc au comble ; l’audace de Vauban dut faire perdre toute mesure au ministre et à son collaborateur ; car, à ne considérer que la nouveauté des idées, Vauban était infiniment plus révolutionnaire dans le Projet de dîme royale que Boisguilbert dans le Détail de la France. Que demandait celui-ci, si ce n’est une exacte et raisonnable observation des anciennes ordonnances, basées sur les lois de la nature ? Bien autrement exigeant, le maréchal voulait bouleverser de fond en comble le système financier et substituer aux procédés empiriques une forme unique d’imposition et de perception. Dangereuse chimère, dont la production au grand jour était bien propre à compliquer les embarras politiques ! On conçoit donc que la finance, harcelée sans relâche, osât réclamer une répression exemplaire. Et cependant, rien jusqu’ici ne prouve positivement que le contrôleur général ou Desmaretz aient pris l’initiative des poursuites dirigées contre la Dîme royale ou même participé à ces rigueurs. Les minutes des dépêches du Contrôle général, les liasses de lettres adressées aux bureaux de Chamillart et de Desmaretz, la correspondance de l’intendant de Paris et du lieutenant général de police avec le Contrôle, ont été fouillées à plusieurs reprises : il ne s’y trouve aucune trace de l’affaire, pas même une simple mention du livre du maréchal ou de sa mort. Nous n’avons donc encore de ce côté que des présomptions, et point de preuves pour justifier les dires de Saint-Simon.
Mais, si nous en venons au chancelier de Pontchartrain, son rôle et celui de l’exécuteur dévoué de ses hautes volontés, le lieutenant général de police d’Argenson, sont faciles à établir, grâce aux documents dont j’ai annoncé la découverte.
Je serais d’autant plus embarrassé de faire entrer dans le cadre de ce mémoire les portraits du chancelier et de son célèbre collaborateur, que leurs personnalités ont déjà été étudiées sous des faces fort différentes, et qu’il faudrait discuter les témoignages ou les jugements. Cette critique sera faite quelque jour, à l’aide des correspondances et des documents administratifs mis récemment au service de l’histoire ; ici, je me bornerai à rappeler le rôle du chancelier et du lieutenant général dans l’organisation de la police, et plus particulièrement leurs rapports avec cette race de plus en plus nombreuse et remuante des gens de presse, dont l’agitation fut une cause d’inquiétude constante pendant la dernière partie du règne de Louis XIV. En ces matières, M. de Pontchartrain n’eût pu souhaiter un agent plus aveuglément dévoué, et partant plus redoutable, que Marc-René d’Argenson. La rudesse du chancelier, — cette rudesse qu’on découvre jusque dans les portraits les plus flattés, — s’accommodait à merveille avec « l’écorce brusque et « dure » et la « mine de juge d’enfer » du successeur de la Reynie. Impitoyables l’un et l’autre pour tout ce qui était auteurs, imprimeurs ou libraires, ils ne s’en rapportaient qu’à eux-mêmes pour examiner les livres incriminés ; avec de pareils juges, point de merci à espérer. Pontchartrain, qu’un pamphlet du temps dépeint « tourné tout entier vers son maître et vers soi-même, sans donner jamais un regard au public, et renchérissant sur tous ses prédécesseurs pour mériter la haine des peuples » ; — d’Argenson, accoutumé de vieille date « au petit et au rétréci », ne faisaient, on le sait, aucune distinction entre les Maximes des Saints ou le Télémaque et les pièces obscènes ou les gazettes clandestines. Surtout en ce qui touchait les questions gouvernementales et administratives, la prohibition d’écrire ou de discuter était absolue. D’Argenson, à ses débuts, avait fait supprimer le portrait du maréchal-ferrant de Salons, parce qu’on lisait au bas de la gravure une centurie de Nostradamus terminée par ce vers ;
« En retirant un grand peuple d’impôts. »
Et depuis lors, sa jurisprudence avait toujours été la même : le pilon pour les livres, l’exil pour l’auteur, s’il persistait à lutter, ou même une place dans quelque tour de la Bastille, côte à côte avec le faussaire de Bar, le romancier des Courtils de Sandras ou les empoisonneurs.
S’il faut en croire Saint-Simon, dans ses annotations au Journal de Dangeau, ce fut précisément ce que les financiers osèrent réclamer à l’apparition du Projet de dîme royale : la Bastille pour le maréchal, le bourreau pour son livre. « Le roi, dit-il, ne put s’y résoudre, mais ne laissa pas de se laisser entraîner à ce torrent, assez pour contenter ses ministres, assez pour scandaliser étrangement sa cour, assez pour tuer le meilleur des Français. » Il en devait être ainsi, puisqu’aucune considération ne pouvait arrêter les deux magistrats qu’il avait fait juges souverains en ces matières, ni le nom de l’auteur de la Dîme royale, ce nom qui « honore l’humanité », ni la dignité de maréchal de France, ni la bonne foi du livre, ni la dédicace au roi, toute brûlante de loyauté et de patriotisme, ni enfin, à la dernière page, cette invocation suprême où Vauban s’écriait : « Je n’ai plus qu’à prier Dieu de tout mon cœur que le tout soit pris en aussi bonne part que je le donne ingénument, et sans autre passion ni intérêt que celui du service du roi, le bien et le repos de ses peuples. »
C’était ainsi que Vauban avait cherché à s’acquitter envers son prince et son pays ; on va voir comment les ministres de Louis XIV entendaient les devoirs de leur charge.
À peine quelques exemplaires de la Dîme royale avaient-ils pu circuler entre les mains des amis du maréchal, que le chancelier en fut averti et se saisit de l’affaire. On sait que, pour les contraventions de librairie, l’arbitraire tenait trop souvent lieu de loi : le chancelier, le ministre de la maison du roi, le lieutenant général de police et le procureur général du Parlement se partageaient un véritable droit de vie et de mort sur les publications non autorisées. Dans la plupart des cas, une simple lettre de cachet, un ordre à quelque commissaire, sans autre forme de procès, suffisaient pour arrêter l’essor du nouveau livre. Lorsque les divulgations étaient moins à craindre, la procédure pouvait suivre une voie plus régulière en apparence et prendre la forme d’un arrêt du Conseil, rendu sous le nom du roi. La Dîme royale se trouvait dans ce cas : ni le lieutenant général, ni le chancelier ne pouvaient agir de leur propre mouvement, puisqu’ils savaient rencontrer au bout des poursuites le nom du plus illustre maréchal de France. Mais, d’autre part, en portant l’affaire au Conseil des finances ou à celui des dépêches, ils y eussent trouvé trop d’esprits indépendants, trop d’amis de Vauban, trop d’admirateurs du livre incriminé. Le chancelier s’adressa donc à une autre section, le Conseil privé, qui avait pour mission ordinaire de juger les appels contre les intendants, les contestations entre Compagnies ou entre parties, les difficultés d’exécution des édits, arrêts ou ordonnances, mais non point les questions de police et d’administration. Là, le roi ne paraissait presque jamais aux séances ; le chancelier présidait à sa place, au-dessus des conseillers ordinaires ou semestres, auxquels se joignaient le contrôleur général et les intendants des finances ; les rapports étaient faits par des maîtres des requêtes. Celui que M. d’Argenson employait presque toujours pour les affaires de librairie et d’imprimerie fut chargé de préparer l’arrêt contre la Dîme royale. Ce magistrat se nommait Marc-Antoine Turgot de Saint-Clair ; je me hâte d’ajouter qu’il n’appartenait point à la branche de la famille Turgot où devait naître quelque vingt ans plus tard l’illustre défenseur de la liberté et de la tolérance.
L’affaire ne fut probablement pas soumise à une délibération. Le 14 février, parmi les arrêts expédiés dans la séance du Conseil, le rapporteur et le chancelier signèrent celui qui condamnait la Dîme, et, pour faire en quelque sorte que son initiative fût à jamais prouvée de la façon la plus flagrante, Pontchartrain corrigea de sa propre main le texte ainsi conçu : « Sur ce qu’il a été représenté au roi qu’il se débite à Paris un livre portant pour titre : Projet d’une dîme royale, etc., imprimé en 1707, sans dire en quel endroit, et distribué sans permission ni privilège, dans lequel il se trouve plusieurs choses contraires à l’ordre et à l’usage du royaume… le roi, en son Conseil, ordonne qu’il sera fait recherche dudit livre et que tous les exemplaires qui s’en trouveront seront saisis et confisqués et mis au pilon. Fait S. M. défense à tous les libraires d’en garder ni vendre aucun, à peine d’interdiction et de 1 000 livres d’amende. » [1]
Quoique le nom de Vauban ne fût pas prononcé, l’arrêt était rendu en parfaite connaissance de cause ; car, manuscrit ou imprimé, l’origine du Projet d’une dîme royale était connue depuis longtemps dans l’entourage des ministres. Cependant il semble que tout se consomma dans le plus profond secret, information, procédure et jugement ; ni à Versailles, ni à Paris, ni au Contrôle général, ni à la Chancellerie, Vauban, qui était en correspondance suivie avec Chamillart et qui lui avait même adressé, le 13 février, veille de cette condamnation, un mémoire sur la canalisation de la Durance, Vauban ne sut rien de personne et continua de distribuer ses volumes à mesure que le relieur les lui rapportait. Cette inaction de la police s’explique par la forme imparfaite de l’arrêt du 14 février : le chancelier n’avait négligé qu’un point, c’était de désigner pour faire les poursuites le magistrat de qui ce soin devait dépendre, selon que la Dîme avait été imprimée à Paris ou ailleurs. Il fallut donc refaire un nouvel arrêt. Celui-ci fut daté du 14 mars, et, comme le précédent, Pontchartrain le corrigea de sa main, ajoutant après les mots « ledit livre se débite encore à Paris », cette mention évidemment erronée : « et même il y a été imprimé. » Le délit rentrant ainsi dans les attributions du lieutenant général de police de Paris, l’arrêt concluait en ces termes : « Le roi ordonne en outre qu’il sera informé par le sieur d’Argenson, que S. M. a commis et commet à cet effet, de l’impression dudit livre, ensemble du débit d’icelui, pour, l’information rapportée et vue au Conseil, être ordonné ce qu’il appartiendra. Signé : Phélypeaux et M.-A. Turgot. » [2]
Le même jour, un arrêt identique, signé de même et également corrigé de la main du chancelier, frappait Boisguilbert et son Factum de la France, en confiant le soin des poursuites à l’intendant de Rouen. [3] On verra plus loin ce qu’il en advint et comment l’économiste rouennais supporta la proscription.
À Paris, d’Argenson fit de son mieux pour satisfaire le chancelier, et chargea des informations un commissaire dévoué et actif, Nicolas Delamare, l’auteur du Traité de la police. Mais tout d’abord, quand on interrogea les plus fameux colporteurs de livres défendus, un fait constant ressortit de leurs réponses : le maréchal avait pris toutes ses précautions pour qu’aucun exemplaire de la Dîme n’entrât dans la circulation publique ; il se réservait de distribuer lui-même les volumes à ses amis, et pas un marchand n’avait pu en obtenir un seul du relieur chez qui était encore déposée une partie de l’impression. En faisant part de ces renseignements et en offrant de pratiquer une saisie chez le relieur, l’honnête Delamare, qui n’était instruit que très sommairement de l’affaire, et qui avait ignoré jusque-là l’existence des arrêts du Conseil, ainsi que le nom de l’auteur, ajouta timidement : « Mais, si ce que l’on dit est vrai, toute la preuve retombera sur M. de Vauban ! » D’Argenson ne connaissait pas de pareils scrupules ; à l’observation de son agent, naïf et touchant témoignage du sentiment public, il répondit par ces mots : « Quand il s’agit de recevoir les ordres du roi, ce n’est pas à nous à prévoir les conséquences. » [4] Delamare dut mettre en campagne le commissaire Dammon et ses agents ; mais tout était déjà consommé, les rigueurs devenaient inutiles et le mal irréparable : Vauban était frappé à mort.
Instruit le 24 mars, au soir, des recherches de la police et des arrêts rendus contre son livre, le maréchal avait envoyé l’un après l’autre ses deux valets de chambre retirer le reste des exemplaires dont la reliure était terminée. Le même jour, après avoir mis sous clef ces volumes, il ressentit les premières atteintes du mal qui devait le terrasser en moins d’une semaine. Voici comment cette triste fin est racontée dans la déposition d’un témoin familier, le valet de chambre qui fut arrêté un peu plus tard et interrogé par d’Argenson lui-même. [5]
« Toute l’après-dînée du 24 mars, le maréchal avait paru fort chagrin de la nouvelle qu’il avait apprise que M. le chancelier faisait chercher son livre, et sur le soir la fièvre le prit. Il se mit au lit et fut fort mal le vendredi et le samedi suivants. Le dimanche matin, la fièvre ayant diminué, il donna ordre au valet de chambre de prendre dans son cabinet deux de ses livres, de les porter au sieur abbé de Camps, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, et de le prier de les examiner et de lui en dire son sentiment. » C’était l’évêque démissionnaire de Pamiers, bien connu pour ses travaux littéraires et ses collections historiques : il répondit qu’il parcourrait le volume et rendrait compte de cet examen au maréchal. « Pendant la maladie du maréchal, qui ne dura que six jours, le valet de chambre donna par son ordre l’un de ses livres au sieur Chemineau, son chirurgien, et un autre à un frère jacobin, son confesseur, qui prêchait au couvent de l’ordre, rue Saint-Honoré ; et en donnant ledit livre audit confesseur, le maréchal lui dit qu’il le priait de le lire et de lui dire si, en le composant, il avait rien fait contre sa conscience. Le valet de chambre en donna aussi un au P. Labat, aussi jacobin dudit couvent. [6] Le mercredi 30me du mois de mars, sur les neuf heures trois quarts du matin, ledit maréchal décéda… »
Cette mort eût dû arrêter le chancelier et sa police, leur faire ouvrir les yeux, les accabler de honte et de douleur. Il n’en fut rien, et le corps du maréchal venait à peine de partir pour le Morvan, que Delamare fit une descente dans l’atelier de reliure de la rue Saint-Jacques (2 avril). On n’y saisit que quelques feuilles de rebut ; mais d’Argenson persista, et, au bout de quinze jours, il voulut interroger lui-même la veuve Fétil, ainsi que sa fille et le compagnon relieur qui avait aidé à porter le dernier lot de volumes. Ne fallait-il pas, à tout prix, découvrir le lieu d’impression et prouver que Vauban destinait son livre à recevoir plus de publicité que ne l’avaient témoigné les premières informations ? N’ayant encore rien tiré de ces interrogatoires, le lieutenant général et le chancelier sommèrent les gendres du maréchal de représenter le paquet d’exemplaires rapporté à la rue Saint-Vincent, le 24 mars. MM. de Villebertin et d’Ussé revenaient de Bazoches, où le corps de leur beau-père avait été enseveli le 16 avril, au milieu d’un concours immense d’assistants. Mais ils s’étaient hâtés, aussitôt le maréchal mort, de transporter les volumes reliés dans la chambre de l’abbé de Beaumont, tandis que le petit-fils du maréchal, M. d’Aunay, enlevait les autres livres, y compris les manuscrits et papiers. On put donc répondre que rien n’était resté sous les scellés. [7]
Ce double insuccès, cette absence totale de preuves compromettantes, dépitèrent d’Argenson ; il mit la main sur le valet de chambre Collas, et essaya d’en tirer quelques lumières. « Ne ménageons plus cet homme, qui ne parle pas de bonne foi », écrivait-il à Delamare. Le malheureux serviteur fut tenu pendant un mois environ au Petit-Châtelet, et, lorsque tous les commissaires se furent évertués en vain à le faire parler, d’Argenson alla en personne l’interroger dans la chambre du concierge des prisons. Sa déposition[8], dont j’ai déjà cité un passage, eut toutes les apparences de la sincérité et de l’exactitude ; mais elle n’apprit rien de nouveau au chancelier, et dut le confirmer, au contraire, dans la conviction que l’affaire ne pourrait aller plus loin. Peut-être, si l’abbé de Beaumont n’avait pris les devants et quitté Paris, la police l’eût-elle saisi comme principal complice : elle ne put que faire une descente chez lui, dans cet hôtel Saint-Jean qui communiquait avec la demeure de Vauban. [9] Outre deux exemplaires qui étaient restés dans la chambre de l’abbé, on y trouva : 1° le manuscrit d’un carton que le maréchal avait préparé le 19 mars[10] ; 2° un écrit intitulé : Deuxième addition pour répondre aux plaintes de la Noblesse contre le système de la Dîme royale mal entendu. Ceci parut au commissaire une preuve évidente qu’on avait projeté une réédition de l’ouvrage proscrit. Enfin, un troisième manuscrit, découvert au même endroit, dans une cassette, intrigua considérablement Delamare. Le titre en était : Objections de M. le P. contre le Projet de la dîme royale et réponse de l’auteur dudit Projet. Ces initiales « M. le P. » ne signifiaient-elles pas « M. le Prince de Condé » ? — Nous croyons que Delamare s’inquiétait bien à tort : il est probable que les Objections n’étaient autre chose que le premier travail d’un magistrat de Dunkerque, nommé Jean le Potier de la Hestroy, et accrédité parmi les conseillers secrets du Contrôle général ; elles parurent plus tard, en 1716, avec des remaniements importants, sous le titre de : Réflexions sur le traité de la Dîme royale.
Il ne restait plus à d’Argenson et au chancelier qu’à clore les poursuites et rendre la liberté au valet de chambre Collas. Nous n’avons pas besoin d’ajouter que la Dîme royale demeura proscrite, et que les ordres les plus rigoureux, mais les plus inutiles, furent maintenus pour en empêcher le débit.
Quant aux interrogatoires et aux procès-verbaux d’information ou de saisie, ils restèrent entre les mains de Delamare, avec la correspondance échangée entre ce commissaire et M. d’Argenson ; tous ses papiers étant passés à la Bibliothèque, c’est là que j’ai retrouvé les documents relatifs à la Dîme[11], sur l’indication du savant éditeur des Archives de la Bastille, M. François Ravaisson.
Tels sont les faits précis : quelles conclusions en tirer ?
Vauban, nous le savons déjà, était affaibli par l’âge et par les fatigues de la vie militaire : il souffrait depuis longtemps d’une toux opiniâtre, devenue encore plus pénible dans la campagne de 1706, et Fontenelle dit positivement qu’il succomba à une fluxion de poitrine. Mais, ayant en main les nouveaux documents, et surtout la déposition du valet de chambre Collas, est-il possible de douter que le mal n’ait été aggravé et la catastrophe précipitée par l’arrêt de proscription de la Dîme, par les cruelles anxiétés et l’amer désespoir que Vauban dut ressentir en voyant son livre condamné et son patriotisme méconnu ?
On a déjà discuté des faits analogues, car les cas de disgrâce ne sont que trop communs dans l’histoire du grand règne. Ici, les pièces les plus authentiques ne me semblent guère laisser de place à l’incertitude quant aux causes d’une si rapide mort ; de plus, elles permettent de déterminer avec beaucoup de vraisemblance la part de responsabilité de chacun. Je crois avoir démontré que le chancelier et le lieutenant général de police manquèrent absolument à leur devoir de bons serviteurs, qui était d’éclairer le prince et de faire fléchir la loi, si tant est qu’elle fût en jeu, devant le nom du plus honnête et du plus dévoué des sujets. Alors même que les mesures de rigueur eussent pu se justifier par la nécessité de prévenir des excitations inquiétantes pour la tranquillité du royaume et de cacher ses misères aux ennemis[12], il reste tout au moins l’odieux des procédés que nulle raison d’État n’autorisait à employer contre la Dîme royale, contre Vauban.
Est-ce à dire que la responsabilité de Louis XIV se trouve ainsi dégagée, aux dépens de celle de ses ministres ? Non certes, car on ne saurait admettre qu’il n’ait point connu, et par conséquent autorisé, des poursuites qui visaient un maréchal de France, et qui durèrent un mois et demi. Le bulletin de Versailles, tenu si minutieusement par Dangeau, nous montre le roi, pendant les mois de février et de mars 1707, en rapports constants avec les personnes qui pouvaient le mieux l’instruire. Le lundi, 14 février, jour où fut signé le premier arrêt, il présida le Conseil des dépêches et y vit le chancelier et Chamillart. Le soir, chez Mme Maintenon, il reçut le directeur général des fortifications, dont les relations avec Vauban étaient des plus fréquentes, sinon des plus amicales, et qui avait même eu ses premières confidences sur la Dîme. Le jour suivant, il y eut encore Conseil des finances et travail avec le fils du chancelier.
Passant à la date du second arrêt, nous voyons que Chamillart était alors incommodé, mais qu’il venait cependant travailler le soir chez Mme de Maintenon ; son portefeuille regorgeait de propositions et de projets de finances entre lesquels il dut vraisemblablement citer la Dîme royale. Le lundi 14 mars, la cour ne s’occupa que de chasse et de présentations ; mais le 15 était jour de Conseil des finances, et il n’est pas à supposer que, dans l’une ou l’autre des réunions que le roi présida en personne, personne ne l’informa de la marche des choses. Peut-on en douter, quand il est si bien connu, si bien établi, que les moindres affaires, avant de passer au Conseil ou dans le portefeuille, lui étaient religieusement soumises et ne recevaient de solution qu’après cette formalité obligatoire ? Lui-même l’a dit dans ses Mémoires : « On me vit toujours marcher constamment dans la même route, vouloir être informé de tout ce qui se faisoit, écouter les prières et les plaintes de mes moindres sujets… recevoir les dépêches, faire moi-même une partie des réponses… me faire rendre compte par ceux qui étoient dans les emplois… distribuer les grâces par mon propre choix, conserver, en un mot, seul toute mon autorité… » Bien que l’âge fût venu, cette minutieuse ingérence dans tous les détails du gouvernement était la même en 1707 qu’en 1661. On dira, avec le plus récent historien des secrétaires d’État[13], que le pouvoir absolu restait de fait aux agents, aux ministres, qui ne présentaient à leur maître que la surface des questions, en lui proposant, lui imposant leur propre solution ; et peut-être Saint-Simon n’a-t-il guère exagéré l’omnipotence des ministres, ces « cinq rois de France, qui exerçaient à leur gré la tyrannie sous le roi véritable, et presque tout à son insu. » C’est ce que Fénelon avait dénoncé plus anciennement, dans sa fameuse lettre de 1693 : « Chaque ministre a été le maître dans l’étendue de son administration. … Ils ont été durs, hautains, injustes, violents, de mauvaise foi ; ils n’ont connu d’autres règles que de menacer, que d’écraser, que d’anéantir tout ce qui leur résistait. Ils ne vous ont parlé que pour écarter de vous toute vérité qui leur pouvait faire ombrage. »
Mais, encore une fois, ces réserves ne sont pas applicables au cas de là Dîme royale, et la responsabilité première de la condamnation remonte jusqu’au roi, telle qu’il la réclamait. Voyons d’ailleurs comment il accueillit les nouvelles de la maladie et de la mort du maréchal.
Le lundi 28 mars, il avait pris médecine, puis fait son travail ordinaire avec M. le Peletier de Souzy, quand Fagon vint l’avertir à son dîner que le maréchal était à l’extrémité et demandait qu’on lui envoyât le premier médecin de Monseigneur. « Le roi, nous dit Dangeau, ordonna que Boudin partît sur l’heure, et parla de M. de Vauban avec beaucoup d’estime et d’amitié. Il le loua sur beaucoup de chapitres, et dit : Je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l’État. » [14] Le lendemain 30, avant qu’on partît pour Marly, la nouvelle de la mort fut apportée par des courtisans qui « demandaient les charges », et le partage de cette dépouille se fit dès le soir même, chez Mme de Maintenon.
On chercherait en vain un autre souvenir de la mort de Vauban dans ce journal si fidèle, si complet, et encore est-il à remarquer que Saint-Simon, rédigeant ses propres Mémoires d’après Dangeau, n’a plus tenu compte des paroles prononcées par le roi à son dîner. [15] C’était beaucoup pourtant que cette manifestation publique et solennelle des regrets du maître ; souvenons-nous des billets de simple condoléance écrits à la veuve et au fils de Colbert, ou, pis encore, du soulagement que Louis XIV témoigna lors de la mort des plus fidèles, Louvois, Seignelay, l’idolâtre La Feuillade. L’abbé de Choisy a dit quelque part que les ministres « ne savaient plus au juste s’ils étaient dignes d’amour ou de haine », et c’est au lendemain de la mort de Colbert que le moraliste écrivit cette phrase amère : « Les grands sont si heureux qu’ils n’éprouvent même pas dans toute leur vie l’inconvénient de regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs. » [16]
En regard d’une ingratitude qu’il a évidemment exagérée, car nous devons accepter de préférence le récit de Dangeau, Saint-Simon parle de la douleur « des impuissants, des désintéressés », c’est-à-dire l’église, la noblesse, les bons bourgeois. Il s’en fait l’écho avec une ardeur admirable pour un homme qui ne pardonnait pourtant point à la Dîme royale d’avoir enfanté l’impôt du dixième. Mais, si nous insistons pour trouver des traces de la douleur dont parle Saint-Simon, dans les gazettes du temps, dans les correspondances privées, dans les mémoires des contemporains, il semble que cette date néfaste du 30 mars 1707 ait à peine marqué au milieu des années si misérables de la fin du grand règne. Seule, et tandis que le roi ne jugeait Vauban digne ni d’une oraison funèbre, ni d’une cérémonie officielle, l’Académie des sciences, dont le maréchal était membre honoraire, sut s’acquitter de son devoir. Elle fit célébrer un service solennel, où l’on compta, nous dit le Mercure, plus de quatre-vingts hommes de lettres. Puis, dans la séance du 4 mai, Fontenelle prononça un éloge dont certains passages furent tout aussitôt livrés au public, celui-ci entre autres : « L’attention de M. de Vauban à procurer le bien des particuliers ne se bornait pas aux gens de guerre ; il compatissait aussi aux misères publiques, et il s’est appliqué toute sa vie à y chercher des remèdes ; il consumait une partie de ses loisirs à imaginer des moyens propres au soulagement des peuples, à les réduire en pratique, à calculer les deniers publics et à chercher par d’actives et continuelles supputations le rare secret de remplir les coffres du roi et de soulager le pays… » C’était déjà une allusion bien directe à la Dîme, et cela, au moment même où la justice redoublait d’efforts pour atteindre, sinon l’auteur, du moins ses complices secondaires ; l’éloquent secrétaire perpétuel osa encore ajouter un trait plus précis. Après avoir reconnu le mérite des études économiques du maréchal, et tout en rendant hommage à la générosité royale qui avait comblé Vauban de plus de faveurs que celui-ci n’en eût pu demander, il rappela que ce fidèle serviteur avait, partout et toujours, soutenu son caractère d’honnête homme, « malgré les flatteurs et les courtisans. » On ne pouvait dire mieux, ni davantage, et c’est une gloire pour nos Académies d’avoir noblement interprété et manifesté à l’origine comme elles le font encore aujourd’hui, la profonde vénération que tout le pays professera à jamais pour ce grand nom de Vauban.
***
La mort du maréchal, dédaignant toute protestation et ne consultant que sa conscience, paraîtra encore plus belle et plus majestueuse, si nous mettons en regard la conduite que tint, dans les mêmes circonstances, le compagnon de lutte et de disgrâce de Vauban, Pierre de Boisguilbert. Quoi qu’en ait dit Saint-Simon, le magistrat rouennais ne sut nullement se montrer digne de l’honneur de cette persécution : sa propre correspondance le prouve d’un bout à l’autre. [17]
Avec lui et avec le Factum de la France, il n’était pas besoin de ménagements ; l’arrêt rédigé et signé par le chancelier, le 14 mars, en même temps que celui qui frappait la Dîme royale, fut accompagné d’un ordre d’exil à Brive-la-Gaillarde. Mais déjà Boisguilbert, averti peut-être par le ministre La Vrillière, avait cherché un asile contre les rigueurs dont sa position de magistrat de police le rendait plus passible que tout autre. C’est de la « terre étrangère » qu’il écrivit au contrôleur général une première lettre, toute pleine de cette humilité obséquieuse qu’il faisait alterner avec les boutades de la plus naïve assurance.
« Ce 17 mars. Monseigneur, je vous demande très humblement pardon, si 112 000 liv. de taxes par moi payées depuis votre ministère, pareille somme à moi présentement demandée, m’ont assez fait perdre la raison pour désobéir à vos ordres, dans l’espérance que le public joindroit ses prières aux miennes pour obtenir de vous des manières sur lesquelles vous avez trouvé bon que j’eusse l’honneur de vous entretenir si longtemps. J’ai reçu un ordre d’aller à Brives-la Gaillarde. Je suis persuadé, Monseigneur, que ma peine seroit moins grande que mon crime, si ma situation étoit semblable à celle des autres hommes ; mais quitter Rouen, à mon égard, est réduire une femme et un grand nombre d’enfants que j’ai à l’aumône, présentement que l’on ne reçoit rien des terres, n’ayant d’autre moyen de subsister que les émoluments journaliers de ma charge. J’ai commencé par faire supprimer partout où j’en ai pu trouver les exemplaires de tout ce que j’ai fait, brûler tous mes manuscrits, en très grand nombre , et si, à l’exemple de Dieu, Monseigneur, vous voulez bien user de miséricorde à mon égard, vous connaîtrez par la suite que mon repentir est véritable, la pénitence volontaire de l’auteur faisant plus d’effet dans ces occasions que la peine que l’on lui peut faire. Je vous supplie, Monseigneur, que ma femme et mes enfants ne soient point punis pour un crime qui m’est singulier, et que votre caractère, tout rempli de bonté, veuille bien m’accorder ma grâce, et que mon silence à l’avenir vous marque ma reconnaissance. Je suis, avec un très profond respect, etc. »
Les ministres savaient à quoi s’en tenir sur la situation des affaires du lieutenant général, que d’ailleurs ils n’avaient pas l’intention de punir longuement ni sévèrement. Il n’y eut donc pas de réponse à cette première supplique ; mais le chancelier s’opposa à ce que l’exilé fît exercer sa charge, comme il l’avait imaginé, par son fils aîné. Cette décision fit revenir en toute hâte le fugitif repentant ; de la même plume qui avait prodigué les avis et les conseils à trois générations de contrôleurs généraux, il renouvela son amende honorable dans des termes plus humbles que jamais, mais en faisant toutefois de singulières réserves : « Ce 11 avril. Monseigneur, je me donne l’honneur de vous confirmer de mon territoire la parole que j’ai pris la hardiesse de vous donner dans une terre étrangère, savoir : de ne parler ni écrire en façon quelconque du gouvernement, excepté à votre égard, seulement quand vous m’en aurez donné la permission, espérant qu’à l’exemple de Dieu, qui oublie tout à fait le passé lorsqu’il pardonne aux pécheurs, vous voudrez bien m’accorder la grâce de vous saluer quand je me rencontrerai à Paris. J’ai brûlé tous mes manuscrits, en très grand nombre, à la réserve d’un exemplaire des Mémoires de M. de Sully. » Et reprenant son sujet favori, Boisguilbert recommandait la libre sortie des blés comme le seul moyen de rétablir les affaires, quoi qu’en pussent dire M. d’Argenson et le premier président de Harlay. Chamillart, dont la participation aux rigueurs du chancelier n’est point douteuse cette fois, dicta la réponse suivante, de ce ton ironique et dédaigneux qu’il prenait volontiers pour remettre à sa place le petit magistrat de province, trop prolixe dans l’exposition de ses chimères :
« Puisque vous vous adressez encore à moi, après avoir donné au public toutes vos extravagances, le seul bon conseil que je puisse vous donner, c’est de brûler vos remarques sur le Mémoire de M. de Sully, et de pouvoir imaginer une fois en votre vie que l’on ne sauroit appliquer aucun exemple que pour en faire usage quand les choses sont à peu près dans la même proportion, et qu’un royaume est assez riche pour soutenir la dépense que les rois veulent lui faire porter. Si vous entendez bien ce que je vous veux dire, et qui n’est pas difficile à comprendre, vous vous occuperez à l’avenir de rendre la justice, et vous renoncerez au gouvernement de l’État. »
Sans renoncer à rien, Boisguilbert dut obéir à l’ordre d’exil et partir pour l’Auvergne ; mais il se garda de brûler quoi que ce fût, et conserva surtout cet exemplaire annoté de Sully qui formait son bagage suprême et qui lui servit plus tard à reprendre sa correspondance avec le Contrôle général.
Ses amis, ses protecteurs ne l’abandonnèrent point. Le chancelier avait annoncé, dès le 3 avril, que le roi ferait bientôt miséricorde, pour peu que l’on répondît suffisamment de la conduite à venir du coupable, et, en effet, le temps d’exil avait été réduit à six mois. M. de la Vrillière, qui avait la Normandie dans son département de secrétaire d’État, et le duc de Saint-Simon, qui conservait bon souvenir de ses relations avec les deux frères Boisguilbert, s’employèrent activement pour faire encore abréger la durée du châtiment. Mais, si le roi était calmé, Chamillart ne pardonnait pas encore, et, la femme du lieutenant général ayant voulu venir se jeter aux pieds du ministre, elle reçut avis que toute démarche de ce genre serait considérée comme une profonde ingratitude. La punition avait été bien peu proportionnée à la gravité des attaques portées contre le gouvernement et le ministère ; le seul moyen d’obtenir quelque diminution des six mois, c’était de faire connaître, par le repentir de Boisguilbert et la douleur de sa famille, qu’il méritait cette grâce.
Tout s’arrangea : Boisguilbert eut même la bonne fortune de trouver en Auvergne un intendant qu’il avait connu à Rouen, ce qui lui permit d’occuper ses loisirs forcés à l’étude de la misère locale. L’exil ne dura que deux ou trois mois, et Saint-Simon se vante d’avoir été pour quelque chose dans cette extrême indulgence du ministre. « Mais, ajoute-t-il, Boisguilbert, mandé en revenant, essuya une dure mercuriale, et, pour le mortifier de tous points, fut renvoyé à Rouen, suspendu de ses fonctions, ce qui toutefois ne dura guère. Il en fut amplement dédommagé par la foule du peuple et les acclamations avec lesquelles il fut reçu. » Pour que ce dernier détail fût admissible, il faudrait supposer un revirement bien complet chez les Rouennais, qui n’avaient guère apprécié jusque-là leur magistrat, ni son caractère, ni ses œuvres économiques. Ce qui n’est point douteux, c’est que le Factum de la France bénéficia de la proscription et eut un succès sans exemple dans l’histoire des livres prohibés. Sept éditions au moins parurent avant la fin de l’année 1707, dont trois portant le titre de Testament politique de M. de Vauban, avec un portrait du maréchal. Il est fort probable que l’exilé de Brives n’était pas étranger à ces publications : sa seule concession aux ministres fut de supprimer les pages séditieuses du Supplément au Détail, qui cependant n’avait pas été désigné dans l’arrêt du 14 mars. Cette apparence de repentir, ce ton contrit de toutes ses lettres , firent presque oublier tant d’offenses : quelques mois à peine s’étaient écoulés depuis le retour à Rouen, que la correspondance reprenait, entre Boisguilbert et Chamillart, aussi active que par le passé ; bientôt, l’arrivée de Desmaretz au poste de contrôleur général acheva de donner un tel caractère de confiance à ces relations, que le donneur d’avis put, encore une fois , se croire maître de l’esprit du ministre et des destinées du pays. Illusions trop faciles et trop fréquentes pour que nous puissions les qualifier de généreuses !
Boisguilbert devait ainsi passer les dernières années de son existence dans des alternatives d’humilité et de triomphe puéril, toujours persiflé par les ministres qu’il accablait de ses conseils et lassait de ses redites. Me permettra-t-on, en finissant, de citer un dernier fragment de sa correspondance inédite, qui, seule, pourra, quelque jour, faire comprendre un si étrange caractère, où la dignité morale n’était guère à la hauteur du génie économique ? C’est en août 1711, et Boisguilbert écrit de Fontainebleau, où se trouve la cour.
Il a déjà obtenu plusieurs audiences du contrôleur général ou du chancelier ; sa verve se ressent de ces faveurs, et la lettre est singulièrement longue et diffuse[18] ; mais je n’en donnerai que la dernière page, qui nous ramène à Vauban et à la Dîme royale.
« Il est à propos, Monseigneur, que je vous présente le ministère de M. de Sully, surligné à feuillets pliés, en sorte que vous ferez le dépouillement de ce qui est essentiel en moins d’une demi-heure. Vous verrez qu’il trouva la France en plus pitoyable état qu’elle n’est aujourd’hui, et qu’au milieu de deux guerres, il la rétablit, paya toutes les dettes et amassa trente millions d’argent quitte au roi, parce qu’il rendit les peuples riches par la protection qu’il donna au labourage et au commerce du dedans. Vous apercevrez à même temps qu’il n’eut point de plus grands adversaires dans sa route que le Conseil du roi et les courtisans, jusques aux princes. Cependant, comme il eut le maître et les peuples de son côté, il vint à la fin à bout de tout… De plus, cette lecture fera connoître que ce n’est point le projet du lieutenant général de Rouen que vous suivez, qui ne s’estime point un assez grand auteur, ni téméraire jusqu’au point de se donner pour guide dans une pareille route, comme a fait, fort mal à propos, feu M. de Vauban, sauf le respect dû à sa mémoire, bien que je ne m’en sois pas caché dans mon ouvrage de son vivant, et qu’il m’eût donné des louanges dans le sien. Au fond, c’étoit la production d’un prêtre d’une vie fort équivoque, à qui il avoit bien voulu prêter son nom. »
Ainsi, aucune amertume ne fut épargnée à Vauban : mort pour ce livre de la Dîme royale, où se sont résumées toutes les plus nobles inspirations de son patriotisme, il fallait que la jalousie de Boisguilbert, comme plus tard l’erreur obstinée de l’auteur du Siècle de Louis XIV, vînt lui dénier la paternité de son œuvre, et détourner la gratitude qui lui est due à tant de titres.
M. DE BOISLISLE.
_______________
[1] La minute originale de cet arrêt se trouve aux Archives nationales, dans les cartons du Conseil privé, V6 807, 10e arrêt du 14 février 1707.
[2] Arch. nat., V6 807, 14e arrêt du 14 mars 1707.
[3] Arch. nat., V6 807, 15e arrêt du 14 mars 1707.
[4] Voyez la première des lettres reproduites dans l’appendice, en date du 22 mars.
[5] V. à l’appendice le texte de cet interrogatoire.
[6] Le P. Labat, célèbre missionnaire et écrivain, revenait alors d’Amérique et se rendait à Rome pour présenter sa justification à ses chefs.
[7] Voyez la lettre du marquis d’Ussé, 11 avril.
[8] Interrogatoire du 2 mai.
[9] Procès-verbal du 8 mai.
[10] Un carton avait été fait dès la fin de 1706 pour les pages 15 et 16. On ne le trouve employé que dans la huitième édition de la Dime, datée de 1708, dont il existe à la Bib. nationale un exemplaire précieux, celui de Daniel Huet. Il ne sert qu’à corriger un chiffre de 170 en 240, sans changer rien au passage très violent qui se trouve dans le même endroit. L’autre carton préparé par le maréchal pour une future réédition s’appliquait à la page 171.
[11] Bib. nat., ms. fr. 21746. — Une partie de ces pièces sont reproduites ci-après, en appendice.
[12] C’est la justification employée par le Potier de la Hestroy, dans un exemplaire ms. de ses Observations sur la Dime (Bib. nat., ms. fr. 1736, ancien Versailles 77) : « Après tout, on ne peut qu’on ne blasme un peu l’indiscrétion du maréchal d’avoir rendu public par l’impression un ouvrage qui devoit estre pour le Roy seul et pour ses ministres, quand ce ne seroit qu’à cause de la peinture qu’il y fait du mauvais estat de la France. Quel avantage nos ennemis ne prendront-ils pas ?… C’est en vain qu’on a défendu le débit de ce livre dans le royaume : il en a passé des exemplaires dans les pays étrangers, et c’est de là qu’il reflue chez nous ».
[13] M. le vicomte de Luçay, dans les articles publiés en 1861, par la Revue historique du droit français et étranger.
[14] Saint-Simon a bien dit : « C’était un homme uniquement personnel, et qui ne comptait tous les autres, quels qu’ils fussent, que par rapport à soi. »
[15] Il y a loin, en effet, des paroles recueillies sur l’instant par Dangeau à cette phrase de Saint-Simon : « Le roi ne vit plus en Vauban qu’un insensé pour l’amour du public, qu’un criminel qui attentait à l’autorité de ses ministres, et par conséquent à la sienne.»
[16] La Bruyère.
[17] Les documents qui vont suivre sont tirés de la «Notice sur la vie et les travaux de Boisguilbert », que j’ai présentée en 1865, au concours du prix Léon Faucher, et que l’Académie a bien voulu récompenser d’une mention très honorable.
[18] Lettre du 21 août (1711) à Desmaretz.
C’est dans une nouvelle revue lancée en 1841 par un homme de presse et historien E. Pascallet, que Molinari va publier ses premiers articles. Cette publication porte comme titre, en haut de la couverture de son premier numéro : Revue générale biographique, historique, etc. et en-dessous, en plus gros caractères : Le biographe universel et l’historien, par une société d’historiens et de littérateurs français et étrangers. Toutefois, elle change de titre dès le deuxième numéro pour devenir : Le biographe universel, revue générale biographique et littéraire par une société d’hommes de lettres français et étrangers sous la direction de M.E. Pascallet.C’est sous le titre générique Le biographe universel qu’elle sera connue dans l’histoire de la presse.[3]
Comme son nom l’indique, et comme son directeur le précise dans le premier numéro, l’ambition de cette nouvelle revue est de se consacrer à la publication de biographies de personnages morts ou vivants, très connus ou de second rang, dont les vies ont été utiles et peuvent servir de modèles, bref « faire connaître à leurs concitoyens les hommes dont les noms sont déjà chers à la patrie, chers à l’humanité ; car les grands hommes sont de tous les pays, appartiennent au monde entier […] La meilleure forme à donner à notre ouvrage est la biographie : la biographie met en relief les caractères des individus, plus puissante en cela que l’histoire, qui généralise toujours et ne spécialise jamais. »
Mais Pascallet annonce aussi que l’actualité politique ne sera pas absente de la revue car une chronique régulière lui sera consacrée à chaque livraison. Et c’est ici qu’intervient le jeune Molinari. Si la chronique politique est quasiment absente des livraisons de 1841 – première année de parution – elle abonde en 1842. Molinari en rédigera six au total pour commenter une vie parlementaire riche en événements car cette année-là verra la consolidation de Guizot au pouvoir, une dissolution de la Chambre des députés suivie d’élections législatives, des débats sur la loi électorale censitaire, sur les chemins de fer, sur la perspective d’un traité de commerce avec la Belgique. G.M.
Nous publions ci-dessous la toute première, datée du 31 janvier 1842 : Le biographe universel, revue générale biographique et littéraire par une société d’hommes de lettres français et étrangers sous la direction de M.E. Pascallet. Chronique politique, troisième volume, 1ère partie, p.83-94
Pour plus de détails, lire : Les premiers écrits de Gustave de Molinari à Paris, par Gérard Minart
CHRONIQUE POLITIQUE.Paris, 31 janvier 1842.
L’année dernière, en commençant la publication de notre revue, nous avons promis à nos lecteurs de leur donner le bulletin du mouvement politique de chaque mois. Cette promesse, nous devons l’avouer, n’a point été tenue avec une fidélité rigoureuse. Notre chronique politique, jusqu’à ce jour, a paru à des intervalles inégaux. Loin de nous, certes, la pensée d’attacher à cette lacune une importance trop grande. Cependant, comme l’appréciation des événements de chaque jour est une des parties essentielles, ou pour mieux dire, la partie complétive du plan que nous nous sommes tracé dès notre début, nous avons résolu d’en régulariser le cours. Chacun des numéros de notre revue contiendra donc, à l’avenir, un bulletin circonstancié de la situation des affaires du moment.
Maintenant, voici dans quel esprit sera rédigé notre bulletin politique :
On sait quelle est la pensée qui préside à nos travaux biographiques : nous cherchons à retracer la partie la plus difficile de l’histoire contemporaine, — celle qui concerne les hommes, — nous attachant à celle-là plutôt qu’à tout autre, parce qu’aucune n’est plus mal connue, plus faussement appréciée, plus étrangement défigurée par l’esprit de parti.
Dans l’accomplissement de cette œuvre, nous suivons, pas à pas, la marche des hommes à travers les événements, les prenant au début de leur carrière pour ne les quitter qu’au moment où nous écrivons. Maintenant, n’est-il point à la fois intéressant et utile pour nous comme pour notre public, de ne point perdre tout à fait de vue la trace de ces hommes, de nous assurer s’ils ne dévient point du chemin que nous leur avons vu parcourir, et que nous les avons loués ou blâmés d’avoir parcouru. Eh bien ! une chronique, dans laquelle apparaîtront nécessairement les figures déjà esquissées ailleurs, devra remplir ce but, c’est-à-dire, servir de complément à la biographie, et même, en quelque sorte, en être la preuve arithmétique.
Puisque l’une et l’autre, — chronique politique et biographie, — sont si intimement liées dans notre pensée, leur esprit devra aussi naturellement être identique. En jugeant les hommes nous faisons toujours abstraction des partis, — donnant notre assentiment à tous ceux, quels qu’ils soient, qui nous semblent s’être proposé un but utile à la société, et que nous voyons marcher à ce but avec persévérance. Si petite que soit la pierre que chacun apporte au grand édifice du perfectionnement social, nous lui en savons gré, et ne regardons point la couleur de ses habits. De même, ferons-nous ici en jugeant les actes et les doctrines. Tous ceux ou celles que nous croirons de nature à contribuer au bien-être du pays, qu’ils émanent du gouvernement ou des diverses fractions de l’opposition, trouveront toujours en nous des défenseurs zélés. De même nous combattrons les autres, en nous renfermant toutefois, selon notre coutume, dans d’exactes limites de modération.
En un mot, nous serons éclectiques.
Notre point de départ indiqué, ainsi que notre but, nous commençons notre tâche.
Les débats de la discussion de l’adresse dans l’une et l’autre Chambre, ont rempli presque entièrement le mois qui vient de s’écouler. Que nous a appris cependant cette discussion ? À coup sûr, rien qui puisse intéresser bien vivement le pays. Quant aux résultats obtenus par l’un ou l’autre des partis en présence, malgré l’élévation du chiffre ministériel lors du vote définitif, ils sont au moins douteux. Nous ne savons, mais il y a dans la manière de procéder de nos Chambres, commençant chacune de leurs sessions par dépenser un grand mois à composer la pauvre paraphrase d’un discours presque toujours insignifiant, un défaut capital d’économie parlementaire, un vice flagrant d’organisation. Pourquoi, au lieu de se disputer avec acharnement quelques lambeaux de phrases, ne point attendre pour la lutte un champ plus vaste, un prix de plus haute valeur ?— Pourquoi ne point réserver la discussion pour l’époque de la présentation des budgets ? Hélas ! on ne consacre que trop de temps en France aux vaines joutes de la parole. Cependant les sessions ne sont pas si longues, et les affaires positives du pays si peu compliquées, pour que MM. nos députés puissent, impunément, dépenser la majeure partie de séances déjà trop courtes, en mauvaise monnaie de récriminations, de reproches, d’accusations, c’est-à-dire, en simples querelles de personnes. Qui donc aura le courage de redresser cette marche boiteuse ?
Puisque nous sommes sur ce chapitre des améliorations, nous dirons quelques mots de deux discours qui ont, dans les deux Chambres, inauguré d’une manière grande et digne la discussion de l’adresse. Nous voulons parler des discours de MM. de Montalembert et de Tocqueville, tous deux tendant à un but identique, quoique par des voies différentes. — Ce but, c’est la moralisation sociale. M. de Montalembert a parlé de Dieu et du principe religieux qui va s’affaiblissant, — et, d’une voix éloquente, il a reproché au gouvernement son indifférence sur cette grave question. Le langage élevé de M. de Montalembert a été applaudi, et il méritait de l’être ; car il était l’expression d’une conviction profonde. Le jeune pair s’effraie du désordre, de l’immoralité systématique qui s’infiltrent, par tous les pores, dans la société actuelle, et il a raison, car cela est un mal immense ; mais le remède qu’il préconise est-il bien celui qui convient ? Ici, malheureusement, il y a doute. La religion romaine, — tout entière fondée sur le principe de la foi, — est-elle encore en harmonie avec l’esprit d’une nation aussi profondément remuée que la nôtre par les doctrines de l’examen philosophique. — Et ne faudrait-il point, peut-être, chercher à la morale un chaperon moins vieilli ? …. Question brûlante, à laquelle il ne nous appartient point de toucher…. M. de Tocqueville travaille, lui, à l’œuvre de moralisation par d’autres moyens, par des moyens de moindre portée, mais plus efficaces peut-être. M. de Tocqueville, philanthrope éclairé, appelle l’attention du gouvernement sur l’ambition, sur l’ardeur effrénée des places, qui se développe depuis quelques années dans d’inquiétantes proportions. Il voudrait que l’on posât des bornes aux brigues désordonnées de cette légion d’intrigants sans cesse à l’affût des nombreux emplois dont le gouvernement dispose, — que l’on mit un frein à toutes ces ambitions qui s’agitent dans la boue, se disputant les miettes du festin ministériel.
Les idées émises par M. de Tocqueville ont dû certainement éveiller les sympathies de tous les honnêtes gens, — et pourtant, — autant en emporte le vent. C’est qu’il y a toute une hiérarchie puissante, dont les intérêts se trouvent engagés dans les abus dénoncés par l’éloquent auteur De la Démocratie en Amérique, c’est que son langage atteint dans leur existence tout ce peuple de sinécuristes, d’employés à la taille des plumes, etc., de nos ministères, de nos administrations grandes et petites, — et l’on comprend que les clameurs de cette foule suffisent amplement à couvrir le cri d’un devoir isolé. De semblables abus ne sauraient être déracinés de notre sol que par l’action persévérante d’un homme d’État puissant et tenace. Or, les Richelieu sont peu communs. D’ailleurs tout gouvernement s’imagine volontiers que le grand nombre des emplois dont il dispose contribue à le fortifier en lui ralliant des partisans ; — comme si la complication des rouages ajoutait jamais à l’efficacité d’action d’une machine… La voix de M. de Tocqueville a eu le sort de celle de Cassandre. L’orateur a obtenu un succès d’estime.
La question d’Orient a décidément été enterrée ce mois-ci. Deux remarquables discours de M. Guizot lui ont servi d’oraison funèbre. Plaise à Dieu qu’une résurrection intempestive ne vienne de nouveau tout déranger ! La logique si claire et si précise de M. le ministre des affaires étrangères, a débrouillé tous les fils de cette toile si mal tissue. Elle y fait jaillir une lumière telle que tout le monde, — nous exceptons les aveugles de parti pris, — a dû y voir clair. Le souffle de M. Thiers lui-même n’a pu faire vaciller cette lumière. À vrai dire, ce souffle était si faible, que l’on eût pu le croire le dernier… L’ex-président du cabinet du 1er mars a beaucoup vécu depuis deux ans… Aussi, le triomphe de M. Guizot a-t-il été complet. Les résultats obtenus par la politique à la fois ferme et pacifique du cabinet : en Égypte, par la consolidation du pouvoir du pacha ; en Turquie, par la convention des détroits ; en Europe, par la réintégration libre de la France dans le concert européen ; ces résultats ont été tels, que les esprits les plus difficiles pouvaient le souhaiter. M. Guizot n’a point dissimulé que de grandes fautes avaient été commises ; mais, a-t-il ajouté, les puissances rivales de la France en ayant, de leur côté, commis d’aussi fortes, l’effet des nôtres s’est trouvé atténué.
Avouons cependant que notre part, dans cette équitable répartition, n’a point été la plus mince. Notre budget de 1 700 millions, notre loi des fortifications de Paris, doivent singulièrement faire pencher en notre faveur le plateau de la balance. Ne paierions-nous peut-être pas un peu cher le plaisir de nous être, pendant quelques jours, donné des airs de capitan.
De compagnie avec la question d’Orient est arrivée la question espagnole, augmentée de la petite complication mésaventureuse que chacun sait.
Si nous approuvons complètement la conduite du ministère dans la première de ces questions, — si nous trouvons qu’il a rendu à la cause du progrès social un service immense, en ne laissant point notre pays s’engager dans l’impasse en casse-cou, où le guidait le précédent cabinet, — notre adhésion ne lui sera point acquise aussi entière en ce qui concerne la seconde.
M. Guizot a, nous en convenons, prouvé le plus irrécusablement du monde, que, dans le différent survenu, le représentant de la France à Madrid se trouvait pleinement dans son droit. Comme preuves à l’appui, il a cité une foule de précédents empruntés à l’histoire de l’ancienne monarchie. Notre droit est évident… Mais, voyons… quel est donc en réalité ce droit si bien étayé : — une vraie misère, — et même la plus misérable de toutes les misères, — une misère d’étiquette. — Valait-il la peine d’être mis en balance avec un intérêt sérieux ? Comment M. Guizot, ce profond théoricien constitutionnel, n’a-t-il point compris que les gouvernements nés du principe de la souveraineté nationale, ne devraient point s’assujettir servilement aux formes usées, aux errements vieillis des monarchies d’autrefois. Les intérêts de la France en Espagne ne valent-ils point une rature faite dans le code de l’étiquette ? À nos yeux, M. Guizot a eu tort d’avoir si complètement raison.
La France a, du reste, eu fréquemment maille à partir avec l’Espagne sur ce grave sujet. On sait que les négociations du célèbre traité des Pyrénées faillirent être rompues, parce que Don Louis de Haro, le délégué espagnol, exigeait que Giulio Mazarin, le représentant de la France, fit, en le reconduisant, trois pas en dehors de la porte. — La cour de France, — alléguant la coutume et l’usage, — se refusait à cette concession offensante pour sa dignité : et Dieu sait quelles conséquences fâcheuses seraient résultées de la contestation, si Mazarin n’y eût mis fin en homme d’esprit. Il tomba incontinent malade, et reçut l’Espagnol couché dans sa chaise longue… Pourquoi donc M. de Salvandy, qui, certes, ne manque point d’imaginative, n’a-t-il point, lui aussi, trouvé quelque expédient ? …
Nous pourrions bien, à ce propos, dire quelques mots d’une autre petite histoire de même sorte, — de celle de M. Kisseleff, c’est-à-dire, des représailles tirées à Paris le jour de l’an, de l’irrévérence commise le jour de la Saint-Nicolas à Saint-Pétersbourg ; mais, en vérité, cela mérite-t-il autre chose qu’un imperceptible mouvement d’épaules.
Toutes nos relations avec les puissances étrangères, grandes et petites, ayant été passées en revue par la Chambre dans la discussion de l’adresse, il y a, par conséquent, été question de la Belgique et du traité de commerce actuellement en négociation avec le gouvernement de Léopold. Ce traité, comme on devait s’y attendre, a été vivement attaqué par MM. Grandin et Denis Benoit (manufactures de draps et hauts-fourneaux), et chaudement défendu par MM. Galos et Wustemberg (vins de Bordeaux). Il est vraiment pénible de voir une telle question abandonnée au chamaillage borné de l’intérêt de localité. L’intérêt du pays va-t-il donc laisser encore le champ libre à celui de quelques producteurs isolés ? En présence de cette grande association douanière allemande qui menace de nous déborder, ne serait-il point utile que nous fissions, nous aussi, notre ligue ? Ne serait-il pas sage, à présent que nous savons ce que valent les alliances de sympathies, que nous recherchassions davantage les alliances d’intérêts ? Et ne serait-ce point aussi une pensée élevée que celle de réunir en un seul faisceau, — s’étendant d’Amsterdam à Alger, — les nations de l’Europe occidentale en regard du groupe allemand. La France, tête d’une telle association, acquerrait naturellement sur elle la même influence qui a été départie à la Prusse dans le Zoll Verein ; or cette conquête toute pacifique aurait, on le comprend, une immense portée. Déjà un traité nous unit à la Hollande. C’est une première maille du chaînon, ne laissons point échapper la seconde ; — elle pourrait bien demain être rivée ailleurs, si nous la négligions aujourd’hui.
Après le traité belge, c’est la convention relative à la répression de la traite des noirs qui a occupé la chambre. Tout d’abord, dans cette question, nous nous aheurtons à l’amendement de M. Billault, à l’amendement de M. Lacrosse, puis, enfin, à l’amendement de M. Lefebvre. Virulemment attaquée, la convention a été habilement défendue. L’avantage, en définitive, est demeuré au ministère ; mais la victoire n’a pas été franche. L’amendement de M. J. Lefebvre, auquel le cabinet s’est rallié pour esquiver le choc de celui dont le menaçait M. Lacrosse, constitue pour lui une improbation tacite, un véritable échec moral. Et de fait, les nouvelles clauses ajoutées aux anciens traités de 1831 et de 1833, méritent, jusqu’à un certain point, la défaveur avec laquelle elles ont été accueillies. Celle de l’agrandissement des zones, n’augmentera-t-elle point, par exemple, sans compensation appréciable, les vexations dont le commerce maritime se plaint déjà ? À vrai dire, — et malgré qu’on en ait dit, — ces vexations tourneront plutôt au détriment de l’Angleterre que de la France ; car, si celle-ci ne compte que 105 croiseurs, tandis que sa rivale en a 124 en course, — en revanche le commerce maritime anglais est hors de toute proportion avec le nôtre.
Le neuvième paragraphe de l’adresse, auquel M. Lestiboudois a voulu greffer un amendement relatif au recensement, a été le prétexte d’une mêlée générale des plus vives. L’opposition s’est montrée cependant bien faible dans la lutte, — et auprès du discours solide et raisonné de M. Humann, les grandes et grosses phrases de M. Odilon-Barrot résonnaient bien creux. Mais aussi, pourquoi l’opposition va-t-elle choisir ce terrain-là… De quoi se plaint-elle, en effet ? — De l’illégalité de la mesure ! … Les explications claires et lumineuses de MM. Chasles et Duchatel ont levé tous les doutes sur ce point. — De son inopportunité ? Mais quelle est donc la cause qui a surtout provoqué l’ordonnance du recensement, — n’est-ce point le déficit du trésor ? — Et par quoi a été occasionné ce déficit, si ce n’est par les dépenses extraordinaires du cabinet du 1er mars, cabinet soutenu par la gauche et prôné par M. Barrot. L’amendement de M. Lestiboudois a été rejeté, et c’était justice.
Nous devrions bien ajouter quelques mots sur les dernières séances de la Chambre ; mais, en vérité, nous n’en avons point le courage. Jamais, dans cette assemblée, la discussion n’est descendue aussi bas, jamais le désordre ne s’y est montré aussi scandaleux. Au tumulte confus de murmures, de cris, de rires, qui, pendant deux jours, y a régné sans partage, on eût pu se croire plutôt transporté à une représentation de quelque théâtre du boulevard, qu’à une séance du parlement d’une grande nation. Quand donc saurons-nous être dignes ? …
En somme, de toute cette discussion de l’adresse, il est ressorti pour nous une vérité assez triste. C’est que le pouvoir n’est point fort, quoique jamais l’opposition ne se soit montrée aussi faible, aussi insuffisante. M. Guizot, quelques magnifiques efforts qu’il ait déployés, quoiqu’il ait, sans conteste, dominé la discussion, M. Guizot n’a obtenu qu’une victoire douteuse, une de ces victoires qui font songer avec inquiétude à l’avenir. Si la Chambre a donné, par un vote significatif, son adhésion à l’ensemble de son système de résistance au dedans et de fermeté pacifique au dehors, ce n’a point été sans quelques réserves. Aussi, dans les questions intérieures, cette adhésion même a pu paraître douteuse. M. Guizot, par hasard, ne résisterait-il pas trop ? En s’efforçant d’atteindre son but, ne le dépasserait-il point ? Qu’il y prenne garde : son système est, il faut bien le dire, impopulaire ; car les nations sont des enfants malades que l’on ne guérit qu’à leur corps défendant, aussi doit-on ménager les remèdes. Le clinquant du costume ou du langage séduit plutôt les masses que la simplicité puritaine. D’ailleurs, des ressorts trop tendus finissent par s’user, s’ils ne se rompent brusquement. Tant de condamnations qui frappent, sans relâche, les hommes de la presse, aigrissent les esprits, et rendent de jour en jour la conciliation plus difficile. Certaines positions veulent être tournées et non abordées de front. Maintenant que le calme, que la paix ont été obtenus, ne serait-il donc point possible que l’on entrât dans une voie moins rude, plus douce… Et puis, les questions pratiques, les questions d’intérêt matériel si déplorablement négligées dans ces derniers temps, ne réclament-elles point une attention sérieuse ? Après avoir tant discuté, tant épilogué, tant retourné sous toutes ses faces la métaphysique du pouvoir, ne devrait-on pas en rechercher enfin les applications ? …
Mais, objectera-t-on, le cabinet pourrait-il aujourd’hui s’occuper efficacement de telles questions, puisqu’il n’est pas assuré d’exister encore demain. — Voilà une objection qui sans cesse est reproduite depuis onze années, et toujours, hélas ! avec raison. Cependant nous croyons qu’au temps présent elle n’est point insoluble, et qu’au sein même de la Chambre actuelle, le cabinet du 29 octobre pourrait se consolider d’une manière durable.
On parle toutefois de diverses combinaisons ministérielles, les unes absolues, les autres simplement modificatrices.
Au nombre des premières on a rangé un cabinet Thiers-Molé, c’est-à-dire, Molé-Thiers. — Car, assure-t on, l’ex-président du conseil du 1er mars accepterait, pour revenir aux affaires, le patronage de l’ex-président du 15 avril, s’effaçant derrière lui, et se contentant du modeste portefeuille des travaux publics. La prétention, certes, n’est point ambitieuse, mais la combinaison renferme-t-elle quelques éléments de vitalité ? Il est permis d’en douter. Pourquoi ne pas plutôt, si l’on fait ainsi bon marché des vieilles rancunes de la coalition, essayer d’un rapprochement entre M. Guizot et M. Molé ? Il y a, entre les principes de ces deux hommes, plus de similitude qu’entre ceux de M. Thiers et de M. Molé. D’ailleurs, des simples rivalités personnelles ne devraient-elles point céder devant des intérêts généraux ?
Une autre combinaison, à notre avis préférable à celle-là, serait celle qui donnerait accès dans le cabinet à MM. Dufaure et Passy, par l’élimination de MM. Teste et Humann, qui, par eux-mêmes, ne procurent aucune force vitale au corps ministériel. Outre que MM. Dufaure et Passy sont des hommes d’une valeur positive, leur participation au pouvoir serait considérée comme une garantie par une portion notable du centre gauche. En ralliant autour d’eux leurs amis, ils donneraient au cabinet un nouvel élément de majorité.
Ainsi modifié, celui-ci se trouverait peut-être enfin viable, et n’aurait plus de si nombreux soucis à donner aux éventualités de l’avenir. Médecin zélé et recueilli, il pourrait s’occuper avec fruit des améliorations que réclame, au moral comme au physique, l’état souffreteux de la société actuelle… Le discours du trône s’est montré explicite sur la question des chemins de fer. Cela est un bon signe. Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, la France s’est, hélas ! dans ces derniers temps, bien laissé devancer par les autres nations. Heureusement que quand elle veut fermement, elle marche vite. Espérons qu’elle voudra enfin….
La France s’ennuie, a dit, on s’en souvient, M. de Lamartine. Nous sommes de l’avis de l’illustre poète, et comme lui encore, nous pensons que, ce n’est point la jeter sur l’Europe qu’il faut, pour la tirer de son spleen, mais, tout simplement, lui faire trouver chez elle la vie agréable, en la lui rendant plus commode, plus facile. Qui se trouve assis à l’aise à son foyer, ne songe guère d’ailleurs à aller troubler le ménage de ses voisins. Le progrès matériel réglé par le progrès moral, voilà le but que nous devons nous assigner et poursuivre sans relâche, — et certes la bonne voie une fois prise, si nous savons y persévérer avec la même ardeur que nous avons mise parfois à parcourir des routes fausses, nul doute que, les premiers, nous n’atteignions aux hautes destinées que l’avenir réserve aux nations.
G. de Molinari
Fondateur du premier journal de science économique, les Éphémérides du Citoyen, Nicolas Baudeau fut aussi l’un des plus efficaces vulgarisateur des principes économiques au dix-huitième siècle. Personnage méconnu, trop souvent négligé dans les ouvrages d’histoire de la pensée économique, il méritait bien qu’on lui consacre une courte notice.
Parmi la pléiade des économistes physiocrates, l’abbé Nicolas Baudeau a peu attiré l’attention. Il n’était certainement pas un théoricien majeur, ni surtout pas un fondateur : son rôle fut celui d’un entremetteur, d’un pédagogue, d’un propagandiste ou d’un vulgarisateur d’idées. Cela mérite-t-il l’oubli ?
L’abbé Baudeau n’est pas mentionné par Mark Blaug dans La pensée économique : origine et développement (Paris, Economica, 1985). Quant à Joseph Schumpeter, il ne l’évoque que pour traiter la Première introduction à la philosophie économique de Baudeau de « médiocre ». (Histoire de l’analyse économique, I, p.317) Fondateur et directeur du journal des physiocrates, les Éphémérides du Citoyen, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation de la doctrine de l’école de Quesnay, l’abbé Baudeau semble pourtant mériter qu’on s’attarde quelque peu sur lui et sur ses oeuvres. C’est ce que nous ferons ici, à travers une notice biographique explicitant son rôle dans les débats économiques de son siècle.
Le parcours de Nicolas Baudeau, il faut le dire, est original. Prêtre dès l’âge de 23 ans, il se lia plus tard avec le Bertin, le Contrôleur général des Finances de l’époque, puis s’inséra dans le monde littéraire en qualité de journaliste. Fondateur en 1765 d’un périodique, les Éphémérides du Citoyen, il devint en peu de temps un membre incontournable de la toute récente école physiocratique. Nicolas Baudeau est né à Amboise le 24 avril 1730. On consacra sa jeunesse à la préparation à l’entrée dans les ordres, et en octobre 1750, alors âgé de 20 ans, le jeune Baudeau prit l’habit de religieux de choeur, à Chancelade, avant de devenir prêtre trois ans plus tard.
Durant les premières années de la décennie 1750, tandis que les questions économiques devenaient peu à peu au centre de vifs débats, Baudeau continuait à s’y désintéresser, et menait alors des recherches historiques et archéologiques sur le Périguor. Ces recherches, d’ailleurs, aboutirent à la composition d’un ouvrage, et Baudeau se mit alors en route pour Paris dans le but de trouver un éditeur. En 1760, tout juste arrivé à Paris, il se lia d’amitié avec Bertin, alors Contrôleur général, sans doute de par leur intérêt commun pour le Périguor. Celui-ci sollicita dès lors de Baudeau, qu’il admirait beaucoup, ses vues sur certaines questions économiques à l’ordre du jour. Baudeau composa alors trois mémoires, et les fit parvenir à Bertin. Ils furent publiés plus tard, en 1764, sous le titre : Idées d’un citoyen sur le commerce d’Orient et sur la compagnie des Indes.
Après avoir goutté aux réflexions économiques, et après avoir forgé dans son esprit les bribes d’une première conception économique de la société, Baudeau, semble-t-il, y prit goût. Peut-être encouragé par Bertin, il monta alors un journal économique, intitulé les Éphémérides du Citoyen, ou chronique de l’esprit national, dont le premier numéro parut le 4 novembre 1765. Les idées économiques contenues dans ce nouveau périodique étaient loin d’être en accord avec les doctrines physiocratiques, défendues depuis quelques années par Quesnay, Mirabeau, et quelques disciples. Il s’agissait plutôt de la défense d’un « mercantilisme modéré », selon les termes de Georges Dulac dans le Dictionnaire des Journaux. [1]
La conversion de Baudeau à la Physiocratie intervint en 1766, et eut lieu grâce aux talents d’un des disciples méconnus de Quesnay : Guillaume-François Le Trosne. En 1766, Le Trosne était devenu un véritable disciple du maître François Quesnay, dont il vantait « la profondeur et la sublimité du génie ». (lettre de Le Trosne à la société économique de Berne, 13 aout 1766) Son engagement en faveur des théories économiques de l’école de Quesnay, qu’il avait fait siennes dès cette époque, allait produire des fruits inespérés. Ses origines, son nom, et son talent d’auteur, constituaient déjà un capital à très forte valeur. Avec raison, Weulersse écrivit sur Le Trosne : « Fils d’un conseiller du roi au baillage d’Orléans, élève de Pothier, installé depuis onze ans dans l’office d’avocat du roi à la même cour, magistrature qu’il devait exercer d’une manière brillante pendant 22 années, il apportait à l’École le précieux appoint d’un nom et d’une situation honorables, d’un talent juridique et philosophique vigoureux, même d’une plume sobrement élégante. » (Le mouvement physiocratique en France, I, p.100) Et pourtant, non content d’apporter sa réputation et son talent, Le Trosne usa aussi de sa force persuasive pour faire entrer dans les rangs de l’école physiocratiques de nouveaux disciples. Le premier résultat de cet effort fut la conversion de Nicolas Baudeau. L’abbé
Baudeau dirigeait déjà les Éphémérides, et y faisait paraître des articles légèrement mercantilistes : suffisamment pour agacer un économiste comme Le Trosne, mais pas assez pour rendre une conversion impossible. Le Trosne songea donc à répondre. « L’auteur a beaucoup d’esprit, racontera-t-il, une facilité surprenante, un zèle incroyable pour le bien ; mais ses principes n’étaient pas toujours exacts. J’ai pris la liberté de le mettre en garde contre ses principes et de l’engager à les approfondir. » (Lettre de Le Trosne à la société économique de Berne, 7 janvier 1767) En mars 1766, il envoya donc lettre à l’abbé Baudeau, l’invitant à réviser son jugement sur un certains nombre de points de doctrine. Ce dernier prépara neuf lettres de réfutation, et envoya la première à Le Trosne qui, une fois l’ayant reçue, la fit paraître dans le Journal de l’Agriculture, du commerce et des finances, accompagnée d’une demi-page d’observations critiques. Ce fut, semble-t-il, ce qui provoqua l’adhésion de Baudeau au système de Quesnay. Dupont de Nemours, racontant l’épisode, écrira de manière quelque peu emphatique : « Le Trosne eut le bonheur de bien saisir le point de la question : l’âme honnête et le génie perçant de M. l’abbé Baudeau en furent frappés ; il renonça à ses huit autres lettres ; il vint trouver son confrère. Tous les deux s’expliquèrent, s’entendirent, s’embrassèrent, se promirent d’être toujours compagnons d’armes, frères et émules. » (« Notice abrégée… », Éphémérides, 1769, vol.5, p.31)
Quelle que soit la véracité de l’interprétation de Dupont de Nemours, et elle semble bien douteuse, Nicolas Baudeau se rangea donc à la doctrine physiocratique, et fit passer son journal dans leur camp. Celui-ci changea alors de titre, et devint les Éphémérides du Citoyen, ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques, un titre nettement plus ambitieux que le précédent.
Cette année 1767 est ainsi glorieuse pour les Physiocrates. C’est d’ailleurs Baudeau, au mois d’avril, qui utilise le premier ce terme de « physiocrate », dans l’un des articles de sa revue. Il se répandit très vite, et fut utilisé pour intituler le recueil de textes Physiocratie.
En 1767 toujours, Baudeau publia sa Première introduction à la philosophie économique, qui se voulait une présentation synthétique de la doctrine physiocratique, et qui est effectivement la meilleure introduction à la pensée de cette école qui ait été faite. Dès 1768, pourtant, Baudeau abandonna le navire, et s’il publia de nombreuses oeuvres cette année là, c’est parce qu’il était sur le départ, et souhaitait s’en dessaisir. Ainsi publiait-il à la hâte, « comme s’il vidait ses tiroirs avant de partir. » (Alain Clément, Baudeau, p.29)
On a de lui, pour cette année là : Lettres d’un citoyen à un magistrat sur les vingtièmes et autres impôts ; Avis au peuple sur son premier besoin ou petits traités économiques par l’auteur des Éphémérides ; Précis de l’ordre légal ; et Résultats de la liberté et de l’immunité du commerce des grains.
En avril 1768, Baudeau quitta Paris pour la Pologne, et y devint prêtre. Il laissa les Éphémérides à Dupont de Nemours. Quand il revint en France l’année suivante, la scène économique était toute chamboulée, après notamment la publication des Dialogues de Galiani. Baudeau, qui ne perdit jamais son intérêt pour la science économique — et surtout pour la question du commerce des grains, comme l’atteste sa lettre du 16 février 1769 à Mirabeau — entendit lui répondre. Turgot, son ami, regarda cela d’un mauvais oeil. « Il répondra trop en économiste » assura-til en référence à Baudeau.
Baudeau ferraillera néanmoins avec Galiani, peut-être par amour pour le débat d’idées. L’année précédente, déjà, il s’était expliqué avec l’économiste nantais Graslin, qui avait critiqué la conception physiocratique de la richesse. Cette controverse avait abouti à la publication d’un Recueil de lettres, une « correspondance critique » qui était le premier exemple du genre. Selon l’avis de Joseph Schumpeter, la correspondance entre Graslin et Baudeau est même « d’un intérêt considérable pour l’histoire de l’analyse économique. » (Histoire de l’analyse économique, I, p.250) En 1776, il s’opposera à Condillac sur la même question de la productivité de tous les secteurs économiques, que Baudeau, en bon physiocrate, ne pouvait admettre.
Si maintenant nous devons mentionner quelques unes des raisons pour lesquelles nous pouvons considérer que Baudeau était en avance sur son temps, il faut évoquer le rôle fondamental qu’il entendait faire jouer à l’opinion publique. Tandis que son maître, Quesnay, et tous les économistes avant lui, souhaitaient surtout influencer les puissants, Baudeau préféra créer un journal, populariser les principes économiques dans des publications accessibles, et en appeler aux réflexions des citoyens. Cette idée de citoyenneté, d’ailleurs, est omniprésente chez Baudeau. On la retrouve dans ses Éphémérides du Citoyen, mais aussi dans plusieurs de ses brochures, à des dates variables de sa vie : Idées d’un citoyen sur l’administration des finances du Roi (1760), Idées d’un citoyen sur les besoins, les droits et les devoirs des vrais pauvres (1765), et, quelques années avant sa mort, Idées d’un citoyen presque sexagénaire sur l’état actuel du royaume.
Baudeau a également écrit de belles choses sur l’entrepreneur. En cela, il s’est écarté de la logique stricte de Quesnay, selon laquelle le fermier est la clé du système économique. Selon Baudeau, la clé est l’entrepreneur, ce qui anticipe les développements ultérieurs des économistes comme Jean-Baptiste Say. L’abbé Baudeau aura surtout permis à la doctrine de Quesnay de pénétrer le monde savant, et à son héritage d’être transmis et mis en valeur. Peut-être aura-t-il aussi guidé ses contemporains sur la bonne voie, lui qui disait : « J’ai travaillé dix ans sous ses yeux, et deux lustres encore, après sa mort, à détromper les autres. »
Benoît Malbranque
______________
[1] Georges Dulac, « Éphémérides du Citoyen », in Jean Sgard, Dictionnaire des Journaux (1600-1789), t.I, Paris, 1991, p.353
Institution centrale dans le débat des idées économiques au XIXe siècle, la Société d’économie politique comptait comme membres toute la fine fleur de l’école libérale française, dont elle permettait le renouvellement et à qui elle offrait des opportunités de discussions engagées. Dans la séance du 10 décembre 1850, la question du travail le dimanche fut portée à l’ordre du jour. Horace Say y fait valoir que, si la pratique d’un repos d’un jour par semaine est recommandable aux points de vue de la morale, de l’hygiène et même de la production, l’intervention de l’État pour interdire tout travail le dimanche serait une violation de la liberté religieuse, de la liberté de travailler, et n’aboutirait finalement à aucun résultat désirable. Louis Leclerc et Joseph Garnier parlent dans le même sens. Cette position libérale est toutefois critiquée par le député Morin et le membre de la Chambre de commerce de Paris, M. Rodet, qui font valoir l’importance d’imposer un progrès dont ils souffriraient d’attendre trop longtemps la réalisation. B.M.
DU TRAVAIL DOMINICAL
Séance du 10 décembre 1850.
Dans cette séance, présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l’Institut, la Société d’économie politique s’est occupée de la question de la défense du travail du dimanche, soulevée par le rapport de M. de Montalembert, lequel a produit un certain émoi dans le pays. Inutile de dire que c’est surtout au point de vue économique que ce sujet a fait l’objet de la conversation de la réunion.
RODET, membre de la Chambre de commerce de Paris, est partisan déterminé du repos du dimanche. Il trouve essentiellement morales et philanthropiques toutes les mesures capables de procurer un jour de repos et d’indépendance aux ouvriers et à la classe si nombreuse des employés du commerce et de l’industrie. M. Rodet ne reculerait pas devant des mesures prohibitives, la défense de l’étalage, par exemple, et même devant une certaine pénalité pour faire exécuter ces mesures. Selon lui, l’État doit venir au secours des classes de la population qu’un trop long travail accable afin qu’elles puissent s’améliorer.
Horace SAY, membre du conseil d’État, trouve aussi que le repos d’un jour par semaine est essentiellement désirable, tant pour la satisfaction des besoins religieux que pour l’entretien des forces du corps et de celles de l’esprit ; mais il pense également que l’on n’obtiendra ce résultat que par le progrès des mœurs. Il ne croit pas qu’il soit possible de forcer au repos, et surtout de fixer un jour dans la semaine de préférence à tous les autres.
En France, outre que tous les cultes sont permis, il s’est établi dans l’industrie des usages qui ont complètement déplacé les anciennes habitudes. Ainsi, certains ouvriers travaillent la journée du dimanche pour achever les commandes qui leur sont faites, et ne peuvent se reposer que le lundi ou un autre jour de la semaine. Que l’État ne fasse pas travailler le dimanche, rien de mieux, mais qu’il n’aille pas plus loin, et qu’il laisse agir la religion, le bon sens et les conseils de l’hygiène. En dernière analyse, le travail moralise, et il y a longtemps qu’on a dit : « Qui travaille prie. »
Say déclare que le dimanche est pour lui le jour où il travaille réellement le plus, parce qu’il est le seul jour où il puisse avoir toute sa liberté. Il ajoute qu’il ne croit pas mal faire en agissant ainsi.
Louis LECLERC voudrait le repos du dimanche surtout au point de vue religieux, qu’il trouve d’accord avec les conseils de la morale, de l’hygiène et de l’économie politique. Mais lui aussi pense que c’est là une affaire de conscience et d’intelligence, dans laquelle l’État n’a pas qualité pour intervenir. Tout ce que l’État peut faire et doit faire, selon lui, c’est d’interdire que les travaux du gouvernement se fassent le dimanche.
Ternaux-Compans, ancien député, assistant pour la première fois à la réunion, s’attache à montrer les difficultés d’application d’une loi prohibitive du travail pendant le dimanche. Si le gros des affaires est suspendu à Paris le dimanche, c’est surtout ce jour-là qu’elles se nouent, se poursuivent et se concluent dans les quatre-vingt-six départements. Allez-vous en dans la haute Normandie, par exemple ; vous n’y trouvez pas de villages proprement dits, mais quelques boutiques groupés autour de l’église, avec l’habitation du curé, celle du notaire, de deux ou trois autres fonctionnaires. Tous les dimanches, les cultivateurs arrivent des environs, assistent d’abord à la messe, et ne sont pas plutôt sortis de l’office qu’ils se mettent à commencer leurs achats, à poursuivre leurs affaires, soit avec l’officier ministériel, soit avec leurs autres relations. Si on prohibait le travail du dimanche, il est très douteux que la religion et la morale s’en trouvassent mieux. Quant aux affaires, elles seraient très positivement entravées.
Dans les Pyrénées, que M. Ternaux-Compans connaît aussi particulièrement, c’est encore le dimanche que se font toutes les transactions, entre habitants accourus de 8, 10, 12 lieues et même 30 lieues à la ronde.
À Paris même, l’employé n’a que le dimanche pour faire ses emplettes et ses autres affaires ; si les magasins étaient complètement fermés ce jour-là, il serait fort gêné dans ses mouvements, et les marchands, d’autre part, seraient, en partie, privés de ce débouché.
Ternaux-Compans signale encore, avec beaucoup de verve et d’esprit, d’autres inconvénients de la prohibition à laquelle tend le rapport de M. de Montalembert, et notamment la difficulté d’arrêter les distractions et les plaisirs du dimanche, lesquels engendrent l’occupation et l’industrie d’une population nombreuse, le plaisir de l’un étant naturellement et nécessairement le travail et le profit de l’autre.
Joseph Garnier rappelle les conclusions de la commission dont M. de Montalembert a été le rapporteur, et montre qu’il n’y est pas question d’interdire le travail du dimanche, mais simplement de faire décider par la loi que le travail de l’État serait suspendu ce jour-là, et aussi que, dans les communes de 3 000 âmes et au-dessous, l’autorité municipale pourrait faire fermer les cabarets et autres lieux publics pendant la durée des offices. L’utilité du dimanche, au point de vue économique, ne fait pas plus de difficulté qu’au point de vue hygiénique, moral et religieux ; l’intervention de l’État lui semble suffisamment combattue ; enfin, la convenance pour l’État à ne pas laisser exécuter les travaux qui le concernent le dimanche, n’est pas contestée. Le point délicat gît donc uniquement dans le renouvellement de l’autorisation à donner aux maires de faire fermer, par mesure d’ordre, certains établissements pendant l’office.
Morin, représentant du peuple, n’accepte pas la question ainsi circonscrite ; il ne croit pas que les mœurs soient suffisantes pour généraliser un jour la pratique du dimanche, car il suffira toujours d’un seul marchand, par exemple, qui ne voudra pas fermer sa boutique, pour obliger les autres à laisser leurs magasins ouverts. Selon M. Morin, la loi doit intervenir pour fixer une règle commune et obligatoire.
L’honorable représentant ne pense pas qu’une pareille loi nuise à la production ; car il est démontré que des ouvriers, dans de bonnes conditions hygiéniques, produisent plus vite et davantage que ceux qui sont exténués de fatigue. Aucune objection ne peut être tirée non plus du commerce étranger et de la concurrence qu’il pourrait faire à la France, car en Angleterre, aux Etats-Unis, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, le dimanche est fidèlement observé.
Sainte-Beuve, membre de l’Assemblée législative, pense qu’il ne faut pas voir la question soulevée par M. de Montalembert, dans le projet de loi de la Commission qui est bien restreint, comme l’a dit M. Joseph Garnier, mais bien dans l’esprit du rapport qui est un véritable manifeste, dont la tendance va beaucoup plus loin, et jusqu’à la prohibition absolue de tout travail, de toute occupation le dimanche.
Bien que ce rapport semble manquer de cette hardiesse qui est habituelle à son auteur, il sous-entend, en principe, la religion d’État, c’est-à-dire la suppression de la liberté des cultes ; il conduit logiquement à des dispositions tout à fait analogues à celles de la loi de 1814. Mais c’est en vain que M. de Montalembert aura fait son manifeste, assez mal accueilli d’ailleurs par l’Assemblée ; la liberté de penser et la liberté des cultes n’ont rien à craindre. La loi de 1814 n’est pas abrogée, puisque la Cour de cassation en a plus d’une fois rappelé l’existence, mais elle est tombée en désuétude. Or, cette loi donne précisément aux municipalités le droit de faire fermer les établissements publics pendant les offices. Comment une nouvelle loi, plus timide, pourrait-elle produire ce qu’on n’a pas obtenu avec une loi plus énergique ?
L’honorable membre ne croit pas à l’avenir de la proposition de M. Olivier, soutenue par M. de Montalembert ; il espère bien que la liberté du travail sera à l’abri de toute atteinte, comme la liberté de conscience.
Après M. Sainte-Beuve, la question a paru épuisée, et la séance a été levée. Le sentiment bien prononcé de la grande majorité des membres présents a été, que si le repos d’un jour par semaine est essentiellement désirable dans l’intérêt des travailleurs et de la production, et que si l’économie politique, s’inspirant de l’hygiène, est en parfait accord avec la morale et la loi religieuse, c’est du progrès des lumières et des efforts de la religion et de l’action des mœurs qu’il faut attendre la pratique de ce repos. Quant à la loi, si elle intervenait de nouveau, elle produirait, comme celle de 1814, des effets diamétralement opposés à ceux qu’on veut obtenir.
_____________
Sur le même sujet, lire :
Charles Coquelin, article Dimanche du Dictionnaire de l’économie politique : http://www.institutcoppet.org/2011/07/31/dimanche-par-charles-coquelin-1852
Benoît Malbranque, La question du travail le dimanche dans la pensée économique française, sur le site des éditions de l’Institut Coppet : http://editions.institutcoppet.org/la-question-du-travail-le-dimanche-dans-la-pensee-economique-francaise/
Auteur quelque peu oublié, situé au confluent des traditions anglaises et françaises en économie politique, Richard Cantillon (1680-1734) est souvent mentionné élogieusement par les économistes autrichiens, qui trouvent dans son analyse de la monnaie, dans sa méthodologie et dans son concept d’entrepreneur des analyses préfigurant celles des maîtres de l’école autrichienne comme Mises ou Rothbard. Ce dernier concept, celui d’entrepreneur, est digne en particulier de retenir l’attention. À une époque où le mot n’est presque pas employé dans la littérature économique, et où l’entrepreneur n’a pas dans l’économie un rôle aussi prépondérant que de nos jours, Cantillon en fait l’acteur central du développement économique. B. M.
La notion d’entrepreneur chez Richard Cantillon
par Benoît Malbranque
Laissons Faire, n°18, mars 2015
Cantillon, bien que bercé par les idées d’un ordre naturel, idées déjà présentes chez Boisguilbert, et qui trouveraient dans l’idée de laissez faire, puis de main invisible, leur expression la plus caractéristique et la plus aboutie, avait trop connu la réalité des affaires et le monde économique pour imaginer qu’il pouvait se conduire tout seul. Il vit dans l’entrepreneur, bien que défini peu précisément, l’acteur principal et comme central de l’activité économique. Au lieu d’expliquer par une énigmatique « main invisible » la conduite des affaires économiques d’une nation, mais sans réclamer non plus la main, toujours très visible, de l’État, il eut recourt à la notion d’entrepreneur. Comme l’écrit Murphy, synthétisant la pensée de Cantillon, « l’entrepreneur est la main tout à fait visible qui permet au marché de fonctionner. »
Cantillon a été très largement crédité de l’invention du terme « entrepreneur » et de la reconnaissance, le premier, du rôle de l’entrepreneur dans une économie de marché, mais cette contribution a été souvent mal évaluée. Pour déterminer avec justesse le mérite de Cantillon dans ce domaine, il faut considérer, 1° l’utilisation même du mot entrepreneur ; 2° la théorie économique liée à la fonction d’entrepreneur dans une économie de marché. Nous étudierons ces deux questions l’une après l’autre.
1. D’OÙ VIENT LE MOT ENTREPRENEUR ?
Contrairement à ce que certains historiens de la pensée économique, au jugement trop hâtif et à l’attention trop négligée, le terme « entrepreneur » n’était absolument pas nouveau à l’époque de Richard Cantillon. Son utilisation dans un contexte économique, proche de celui qu’il a de nos jours, était déjà attestée au XVIIème siècle. On le retrouve par exemple dans le Parfait Négociant de Savary, datant de 1675, ouvrage dont son cousin possédait une copie dans sa large bibliothèque parisienne.
Si nous souhaitons prouver, donc, que Cantillon n’est pas à l’origine du mot, et qu’il n’a fait que l’emprunter chez Savary, nous avons pour cela toutes les preuves concordantes, et il faut en effet aboutir à cette conclusion que Cantillon n’a pas inventé le mot entrepreneur.
Cependant, en tant qu’historien de la pensée économique, ce sont des préoccupations plus hautes, si l’on peut dire, qui nous intéresse. Il faut distinguer ce que les linguistes appellent le signifiant et le signifié, et étudier si Cantillon, sans avoir inventé le mot, a inventé le concept, la théorie de l’entrepreneur. S’il avait copié un terme, mais analysé pour la première fois la fonction véritable d’un entrepreneur dans une économie de marché, Cantillon mériterait bien davantage de commentaires élogieux que si le contraire était vrai.
2. L’ENTREPRENEUR CHEZ CANTILLON
L’idée ici est d’étudier si on peut attribuer à Cantillon un rôle de fondateur ou s’il est le sujet de ce qu’il conviendrait d’appeler le syndrome Montchrétien. Montchrétien est le nom de cet économiste qui, en 1615, publia un ouvrage assez médiocre de toute évidence, mais avec un titre qui devait connaître un grand succès : Traité d’économie politique. C’était la première fois, en France comme dans le monde, qu’un auteur intitulait ainsi un livre. Cependant c’était un titre choisi à la dernière minute et presque par hasard : à l’intérieur du livre, l’heureuse expression « économie politique » ne se retrouvait pas une seule fois, et à considérer les principes défendus par l’auteur, on pouvait dire avec raison que jamais l’inventeur du nom d’une science fut à ce point ignorant de ses principes vérités.
Chez Cantillon, doit-on commencer par noter, le qualificatif d’entrepreneur recouvre une réalité qui peut nous apparaître assez floue de prime abord : il est chez lui aussi bien celui qui apporte les fonds pour mettre en œuvre un projet industriel ou commercial, que celui qui dirige ce projet de manière concrète. Peu importe donc pour Cantillon si l’entrepreneur apporte ou non les fonds ; c’est celui qui prend le risque, ayant mis les fonds ou non. De sorte qu’il confond le rôle de « capitaliste » et celui « d’entrepreneur ».
Ce qui caractérise l’entrepreneur, c’est qu’il est un preneur de risque, c’est qui agit dans l’incertitude. D’ailleurs, le mot incertain, incertitude, revient beaucoup dans les pages de l’Essai consacrées à l’entrepreneur.
Cette notion de risque est si décisive pour Cantillon qu’il décide d’interpréter toute la société à l’aune de cette idée, et de définir ainsi deux classes : d’un côté ceux qui prennent des risques ; de l’autre, ceux qui n’en prennent pas :
« Tous les habitants d’un État peuvent se diviser en deux classes, savoir en entrepreneurs, et en gens à gages ; les entrepreneurs sont comme à gages incertains, et tous les autres à gages certains pour le temps qu’ils en jouissent, bien que leurs fonctions et leur rang soient très disproportionnés. Le général qui a une paie, le courtisan qui a une pension, et le domestique qui a des gages, tombent sous cette dernière espèce. Tous les autres sont entrepreneurs, soit qu’ils s’établissent avec un fond pour conduire leur entreprise, soit qu’ils soient entrepreneurs de leur propre travail sans aucuns fonds, et ils peuvent être considérés comme vivant à l’incertain ; les gueux même et les voleurs sont des entrepreneurs de cette classe. »
Cette classification en fonction de la notion de risque est aux antipodes de la structure rigide de Marx, qui postule que certains hommes sont privés de toute faculté, de tout capital, quand notre corps, pourtant, est pour chaque homme un capital[1]. Elle est différente, mais pas antinomique de la conception physiocratique des classes productive et stérile, ni de l’idée des industrialistes du XIXème siècle, qui distinguaient les agents producteurs des parasites qui vivent du travail d’autrui, dont les gouvernements.
Ainsi, le fermier, qui représente la classe productive chez les Physiocrates, se range chez Cantillon dans la classe des entrepreneurs, car il prend un risque :
« Le fermier est un entrepreneur qui promet de payer au propriétaire, pour sa ferme ou terre, une somme fixe d’argent (qu’on suppose ordinairement égale en valeur au tiers du produit de la terre), sans avoir de certitude de l’avantage qu’il tirera de cette entreprise »
L’origine de cette incertitude, Cantillon la voit dans la confrontation perpétuelle de l’offre et de la demande, dont il a dit plus haut qu’elle permettait d’établir les prix. Or, tandis que les prix varient, les profits, reconnus comme la différence entre le prix de vente et le coût de revient, varie également. Ainsi, ne pouvant prévoir la demande de manière parfaite, chaque entrepreneur est dans une position délicate, car incertaine. Et cela vaut pour tout entrepreneur, quel que soit son domaine d’activité.
« Ces entrepreneurs ne peuvent jamais savoir la quantité de la consommation dans leur ville, ni même combien de temps leurs chalands achèteront d’eux, vu que leurs rivaux tacheront par toutes sortes de voies de s’en attirer les pratiques : tout cela cause tant d’incertitude parmi tous ces entrepreneurs, qu’on en voit qui font journellement banqueroute. »
« Le manufacturier qui a acheté la laine du marchand ou du fermier en droiture, ne peut pas savoir le profit qu’il tirera de son entreprise, en vendant ses draps et étoffes au marchand drapier. Si celui-ci n’a pas un débit raisonnable, il ne se chargera pas des draps et étoffes du manufacturier, encore moins si ces étoffes cessent d’être à la mode.
« Le drapier est un entrepreneur qui achète des draps et des étoffes du manufacturier à un prix certain, pour les revendre à un prix incertain, parce qu’il ne peut pas prévoir la quantité de la consommation ; il est vrai qu’il peut fixer un prix et s’obstiner à ne pas vendre à moins qu’il ne l’obtienne, mais si ses pratiques le quittent pour acheter à meilleur marché de quelque autre, il se consumera en frais en attendant de vendre au prix qu’il se propose, et cela le ruinera autant ou plus que s’il vendait sans profit. »
Quelles considérations pouvons-nous tirer de ces aperçus sur l’entrepreneur ? C’est d’abord que, chez Cantillon, est entrepreneur tout individu qui, dans son activité productive, fait face à une incertitude, à un risque. La question de savoir si, en tant que gérant de son affaire, il utilise son propre capital ou un capital emprunté, est de seconde importance. Dans un cas comme dans l’autre, le gérant serait en situation d’incertitude quant à ses revenus, pouvons faire faillite à tout retournement de marché.
La notion d’entrepreneur chez Cantillon apparaît ainsi plus précise, et tout à la fois plus juste, que celles trouvées chez Turgot ou chez Jean-Baptiste Say, pourtant ses successeurs. Turgot, en effet, ne qualifie d’entrepreneur que l’homme industrieux ne disposant pas de capitaux pour lancer son affaire, et en obtenant de quelqu’un d’autre. Jean-Baptiste Say, quant à lui, a eu davantage tendance à considérer l’entrepreneur comme un planificateur, non comme un preneur de risque ou comme, pourrait-on dire, un aventurier. Ni l’un ni l’autre n’ont saisi, comme Cantillon a pu le faire, ce qui fait l’essence même de l’entrepreneuriat.
Par ces idées sur l’entrepreneur, Cantillon a initié une tendance, qui s’épanouira avec Turgot, et plus encore avec Say, pour enfin reconnaître à l’entrepreneur une place à part dans l’économie, contrairement aux affirmations de l’école anglaise. C’est un des domaines dans lesquels, indéniablement, Cantillon fait bel et bien partie de la tradition française en économie politique. Les économistes anglais, en effet, ont longtemps négligé la notion d’entrepreneur, conservant le seul terme « capitaliste », imparfait et même faux, qui sera repris par les marxistes. Le capitaliste, en effet, est celui qui fournit le capital pour créer une entreprise ; souvent il ne dirige pas les affaires, et ne rend pas le genre de service ou de prestation de travail qui est typique de l’entrepreneur. Ce manquement de l’école anglaise sera, au XIXème siècle, le sujet de vives réprimandes de la part du plus grand économiste français du siècle, Jean-Baptiste Say :
« Les Anglais n’ont point de mot pour rendre celui d’entrepreneur d’industrie ; ce qui les a peut-être empêchés de distinguer dans les opérations industrielles, le service que rend le capital, du service que rend, par sa capacité et son talent, celui qui emploie le capital ; d’où résulte de l’obscurité dans les démonstrations où ils cherchent à remonter à la source des profits. » (JB Say, Traité, Calmann Lévy, Paris, 1972, pp.74-75)
Les idées de Cantillon relativement à l’entreprenariat sont cependant loin d’être parfaites, et il est de nombreuses questions importantes qu’il ne traite que superficiellement ou omet entièrement de considérer. Il n’évoque par exemple pas le capital comme un problème économique à résoudre, peut-être parce qu’il ne voyait pas le capital comme un bien rare. On dirait qu’il croit qu’il y aura toujours assez de capital pour financer les activités entrepreneuriales. Pour sa défense, il faut admettre que, à l’époque, cela était proche de la réalité, non que le capital était considérable (il s’était massivement accumulé depuis peu, néanmoins), mais les activités entrepreneuriales étaient peu nombreuses et peu consommatrices de capitaux.
Cantillon nous fournit également peu d’informations sur les opérations de l’entrepreneur : il ne prétend pas le guider ni le sermonner de maximes permettant d’augmenter au maximum la production. Il le laisse, pour ainsi dire, livré à lui-même. Même sur la question de la fixation du niveau des salaires, fixation qui est, dans chaque entreprise, le fait de l’entrepreneur, et duquel dépend bien souvent le succès ou l’échec de l’entreprise, même sur cette question donc, Cantillon reste vague. À peine indique-t-il que le salaire doit se régler sur « la coutume du lieu », c’est-à-dire être en rapport avec le niveau de vie général de la société.
Néanmoins, ces manquements ou ces lacunes considérés, nous ne pouvons conclure autrement ce court chapitre qu’en considérant que Cantillon a été l’un des économistes les plus clairvoyants de son siècle en observant la fonction qui, dans une économie de marché, était la plus décisive et pourtant la plus discrète, celle de l’entrepreneur.
Pour quiconque distingue les diverses fonctions distinctes dans l’économie, celles de capitaliste, de propriétaire, d’entrepreneur et de salarié, la fonction essentielle et irremplaçable, du moins dans une économie de marché libre, est remplie par l’entrepreneur. C’est ce que notait Jean-Baptiste Say, suivant les pas de Cantillon, qui écrivait déjà de manière parfaitement claire :
« L’entrepreneur d’industrie est l’agent principal de la production. Les autres opérations de l’industriel sont bien indispensables pour la création des produits ; mais c’est l’entrepreneur qui les met en œuvre, qui leur donne une impulsion utile, qui en tire des valeurs. » [2]
C’est aussi ce que signalait, d’une manière plus polémique mais non moins juste, la philosophe et romancière Ayn Rand, qui fait partie avec Cantillon des héros des libéraux de tendance « autrichienne ».
Enfin, bien que Cantillon ne soit pas l’inventeur du mot entrepreneur, c’est lui qu’on doit tenir pour responsable de la généralisation du terme dans la plupart des langues — dont l’anglais, où entrepreneur a pris la place d’undertaker ; c’est aussi à lui que l’on doit l’utilisation pertinente du concept d’entrepreneur par toute la tradition française en économie politique, de Turgot à Yves Guyot et passant par Jean-Baptiste Say et Jean-Gustave Courcelle-Seneuil.
Benoît Malbranque
____________________
[1] Cf. Michel Leter, Le Capital, t.1,
[2] Cours complet, partie 1, chap. VI
Depuis le début de l’année 2015, les libéraux sont piégés par le problème du terrorisme, qui semble obliger à remettre à plus tard les réformes du marché du travail, de l’éducation nationale, de la fiscalité, etc. Mais faut-il attendre la fin du problème terroriste pour régler les autres problèmes ? Un texte précieux de Pierre de Boisguilbert, l’un des fondateurs de la tradition libérale française, nous éclaire à ce sujet. Ajouté comme supplément au Détail de la France (1695), il répond aux détracteurs de son projet libéral, qui affirmaient que l’état de guerre empêchait toute réforme économique. (Un texte à retrouver dans notre réédition du Détail de la France.) B.M.
SUPPLÉMENT AU DÉTAIL DE LA FRANCE
Il est surprenant que dans les grands besoins qu’a présentement l’État de secours extraordinaires, les peuples faisant offre de les fournir dans le moment, au moyen de quelques accommodements, lesquels, sans rien déranger, n’exigent qu’un simple acte de volonté des personnes en place, et mettront ces mêmes peuples au même instant en état d’y satisfaire avec profit de leur part ; il est étonnant, dis-je, qu’on ne veuille accepter ces offres qu’après la conclusion de la paix , bien que ce soit l’unique moyen d’en procurer une très avantageuse. En sorte que, par une destinée jusqu’ici inouïe, ceux à qui il tombe en charge de payer, se soumettent de le faire sans demander de délai, et les personnes qui ne doivent avoir d’autres fonctions que de recevoir, exigent un terme et un délai, fort incertains, pour l’accepter.
Outre cette situation monstrueuse, on peut assurer que la guerre étrangère coûte dix et vingt fois moins au royaume que les désordres intestins causés par les manières que l’on pratique pour recouvrer les fonds afin d’y subvenir ; si bien que, mettant pour ainsi dire l’incendie dans toutes les contrées de la France, il est plus opportun de l’arrêter que la guerre du dehors, dont, encore une fois, la conclusion avantageuse dépendra absolument de cette paix du dedans, qui se peut terminer à moins d’un mois ; et l’allégation de la guerre étrangère comme un obstacle au rétablisse-ment de la félicité générale est la même erreur que si, le feu étant aux quatre coins d’une maison, on soutenait qu’il ne faut pas l’éteindre qu’un procès que l’on aurait pour la propriété en un tribunal éloigné ne fût jugé ; et c’est ce qui se verra mieux par un petit détail de cette guerre intestine, ou de cet embrasement du royaume, article par article.
Faut-il attendre la paix pour faire labourer les terres dans toutes les provinces, où la plupart demeurent en friche par le bas prix du blé, qui n’en peut supporter les frais, et où l’on néglige pareillement l’engrais de toutes les autres, ce qui fait un tort de plus de 500 000 muids de blé par an à la France, et 500 millions de perte dans le revenu des peuples, par la cessation de la circulation de ce premier produit, qui mène à sa suite toutes les professions d’industrie, lesquelles vivent et meurent avec lui ?
Faut-il attendre la paix pour un autre article, qui est une suite du précédent, savoir : pour faire payer les propriétaires de fonds par ceux qui les font valoir, desquels nul maître ne recevant rien, ou il ne fait nul achat dans les boutiques, ou ne satisfaisant pas aux crédits précédents, les marchands sont obligés de faire banqueroute ?
Faut-il attendre la paix pour faire cesser d’arracher les vignes, comme on fait tous les jours, pendant que les trois quarts des peuples ne boivent que de l’eau, à cause des impôts effroyables sur les liqueurs, qui excèdent de quatre ou cinq fois le prix de la marchandise ; et quand le produit qui donne lieu à une pareille destruction est offert d’être payé au double à l’égard du roi d’une autre manière par les peuples, ce qui serait un quadruple profit de leur part, ne peuvent-ils être écoutés, et doit-on les renvoyer à un autre temps, en soutenant qu’il faut attendre que toutes les vignes soient arrachées pour donner permission aux peuples de les cultiver ; ce qui serait entièrement inutile, et ne vaudrait guère mieux que d’appeler un médecin pour guérir un mort ?
Faut-il attendre la paix pour ordonner que les Tailles seront justement réparties dans tout le royaume, et que l’on ne mettra pas de grandes recettes à rien ou peu de chose, pendant qu’un misérable qui n’a que ses bras pour vivre lui et toute une famille, voit, après la vente de ses chétifs meubles ou instruments dont il gagne sa vie, comme on fait pour l’ustensile qui se règle sur le niveau de la Taille, enlever les portes et les sommiers de sa mai-son pour satisfaire au surplus d’un impôt excédant quatre fois ses forces ? M. de Sully, qui rétablit la France, l’ayant trouvée au point où elle peut être aujourd’hui, n’était pas persuadé que la guerre eût rien de commun avec ces règlements, puisqu’il fit une ordonnance en 1597 pour régler la juste répartition de la Taille, ainsi que tous les autres désordres, qu’il arrêta au milieu de deux guerres, l’une civile et l’autre étrangère, qui désolaient le dedans et le dehors du royaume d’une bien plus cruelle manière que ne peut être la conjoncture d’aujourd’hui ; et le tout fut si ponctuellement exécuté, que le roi et les peuples devinrent très riches, de très mal dans leurs affaires qu’ils étaient auparavant.
Faut-il attendre la paix pour sauver la vie à deux ou trois cent mille créatures qui périssent au moins toutes les années de misère, surtout dans l’enfance, n’y en ayant pas la moitié qui puisse par-venir à l’âge de gagner leur vie, parce que les mères manquent de lait, faute de nourriture ou par excès de travail ; tandis que dans un âge plus avancé, n’ayant que du pain et de l’eau, sans lits, vêtements, ni aucuns remèdes dans leurs maladies, et dépourvues de forces suffisantes pour le travail, qui est leur unique revenu, elles périssent avant même d’avoir atteint le milieu de leur carrière ?
Faut-il attendre la paix pour la donner aux immeubles, ce qui se peut en un instant, le roi déclarant qu’il se contentera désormais de subsides réglés proportionnés aux forces de chacun des contribuables, ainsi qu’il se fait présentement en Angleterre, en Hollande, et dans tous les pays du monde, et qu’il s’est fait même en France durant onze cents ans ; et que l’on ne bombardera plus rien, surtout les charges, comme il est arrivé à une infinité de personnes ; ce qui faisant tout le vaillant d’un homme, le réduit à l’aumône, et mettant tous les autres possesseurs de semblables biens dans l’attente d’un pareil sort, les ruine presque également sans que le roi reçoive rien ? N’est-ce pas, en effet, leur ôter tout crédit, puisque le crédit ne roulant que sur la solvabilité du sujet qui s’en sert, cette solvabilité s’anéantit par la destruction du prix des fonds qu’il possède ; tout comme dans une ville menacée de bombardement, quoique les maisons ne ressentent actuellement aucun mal, elles perdent neuf parts sur dix de leur valeur ordinaire, qu’elles reprennent aussitôt que cette crainte est passée. Ainsi on peut en un instant, par l’établissement d’une paix intestine, doubler et tripler le prix de tous les immeubles, et par conséquent le crédit, qui est la moitié, encore une fois, du revenu des peuples.
Faut-il attendre la paix pour mettre le roi en état de payer les officiers à point nommé, afin que ceux-ci soient en pouvoir de faire leurs recrues dans les temps commodes, et de bonne heure ?
Faut-il attendre la paix pour donner assez de secours au roi afin que par un engagement considérable on fasse des soldats volontairement, et que l’on ne mène pas des forçats liés et garottés à l’armée, comme on fait aux galères et même au gibet ; ce qui, au rapport de M. de Sully, dans ses Mémoires, ne sert qu’à décourager les autres, décrier le métier et la nation, parce qu’ils désertent tous à la première occasion, ou meurent de chagrin ?
Faut-il attendre la paix pour cesser de constituer l’État sous le nom du roi, en sorte qu’après la fin de la guerre le payement des intérêts de l’argent pris en rente coûtera plus aux peuples que l’entretien de la guerre, de façon que c’en sera une perpétuelle qu’ils auront à soutenir ?
Faut-il attendre la paix pour purger l’État des billets de monnaie qui par le déconcertement qu’ils apportent dans le commerce, coûtent quatre fois plus par an que la valeur de toutes les sommes pour lesquelles on en a créé, c’est-à-dire quatre fois plus que la guerre étrangère ? Que le royaume s’en recharge par un juste partage sur la tête des particuliers et Communautés. L’endos qu’ils y mettront, payable en quatre ans par quatre payements différents, avec intérêts, les fera circuler dans le trafic sans aucune perte du transportant ; et le rétablissement de la consommation, possible en trois heures par la simple cessation d’une très grosse violence faite à la nature, dédommagera au quadruple tous ces endosseurs, de cette prétendue nouvelle charge, ainsi que la crue ou la hausse de la fourniture des besoins du roi.
Faut-il enfin attendre la paix pour cesser de vendre tous les jours des immeubles, surtout des Charges, avec promesse qu’on en jouira tranquillement, et que ceux qui auront prêté leur argent pour cet achat auront un privilège spécial, et puis, quelque temps après, revendre ce nouvel effet à un autre, sans nul dédommage-ment au premier acquéreur non plus qu’au prêteur ; ce qui ôtant la confiance, qui est l’âme du trafic, rompt tout commerce entre le prince et ses sujets, fait que l’argent seul, pouvant être à l’abri de pareils orages, est estimé l’unique bien, et comme tel resserré dans les cachettes les plus obscures qu’on peut trouver, avec une cessation entière de toutes sortes de consommations, dont cet argent est uniquement le très humble valet ? C’est une très grande absurdité de chercher d’autre cause de la rareté que l’on en voit régner, que cette même destruction de consommation, comme de nier qu’en la rétablissant, comme cela se peut en un moment, on le verra aussi commun que jamais ; bien que depuis un très long temps on ne l’ait cherchée que dans la destruction de la seule cause qui le fait marcher, savoir, encore une fois, la ruine de la consommation.
L’esprit le plus borné et le plus rempli de ténèbres qui fût jamais ne peut être assez aveuglé pour produire de pareils soutiens : il n’y a que le cœur ; car, au témoignage de l’Écriture sainte, lorsqu’il est une fois corrompu, un saint revenant exprès de l’autre monde, ne le changerait pas. Aussi, quoiqu’on va montrer qu’il est aussi certain que les peuples peuvent par trois heures de travail de MM. les ministres, et un mois d’exécution de leur part, sans rien déconcerter, ni mettre aucun établissement précédent au hasard, qu’ils peuvent, dis-je, fournir cent millions de hausse au roi pour ses besoins présents, avec quadruple profit de leur part, et que l’on fasse cette preuve avec autant de certitude que si un ange la venait apporter du ciel ; on ne prétend pas néanmoins convertir un seul de ces cœurs corrompus, c’est-à-dire ceux en qui la destruction publique est le principe de la haute fortune : on ne s’adresse qu’aux esprits qui pourraient se laisser gâter par la contagion de sujets dépravés, et par conséquent suspects sur une pareille matière.
Voici comment on fait cette preuve : ce qui est constamment vrai, ne serait pas plus certain quand tous les saints du paradis le viendraient attester, et il est à coup sûr aussi indubitable que la Seine passe à Paris, que si les anges en venaient rendre témoignage.
Il y a une seconde chose incontestable, savoir, que tous les faits sur lesquels plusieurs s’accordent sans aucune convenance précédente entre eux, sont aussi certains que si nos propres yeux nous en portaient témoignage.
Tous les hommes raisonnables qui n’ont jamais été à Rome parieraient tout leur bien, contre une pièce de trente sous, qu’il existe au monde une ville de ce nom, parce que trop de gens l’ont dit et écrit sans avoir concerté de mentir, pour que cela ne soit pas véritable ; et même si quelqu’un voulait contredire ce fait, on le traiterait de fou et d’extravagant.
Or, on maintient que l’établissement de cent millions de hausse de la part des peuples, avec quadruple profit de leur part, possible en trois heures de travail et un mois d’exécution, a le même degré de certitude que cet exemple de Rome, attendu que tous les peuples non suspects sont prêts à en signer la proposition aux conditions marquées ; et l’on soutient en même temps que si le roi ordonnait à quelqu’un de mettre par écrit des raisons qui fissent voir l’impossibilité d’un pareil recouvrement, outre qu’il ne saurait par où commencer ni par où finir, il serait en horreur et à Dieu et aux hommes. Et la demande du délai jusqu’après la paix est un aveu pur et simple que la chose est très aisée, ou la contradiction impossible, puisque la paix ou la guerre étrangère n’ont nulle relation avec ce qui se passe au dedans du royaume à l’égard des tributs : c’est donc montrer grossièrement que, ne pouvant nier que les manières pratiquées mettent le feu aux quatre coins de la France, on souhaite seulement que l’on remette à l’éteindre jusqu’à la paix ; non, encore une fois, qu’elle ait aucun rapport à ces désordres, mais parce que l’on espère par là obtenir un délai, et que l’embrasement soit continué, attendu qu’on y trouve son compte, et que l’on est au nombre des incendiaires qui se font bien payer pour de pareils services.
De si cruelles dispositions et de semblables énoncés ne doivent pas surprendre de la part des Traitants, puisque c’est à l’aide d’une pareille politique qu’ils se procurent ces fortunes immenses qui font la ruine de l’État, et qu’ils se sont fait donner, depuis 1689, 200 millions pour leur part, sans celle du néant, qui croissant sous leurs pieds, excède de dix à vingt fois ce que tant le roi qu’eux reçoivent par un si funeste canal ; et même de pareilles objections n’auraient pas également surpris dans la bouche des ministres avant 1661, parce que ou ils étaient Traitants eux-mêmes, ou ils prenaient part dans tous les partis, comme il fut vérifié contradictoirement à la chambre de justice ; ce qui était la même chose à l’arrivée de M. de Sully au ministère, lequel dit au roi Henri IV que les Traitants, qui sont la ruine d’un État, n’avaient été inventés par les ministres que pour prévariquer, leur étant impossible de rien prendre dans les tributs réglés passant droit des mains des peuples en celle du prince, comme il se pratique dans tous les pays du monde ; au lieu que par les Partisans, ils sont les maîtres absolus des biens de tout le monde, mettant un homme riche sur le carreau, et le dernier des misérables dans l’opulence quand il leur plaît, et ne sont privés pour leur particulier de recevoir quelques sommes que ce puisse être, qu’autant qu’ils les veulent refuser, n’y ayant d’autres bornes que celles que l’on peut attendre de leur modération ; comme, dis-je, c’était là la situation des ministres avant 1661, la demande de délai pour changer des manières si déplorables n’eût pas surpris, parce qu’on l’eût regardée comme des lettres d’État de leur part pour se maintenir dans une si agréable situation à leur égard, quoique si funeste au roi et aux peuples ; mais aujourd’hui et depuis 1661, que l’intégrité tout entière a succédé tout à coup dans le ministère, et sans aucun milieu, à une extrême prévarication, on ne peut qu’être surpris d’avoir vu trois fois un quadruplement de Partisans et de manières désolantes, ainsi que la demande actuelle d’un délai pour éteindre le feu qui est aux quatre coins du royaume, avec un refus de recevoir de la part des peuples tous les besoins du roi, dans un temps qu’ils sont absolument nécessaires à la monarchie, parce qu’on ose appeler un renversement d’État la cessation du plus grand bouleversement qui fût jamais, qui fait une très grande violence à la nature, et qui peut être arrêté en un moment avec beaucoup moins de dérangement qu’il n’y en eut lors de la Capitation établie en 1695, au milieu de la guerre.
Et si, quant à cette Capitation, qui avait promis la cessation des Affaires extraordinaires, elle n’a eu d’autre résultat, grâce à ceux qui trompèrent MM. les ministres dans la répartition, que de rendre l’impôt ridicule, et par suite insuffisant à atteindre aux besoins du roi, il n’est pas à craindre qu’il en arrive de même dans celle qu’on propose, puisqu’elle ira à plus de cent millions avec quadruple profit de ceux qui payeront six fois leur cote précédente, et cela par la simple attention à ces quatre articles, savoir : les blés et liqueurs, la juste répartition des Tailles, et la cessation des affaires extraordinaires ; ce qui n’exige qu’un simple acte de volonté du roi et de MM. les ministres, pour finir une très grande violence qu’on fait à la nature, bien que la négligence de cette attention coûte, de compte fait, plus de quinze cents millions de perte par an au royaume depuis 1661, que l’intégrité est dans le ministère, les prévarications précédentes n’ayant rien produit de si funeste ; mais bien le contraire, et tous les biens se trouvant doublés en 1661, ainsi que ceux du roi, du prix qu’ils étaient trente ans auparavant.
Que si ce nombre de 1 500 millions étonne, on le prend d’une autre manière, et on maintient que sur quarante mille villes, bourgs et villages qu’il peut y avoir dans le royaume, il n’y en a aucun, l’un portant l’autre, qui n’ait perdu cinquante mille livres de revenu tant en fonds qu’en industrie, ou plutôt dix et vingt fois davantage que ce que le roi en tire par toutes sortes d’impôts, à le vérifier sur tel lieu que le parti contraire voudra choisir, sans qu’on en puisse accuser le manque d’espèces, qui sont aujourd’hui au double dans la France, comptant exactement ce qui est entré et sorti, de ce qu’il y en avait en 1661, que les quinze cents millions de rente existaient. Mais c’est que l’argent est devenu paralytique, et qu’il avait au contraire des jambes de cerf en ce temps-là, ce qui est le seul principe de la richesse des peuples, et par conséquent de la fourniture des besoins du roi. Car les tributs, comme toutes sortes de redevances, tirent leur qualité d’excès ou de modicité, non de la quotité absolue des sommes que l’on demande, mais de la valeur des fonds dont on les exige, et la vigueur de ceux-ci n’est qu’à proportion de la vente des denrées qu’ils produisent ; d’où il suit que cette production pouvant être doublée en un moment, il n’en faudrait pas davantage pour rendre au cours des espèces la même rapidité qu’imprime à l’eau d’un torrent la levée de la digue qui la retenait sur le bord d’une pente ; et la même absurdité qui se rencontrerait dans l’objection que cette eau ne pourrait couler dans la vallée, après l’enlèvement de la digue, qu’une guerre étrangère ne fût terminée, se trouve encore dans l’allégation des personnes qui prétendent qu’il faut attendre la fin de cette même guerre pour voir marcher la consommation, bien que les causes violentes qui l’arrêtent puissent être ôtées en un moment, en quelque temps que ce soit.
Quand on dit cent millions d’augmentation dans les revenus du roi en un instant, ce n’est pas cent millions d’espèces de nouvelle fabrique, comme au Pérou, c’est cent millions de pain, de vin, de viande, ou autres denrées, qui étant le seul soutien de la vie, le sont pareillement des armées, lesquelles seront fournies au moyen de dix millions seulement, et même moins, qui faisant dix voyages et dix retours des mains des peuples en celles du prince, enfanteront cette livraison de denrées dont il se perd tous les jours dix fois davantage, tant produites qu’à produire ; pendant que d’un autre côté ces dix millions, qui ne marchent jamais que par l’ordre de la consommation, résident des années entières dans des retraites dont toutes les machines du monde ne les peuvent tirer : loin de là, toutes les mesures que l’on prend ne servent qu’à les y enfoncer davantage, au lieu qu’en un instant on les peut mettre, ainsi que tout le reste, en mouvement ; ce qu’on offre à la garantie des peuples, qui vaut beaucoup mieux que celle des Traitants, n’y ayant qui que ce soit, non intéressé à la cause des désordres, qui ne donne avec plaisir et profit les deux sous pour livre de son revenu pour être payé du surplus avec exactitude, ce qui n’est pas à beaucoup près présentement, et ce qui est immanquable par le système proposé, beaucoup plus propre au soutien de la guerre que toutes les pratiques employées jusqu’à ce jour.